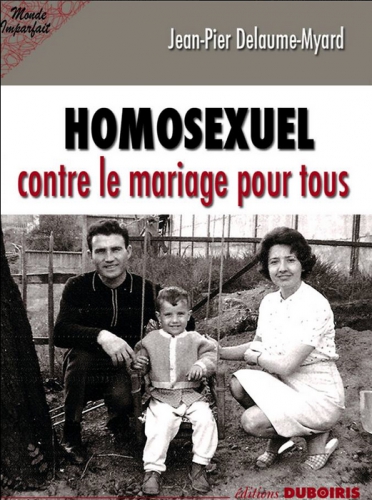L’Eucharistie et la guérison
L’Eucharistie et la guérison
Enseignement par le Père Nicolas Buttet, fondateur de la Fraternité Eucharistein, pendant le Congrès sur l'Adoration Eucharistique, Adoratio 2017, avec pour thème "Adorer au Cœur du Monde".
 Première réflexions introductives. D’abord, on a beaucoup de confusion entre la santé et le salut. Finalement ce que nous désirons profondément c’est être sauvés, c’est la vie éternelle. Et puis, on a reporté aujourd’hui, un petit peu, sur la santé la quête de vie éternelle. Il y a une sorte d’obsession de la santé et une sorte de désaffection pour l’idée du salut, de la rédemption, de la vie éternelle, de sorte que, finalement, on estime plus important parfois la santé que le salut. Il ne faut pas opposer l’un à l’autre. Dans le livre des Chroniques on nous dit que Asa eut les pieds malades, une maladie très grave, et même alors il n’a pas recourt dans sa maladie au Seigneur, mais aux médecins seulement. Il ne va pas chez le Seigneur, il est malade, ça ne va pas bien du tout et il ne va pas chez le Seigneur. C’est quand même terrible. Et puis, inversement, dans l’Évangile de saint Marc, on nous parle de cette femme atteinte d’hémorragies et elle avait beaucoup souffert de nombreux médecins et elle avait dépensé tout son avoir sans aucun profit, même que ça allait pire après, qu’avant. Elle va vers Jésus et elle va être guérie. Alors, pour la petite histoire, saint Luc ne parle pas qu’elle avait souffert des médecins. Comme il était toubib lui-même, il ne voulait pas d’ennui avec la profession, il dit juste que c’était compliqué pour elle. Donc, on se rend compte que, tout d’un coup, on a une frontière un peu particulière et saint Augustin nous dira : « Quelques fois le médecin se trompe en promettant au malade la santé du corps. Dieu te donne, à toi qu’il a fait, une guérison certaine et gratuite. Le Christ est à la fois le médecin des corps et des âmes. Dieu guérit parfaitement toute maladie, mais Il ne guérit pas sans le malade. » Première remarque dans cette relation santé/salut qu’il s’agit de bien intégrer.
Première réflexions introductives. D’abord, on a beaucoup de confusion entre la santé et le salut. Finalement ce que nous désirons profondément c’est être sauvés, c’est la vie éternelle. Et puis, on a reporté aujourd’hui, un petit peu, sur la santé la quête de vie éternelle. Il y a une sorte d’obsession de la santé et une sorte de désaffection pour l’idée du salut, de la rédemption, de la vie éternelle, de sorte que, finalement, on estime plus important parfois la santé que le salut. Il ne faut pas opposer l’un à l’autre. Dans le livre des Chroniques on nous dit que Asa eut les pieds malades, une maladie très grave, et même alors il n’a pas recourt dans sa maladie au Seigneur, mais aux médecins seulement. Il ne va pas chez le Seigneur, il est malade, ça ne va pas bien du tout et il ne va pas chez le Seigneur. C’est quand même terrible. Et puis, inversement, dans l’Évangile de saint Marc, on nous parle de cette femme atteinte d’hémorragies et elle avait beaucoup souffert de nombreux médecins et elle avait dépensé tout son avoir sans aucun profit, même que ça allait pire après, qu’avant. Elle va vers Jésus et elle va être guérie. Alors, pour la petite histoire, saint Luc ne parle pas qu’elle avait souffert des médecins. Comme il était toubib lui-même, il ne voulait pas d’ennui avec la profession, il dit juste que c’était compliqué pour elle. Donc, on se rend compte que, tout d’un coup, on a une frontière un peu particulière et saint Augustin nous dira : « Quelques fois le médecin se trompe en promettant au malade la santé du corps. Dieu te donne, à toi qu’il a fait, une guérison certaine et gratuite. Le Christ est à la fois le médecin des corps et des âmes. Dieu guérit parfaitement toute maladie, mais Il ne guérit pas sans le malade. » Première remarque dans cette relation santé/salut qu’il s’agit de bien intégrer.
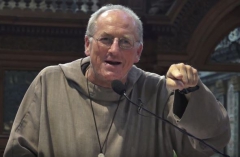 Deuxième remarque : Est-ce que le malade doit être guérit dans la Bible ? Comme être vivant ou mort, ce n’est pas tout à fait ce qu’on croit. Évidemment la frontière ne passe pas entre une santé physique ou psychique et une maladie physique ou psychique. Elle passe entre être avec Dieu ou être sans Dieu. Quand quelqu’un est avec Dieu, même s’il est malade il est en bonne santé, quelque part. Quand quelqu’un est mort avec Dieu, Dieu lui parle. Á Lazare, vous imaginez !, le frère de Marie-Madeleine. Ça fait quatre jours qu’il est au tombeau, ça sent déjà mauvais et Jésus lui dit : « Sors ! ». On ne parle pas aux morts ! Alors que, à Hérode qui vient lui poser des questions à sa Passion, il ne répond pas parce qu’il est déjà mort dans le cœur. Il y a des vivants qui sont morts, il y a des morts qui sont vivants. Et finalement la frontière n’est pas tout à fait là où on pense qu’elle est. Finalement, au cœur de tout ça, c’est la présence de Jésus. Quand Mère Teresa était malade à l’hôpital, pour une nouvelle crise cardiaque qu’elle venait de faire, le médecin hindou dit au prêtre qui était à côté de Mère Teresa : « Père, allez vite chercher la petite boîte ! ». Le prêtre dit : « La boîte de médicaments ? Quel médicament ? Quelle boîte ? ». « Mais non ! La petite boîte qu’ils apportent et qu’ils mettent dans sa chambre. Quand la boîte est là, Mère Teresa la regarde tout le temps. Si vous la mettez, l’apportez dans sa chambre, elle sera toute calme. » Le prêtre a compris qu’il s’agissait du Tabernacle, la Présence réelle. Et le médecin rajoute : « Quand cette boîte est là dans sa chambre elle ne fait que regarder, regarder, regarder encore cette boîte. » Et donc Mère Teresa avait la grâce d’avoir la Présence réelle dans sa chambre d’hôpital. Et quelque fois Dieu a des manières assez surprenantes de nous voir. Je prends un exemple : Dans les Actes des Apôtres vous savez qu’il y a cet eunuque éthiopien, premier ministre de la reine d’Éthiopie qui retourne chez lui depuis Jérusalem et qui est en train de lire, seul. Alors, il faut s’imaginer ce qu’est un eunuque. C’est une personne qui ne peut plus avoir d’enfant. Dans la tradition antique la postérité était capitale. C’était une façon d’exister socialement. C’est la seule façon d’exister. C’est une sorte de malédiction de ne pas avoir de descendance. Il avait tout le pouvoir politique qu’il voulait. Il avait la reconnaissance de la reine et des gens qui s’inclinent et lui font des courbettes. Mais fondamentalement son être humain est complètement atrophié et sa suite n’est pas là. Il est en train de lire un texte un peu particulier quand Philippe le rattrape. Ce texte que l’on retrouve dans les Actes des Apôtres et qui est une citation du prophète Isaïe : « Dans son humiliation, ̶ c’est le même mot qui est utilisé en grec pour parler de l’humiliation de Marie : « Il a baissé les yeux sur l’humiliation de sa servante » ̶ son jugement a été levé et sa postérité, qui en parlera ? ». Donc, il a un texte où l’on parle de la postérité. Le type est seul sur son char, il va faire des jours de voyage, et Dieu vient mettre le doigt en plein où il a mal. Ta postérité, qui est-ce qui va en parler, un jour ? Non Seigneur, on ne veut pas de ça, pas de ça ! Ma postérité, c’est mon drame secret. C’est mon infirmité. C’est la question qui me travaille en permanence et quand je suis seul en silence, c’est ça qui me fait mal. « Ta postérité, qui en parlera ? » Et Dieu dit : c’est justement là que je vais te rejoindre. C’est dans cette question-là. Dans cette souffrance-là. Dans ce drame de ta vie. Dans ce qui fait, finalement, la vraie question de ton existence. Tu n’auras pas de postérité. Ton pouvoir c’est bien, ton avoir c’est bien, tout ça c’est bien, mais il y a une chose à côté de laquelle tu es en train de passer. Et Dieu lui dit ça et met le doigt en plein où ça fait mal, pour lui dire c’est là que je te rejoins et c’est là que je vais t’apporter la guérison. Et la guérison ce n’est pas qu’il aura une postérité. La guérison c’est qu’il va être investi par la grâce de Dieu en raison même de cette fêlure et c’est là qu’il va recevoir le baptême que Philippe va lui donner. Vous voyez, quelque part Dieu vient nous rejoindre, et c’est ça l’adoration eucharistique, on en reparlera tout à l’heure…
Deuxième remarque : Est-ce que le malade doit être guérit dans la Bible ? Comme être vivant ou mort, ce n’est pas tout à fait ce qu’on croit. Évidemment la frontière ne passe pas entre une santé physique ou psychique et une maladie physique ou psychique. Elle passe entre être avec Dieu ou être sans Dieu. Quand quelqu’un est avec Dieu, même s’il est malade il est en bonne santé, quelque part. Quand quelqu’un est mort avec Dieu, Dieu lui parle. Á Lazare, vous imaginez !, le frère de Marie-Madeleine. Ça fait quatre jours qu’il est au tombeau, ça sent déjà mauvais et Jésus lui dit : « Sors ! ». On ne parle pas aux morts ! Alors que, à Hérode qui vient lui poser des questions à sa Passion, il ne répond pas parce qu’il est déjà mort dans le cœur. Il y a des vivants qui sont morts, il y a des morts qui sont vivants. Et finalement la frontière n’est pas tout à fait là où on pense qu’elle est. Finalement, au cœur de tout ça, c’est la présence de Jésus. Quand Mère Teresa était malade à l’hôpital, pour une nouvelle crise cardiaque qu’elle venait de faire, le médecin hindou dit au prêtre qui était à côté de Mère Teresa : « Père, allez vite chercher la petite boîte ! ». Le prêtre dit : « La boîte de médicaments ? Quel médicament ? Quelle boîte ? ». « Mais non ! La petite boîte qu’ils apportent et qu’ils mettent dans sa chambre. Quand la boîte est là, Mère Teresa la regarde tout le temps. Si vous la mettez, l’apportez dans sa chambre, elle sera toute calme. » Le prêtre a compris qu’il s’agissait du Tabernacle, la Présence réelle. Et le médecin rajoute : « Quand cette boîte est là dans sa chambre elle ne fait que regarder, regarder, regarder encore cette boîte. » Et donc Mère Teresa avait la grâce d’avoir la Présence réelle dans sa chambre d’hôpital. Et quelque fois Dieu a des manières assez surprenantes de nous voir. Je prends un exemple : Dans les Actes des Apôtres vous savez qu’il y a cet eunuque éthiopien, premier ministre de la reine d’Éthiopie qui retourne chez lui depuis Jérusalem et qui est en train de lire, seul. Alors, il faut s’imaginer ce qu’est un eunuque. C’est une personne qui ne peut plus avoir d’enfant. Dans la tradition antique la postérité était capitale. C’était une façon d’exister socialement. C’est la seule façon d’exister. C’est une sorte de malédiction de ne pas avoir de descendance. Il avait tout le pouvoir politique qu’il voulait. Il avait la reconnaissance de la reine et des gens qui s’inclinent et lui font des courbettes. Mais fondamentalement son être humain est complètement atrophié et sa suite n’est pas là. Il est en train de lire un texte un peu particulier quand Philippe le rattrape. Ce texte que l’on retrouve dans les Actes des Apôtres et qui est une citation du prophète Isaïe : « Dans son humiliation, ̶ c’est le même mot qui est utilisé en grec pour parler de l’humiliation de Marie : « Il a baissé les yeux sur l’humiliation de sa servante » ̶ son jugement a été levé et sa postérité, qui en parlera ? ». Donc, il a un texte où l’on parle de la postérité. Le type est seul sur son char, il va faire des jours de voyage, et Dieu vient mettre le doigt en plein où il a mal. Ta postérité, qui est-ce qui va en parler, un jour ? Non Seigneur, on ne veut pas de ça, pas de ça ! Ma postérité, c’est mon drame secret. C’est mon infirmité. C’est la question qui me travaille en permanence et quand je suis seul en silence, c’est ça qui me fait mal. « Ta postérité, qui en parlera ? » Et Dieu dit : c’est justement là que je vais te rejoindre. C’est dans cette question-là. Dans cette souffrance-là. Dans ce drame de ta vie. Dans ce qui fait, finalement, la vraie question de ton existence. Tu n’auras pas de postérité. Ton pouvoir c’est bien, ton avoir c’est bien, tout ça c’est bien, mais il y a une chose à côté de laquelle tu es en train de passer. Et Dieu lui dit ça et met le doigt en plein où ça fait mal, pour lui dire c’est là que je te rejoins et c’est là que je vais t’apporter la guérison. Et la guérison ce n’est pas qu’il aura une postérité. La guérison c’est qu’il va être investi par la grâce de Dieu en raison même de cette fêlure et c’est là qu’il va recevoir le baptême que Philippe va lui donner. Vous voyez, quelque part Dieu vient nous rejoindre, et c’est ça l’adoration eucharistique, on en reparlera tout à l’heure…
 Troisième remarque : Je crois que l’adoration répond aussi à ce grand appel de Jésus : « Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau je vous soulagerai. Mettez-vous à mon école, prenez mon joug, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le soulagement. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Qu’est-ce que le joug dans la tradition antique et aujourd’hui encore d’ailleurs ? Le joug c’est ce qui permet d’unir deux animaux afin de labourer plus facilement le champ. Le joug n’est pas un fardeau qui pèse, le joug est un moyen d’alléger le travail, de rendre plus facile le travail. Si un bœuf laboure seul le champ, c’est difficile, s’ils sont deux, avec le copain à côté, le pote, avec le joug qui les unit, c’est plus facile. Le joug est une façon d’alléger l’épreuve et la souffrance. Jésus nous invite à venir nous unir et ce joug c’est l’Esprit Saint que Jésus nous donne en permanence au Saint Sacrement. Á sainte Gertrude d’Helphta Jésus disait : « Là, dans l’Eucharistie, dans la généreuse bonté de mon cœur, je guéris les blessures de tous les hommes, je procure le soulagement aux pécheurs, j’enrichis la pauvreté par les dons et les vertus, et je console chacun dans ses épreuves. » Il y a dans cette expérience que là, devant Jésus, je vais pouvoir trouver la guérison. Là, devant Jésus, je vais pouvoir venir déposer mon fardeau pour prendre son joug, c’est-à-dire avoir son secours et son aide qui, joints à ma propre responsabilité, mon propre effort, va me permettre de sortir de cette épreuve dans laquelle je suis plongé. D’être là avec ce cri : « Toi seul, Seigneur, peut me sauver ! » Saint Pierre dira : « Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que morts à nos péchés nous vivions pour la justice. Par ses blessures nous trouvons la guérison. » Et ce corps du Christ vivant ressuscité mais stigmatisé, on pourrait dire, dans l’humilité de la présence sous l’apparence du pain, est un lieu permanent de perfusion de l’Esprit Saint et de perfusion de la vie divine par nos propres fêlures qui passent par ses propres fêlures à Lui.
Troisième remarque : Je crois que l’adoration répond aussi à ce grand appel de Jésus : « Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau je vous soulagerai. Mettez-vous à mon école, prenez mon joug, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le soulagement. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Qu’est-ce que le joug dans la tradition antique et aujourd’hui encore d’ailleurs ? Le joug c’est ce qui permet d’unir deux animaux afin de labourer plus facilement le champ. Le joug n’est pas un fardeau qui pèse, le joug est un moyen d’alléger le travail, de rendre plus facile le travail. Si un bœuf laboure seul le champ, c’est difficile, s’ils sont deux, avec le copain à côté, le pote, avec le joug qui les unit, c’est plus facile. Le joug est une façon d’alléger l’épreuve et la souffrance. Jésus nous invite à venir nous unir et ce joug c’est l’Esprit Saint que Jésus nous donne en permanence au Saint Sacrement. Á sainte Gertrude d’Helphta Jésus disait : « Là, dans l’Eucharistie, dans la généreuse bonté de mon cœur, je guéris les blessures de tous les hommes, je procure le soulagement aux pécheurs, j’enrichis la pauvreté par les dons et les vertus, et je console chacun dans ses épreuves. » Il y a dans cette expérience que là, devant Jésus, je vais pouvoir trouver la guérison. Là, devant Jésus, je vais pouvoir venir déposer mon fardeau pour prendre son joug, c’est-à-dire avoir son secours et son aide qui, joints à ma propre responsabilité, mon propre effort, va me permettre de sortir de cette épreuve dans laquelle je suis plongé. D’être là avec ce cri : « Toi seul, Seigneur, peut me sauver ! » Saint Pierre dira : « Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que morts à nos péchés nous vivions pour la justice. Par ses blessures nous trouvons la guérison. » Et ce corps du Christ vivant ressuscité mais stigmatisé, on pourrait dire, dans l’humilité de la présence sous l’apparence du pain, est un lieu permanent de perfusion de l’Esprit Saint et de perfusion de la vie divine par nos propres fêlures qui passent par ses propres fêlures à Lui.
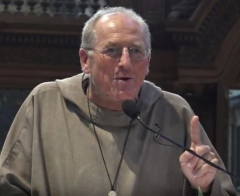 Un dernier point, quand même : Guérir ou soigner ? Un médecin ne peut pas guérir, il ne peut que soigner. Tout thérapeute ne peut que soigner. Il ne peut pas guérir. La guérison est un processus propre du corps, un processus qui ne peut revenir qu’à Dieu seul, quelque part. On peut faire en sorte que le corps aille mieux par une certaine thérapie, mais le processus de guérison est impossible. Il se fait par la dynamique propre de la vie qui m’habite. Dieu seul est capable de guérir. Un médecin peut soigner. Un thérapeute peut soigner. Mais Dieu seul peut guérir. Il n’y a pas de guérison en dehors de Dieu. On peut soigner, on peut « care » disent les anglais, on peut prendre soin, mais on ne peut pas guérir fondamentalement, puisque le processus de guérison ne dépend pas des médicaments ou de la thérapie, il dépend du processus propre, de dynamiques soit du corps, soit de la psychologie de la personne. Tous les thérapeutes en psychologie, en psychiatrie, savent bien que finalement s’il n’y a pas une collaboration de la personne, un oui de la personne, il n’y a pas de processus de guérison possible. Ultimement, c’est cet acquiescement de la personne qui va amener à ça.
Un dernier point, quand même : Guérir ou soigner ? Un médecin ne peut pas guérir, il ne peut que soigner. Tout thérapeute ne peut que soigner. Il ne peut pas guérir. La guérison est un processus propre du corps, un processus qui ne peut revenir qu’à Dieu seul, quelque part. On peut faire en sorte que le corps aille mieux par une certaine thérapie, mais le processus de guérison est impossible. Il se fait par la dynamique propre de la vie qui m’habite. Dieu seul est capable de guérir. Un médecin peut soigner. Un thérapeute peut soigner. Mais Dieu seul peut guérir. Il n’y a pas de guérison en dehors de Dieu. On peut soigner, on peut « care » disent les anglais, on peut prendre soin, mais on ne peut pas guérir fondamentalement, puisque le processus de guérison ne dépend pas des médicaments ou de la thérapie, il dépend du processus propre, de dynamiques soit du corps, soit de la psychologie de la personne. Tous les thérapeutes en psychologie, en psychiatrie, savent bien que finalement s’il n’y a pas une collaboration de la personne, un oui de la personne, il n’y a pas de processus de guérison possible. Ultimement, c’est cet acquiescement de la personne qui va amener à ça.
 Déjà les juifs avaient compris que tout ce mystère se jouait autour du pain, puisqu’il y avait un pain particulier, un pain azyme, la matsa shemoura, qui était un pain extrêmement important. « Matsa » c’est le pain azyme, « shemoura » veut dire surveiller. On surveillait attentivement toute la fabrication et toute la cuisson et puis là, autour… Ce pain était servi dans le remake, ou l’after de Pâque et on dit que c’était le pain de la foi et de la guérison. Déjà dans la tradition juive on avait l’idée qu’autour du pain de la foi se jouait la guérison.
Déjà les juifs avaient compris que tout ce mystère se jouait autour du pain, puisqu’il y avait un pain particulier, un pain azyme, la matsa shemoura, qui était un pain extrêmement important. « Matsa » c’est le pain azyme, « shemoura » veut dire surveiller. On surveillait attentivement toute la fabrication et toute la cuisson et puis là, autour… Ce pain était servi dans le remake, ou l’after de Pâque et on dit que c’était le pain de la foi et de la guérison. Déjà dans la tradition juive on avait l’idée qu’autour du pain de la foi se jouait la guérison.
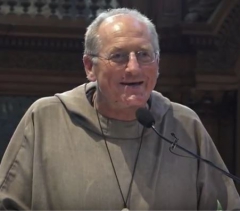 Donc Jésus est présent, Jésus est là, il est présent partout, c’est sûr… Un jour on demandait à une classe d’enfants : « Où est Jésus ? » « - Dans mon cœur ! » Un autre dit : « Á l’église, au Tabernacle ! » « - Oui, très bien ! » « - Au milieu de nous, quand deux ou trois sont réunis en son nom ! » « Très bien ! » « - Moi monsieur, moi monsieur, j’sais ! » « - Il est où ? » « - Á la salle de bain ! » « - Á la salle de bain ! ?? Pourquoi tu dis ça ? » « Ben, chaque matin quand maman fait sa toilette et que papa est devant la porte il tape, il tape et il dit : « Bon Dieu ! T’es encore là ! ». Non, Dieu n’est pas étranger à nos vies, mais il y a un lieu dans lequel Il veut être, corporellement présent et c’est ça qui change tout, corporellement présent, c’est au Saint Sacrement. Il est là réellement, spirituellement et corporellement. Charnellement présent, réellement présent.
Donc Jésus est présent, Jésus est là, il est présent partout, c’est sûr… Un jour on demandait à une classe d’enfants : « Où est Jésus ? » « - Dans mon cœur ! » Un autre dit : « Á l’église, au Tabernacle ! » « - Oui, très bien ! » « - Au milieu de nous, quand deux ou trois sont réunis en son nom ! » « Très bien ! » « - Moi monsieur, moi monsieur, j’sais ! » « - Il est où ? » « - Á la salle de bain ! » « - Á la salle de bain ! ?? Pourquoi tu dis ça ? » « Ben, chaque matin quand maman fait sa toilette et que papa est devant la porte il tape, il tape et il dit : « Bon Dieu ! T’es encore là ! ». Non, Dieu n’est pas étranger à nos vies, mais il y a un lieu dans lequel Il veut être, corporellement présent et c’est ça qui change tout, corporellement présent, c’est au Saint Sacrement. Il est là réellement, spirituellement et corporellement. Charnellement présent, réellement présent.
Alors, j’aimerais voir quatre aspects, rapidement. Le premier aspect est un aspect plus théologique : Comment l’Eucharistie devient un lieu de guérison. Deuxièmement un aspect plus anthropologique, humain : Comment l’Eucharistie est un lieu de guérison très personnel, très concret. Troisièmement : Comment l’Eucharistie peut être une guérison politique, économique, cosmique, si j’ose dire. Et dernièrement : Comment l’Eucharistie est déjà une préfiguration de la guérison ultime qu’est la parousie, la venue en gloire du Christ.
 Le premier point. Comment l’adoration eucharistique est au cœur du drame de l’humanité. Le drame de l’humanité c’est le péché. La folie d’amour de Dieu c’est la création, c’est la rédemption qui va s’en suivre, bien sûr, mais le drame, c’est le péché. Et le péché, nous dit saint Thomas d’Aquin, c’est se détourner de Dieu pour se tourner vers la créature. C’est ce mouvement fou de l’homme qui préfère la créature au Créateur. Ou qui n’aime pas les créatures sous le regard du Créateur. Parce qu’il ne s’agit pas de rejeter la créature mais de voir les créatures en tant que don du Créateur et de voir le Créateur toujours là en premier. Comme dit le vieux proverbe chinois : « Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt. » Ou alors, dans une classe, on demande : Mais d’où vient le lait ? Et un enfant dit du berlingot, de la brique. Oui, c’est vrai, mais il y a peut-être une vache derrière… Donc, nous sommes un peu bloqués sur les créatures sans voir qu’il y a un Créateur derrière. Alors, l’adoration va se mettre là : quand nous nous mettons en adoration, nous proclamons la source, nous proclamons Dieu. Nous renversons ce mouvement du péché qui est de préférer la créature au Créateur pour dire que je préfère le Créateur et le Rédempteur à la créature. Je viens affirmer de manière profonde et forte que le Créateur est au cœur de ma vie, de mon existence. Le péché me replie sur moi-même, l’adoration, disait le pape Benoît XVI, est une extase, une sortie de soi, là où les yeux m’amènent. Il y a un grand guide de montagne, René Desmaison, qui répondait à pourquoi vous êtes monté sur des montagnes, à faire des choses folles ? Il disait : « Je voulais marcher là où mes yeux me portaient. » Je voulais poser mes pieds là où mes yeux m’avaient attiré. Eh bien, voyez-vous, l’adoration, c’est ça : je regarde Jésus. Et je veux être là où est celui que je contemple. Je suis en extase de moi-même qui me met en exode de moi-même. Benoît XVI va dire : « L’extase initiale se traduit dans un pèlerinage, un exode permanent allant du je enfermé sur lui-même vers sa libération dans le don de soi. Et précisément ainsi vers la découverte de soi, plus encore, vers la découverte de Dieu. » Donc de l’exode à l’extase. Et de l’extase à l’exode. Je sors de moi, je suis en sortie de moi vers ce Dieu. Ça c’est le renversement du mouvement du péché. Le péché. Le péché me replie sur moi-même, me replie sur mon ego, m’enferme en moi-même dans l’enfermement, ̶ et dans enfermement il y a l’enfer aussi, vous voyez, une fermeture totale. Ça c’est le drame qui peut s’exprimer de manière spirituelle, de manière psychique, psychologique, de manière égoïste, pécamineuse, sans souci de l’autre et Dieu va briser ce mouvement pour me mettre hors de moi. Le pape François disait : « C’est dans le don de soi, dans le fait de sortir de soi-même que se trouve la véritable joie et que par l’amour de Dieu, le Christ, lui, a vaincu le mal. » Même des gens comme Boris Cyrulnik, psychiatre athée, d’origine juive, qui dit, mais écoutez : « La seule guérison possible dans les grands traumatismes c’est de sortir de soi et de regarder à l’extérieur. » Ce que le bon sens a compris, l’Eucharistie nous permet de le vivre, l’adoration eucharistique nous permet de le vivre. Sortir dans un exode qui nous tourne vers le Rédempteur qui est là, qui lui-même nous envoie vers les plaies de nos frères et sœurs. Un petit enfant disait un jour : « Cher Dieu, ça doit être difficile pour toi d’aimer toutes les personnes du monde. Il n’y en a que quatre dans notre famille et je n’y arrive jamais ! » Dieu nous amène à partir de cette extase vers Lui dans un exode et de l’exode vers Lui, un mouvement, se mettre en route, sortir de ma terre pour aller vers la terre de Dieu, sa terre charnelle qui est Présence au Saint Sacrement, et de là, aller vers la chair de mes frères et sœurs souffrants pour semer cet amour que Lui-même me donne.
Le premier point. Comment l’adoration eucharistique est au cœur du drame de l’humanité. Le drame de l’humanité c’est le péché. La folie d’amour de Dieu c’est la création, c’est la rédemption qui va s’en suivre, bien sûr, mais le drame, c’est le péché. Et le péché, nous dit saint Thomas d’Aquin, c’est se détourner de Dieu pour se tourner vers la créature. C’est ce mouvement fou de l’homme qui préfère la créature au Créateur. Ou qui n’aime pas les créatures sous le regard du Créateur. Parce qu’il ne s’agit pas de rejeter la créature mais de voir les créatures en tant que don du Créateur et de voir le Créateur toujours là en premier. Comme dit le vieux proverbe chinois : « Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt. » Ou alors, dans une classe, on demande : Mais d’où vient le lait ? Et un enfant dit du berlingot, de la brique. Oui, c’est vrai, mais il y a peut-être une vache derrière… Donc, nous sommes un peu bloqués sur les créatures sans voir qu’il y a un Créateur derrière. Alors, l’adoration va se mettre là : quand nous nous mettons en adoration, nous proclamons la source, nous proclamons Dieu. Nous renversons ce mouvement du péché qui est de préférer la créature au Créateur pour dire que je préfère le Créateur et le Rédempteur à la créature. Je viens affirmer de manière profonde et forte que le Créateur est au cœur de ma vie, de mon existence. Le péché me replie sur moi-même, l’adoration, disait le pape Benoît XVI, est une extase, une sortie de soi, là où les yeux m’amènent. Il y a un grand guide de montagne, René Desmaison, qui répondait à pourquoi vous êtes monté sur des montagnes, à faire des choses folles ? Il disait : « Je voulais marcher là où mes yeux me portaient. » Je voulais poser mes pieds là où mes yeux m’avaient attiré. Eh bien, voyez-vous, l’adoration, c’est ça : je regarde Jésus. Et je veux être là où est celui que je contemple. Je suis en extase de moi-même qui me met en exode de moi-même. Benoît XVI va dire : « L’extase initiale se traduit dans un pèlerinage, un exode permanent allant du je enfermé sur lui-même vers sa libération dans le don de soi. Et précisément ainsi vers la découverte de soi, plus encore, vers la découverte de Dieu. » Donc de l’exode à l’extase. Et de l’extase à l’exode. Je sors de moi, je suis en sortie de moi vers ce Dieu. Ça c’est le renversement du mouvement du péché. Le péché. Le péché me replie sur moi-même, me replie sur mon ego, m’enferme en moi-même dans l’enfermement, ̶ et dans enfermement il y a l’enfer aussi, vous voyez, une fermeture totale. Ça c’est le drame qui peut s’exprimer de manière spirituelle, de manière psychique, psychologique, de manière égoïste, pécamineuse, sans souci de l’autre et Dieu va briser ce mouvement pour me mettre hors de moi. Le pape François disait : « C’est dans le don de soi, dans le fait de sortir de soi-même que se trouve la véritable joie et que par l’amour de Dieu, le Christ, lui, a vaincu le mal. » Même des gens comme Boris Cyrulnik, psychiatre athée, d’origine juive, qui dit, mais écoutez : « La seule guérison possible dans les grands traumatismes c’est de sortir de soi et de regarder à l’extérieur. » Ce que le bon sens a compris, l’Eucharistie nous permet de le vivre, l’adoration eucharistique nous permet de le vivre. Sortir dans un exode qui nous tourne vers le Rédempteur qui est là, qui lui-même nous envoie vers les plaies de nos frères et sœurs. Un petit enfant disait un jour : « Cher Dieu, ça doit être difficile pour toi d’aimer toutes les personnes du monde. Il n’y en a que quatre dans notre famille et je n’y arrive jamais ! » Dieu nous amène à partir de cette extase vers Lui dans un exode et de l’exode vers Lui, un mouvement, se mettre en route, sortir de ma terre pour aller vers la terre de Dieu, sa terre charnelle qui est Présence au Saint Sacrement, et de là, aller vers la chair de mes frères et sœurs souffrants pour semer cet amour que Lui-même me donne.
 Deuxième aspect important, théologique : Vous savez que l’on dit que l’Eucharistie est la prolongation de l’action de grâce pour la communion et la préparation dans le désir de la communion suivante. Ce qui est vrai théologiquement. Mais Benoît XVI avait souligné un aspect très important. Il disait déjà que, d’un point de vue naturel, l’homme est appelé à vivre dans la justice, qui est une vertu, et la justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Or, il y a un premier élément constitutif de la vertu de justice, qui s’appelle la vertu de religion. D’un point de vue philosophique les grecs en ont parlé quatre siècles avant Jésus-Christ, soit cinq siècles, même, qui consiste à rendre à Dieu un culte d’adoration, d’action de grâce et de louange car il est la source de tout bien et à cette hauteur de tous les biens, on va lui rendre l’adoration, l’action de grâce et la louange qui lui est due. Eh bien voyez-vous, l’adoration eucharistique permet de remplir ce devoir fondamental de l’être humain à l’égard de son Dieu Créateur, de lui rendre ce qui lui est dû : l’adoration, la louange et l’action de grâce. De sorte que Benoît XVI pouvait même dire que, quelque part, avant même, du point de vue non pas de l’ordre chronologique, où l’Eucharistie, la messe, précède l’adoration, mais du point de vue de l’excellence, l’adoration précède encore tout. Et l’adoration est l’accomplissement du devoir premier du cœur de l’homme, en justice. Et je crois que c’est important de revenir à cela.
Deuxième aspect important, théologique : Vous savez que l’on dit que l’Eucharistie est la prolongation de l’action de grâce pour la communion et la préparation dans le désir de la communion suivante. Ce qui est vrai théologiquement. Mais Benoît XVI avait souligné un aspect très important. Il disait déjà que, d’un point de vue naturel, l’homme est appelé à vivre dans la justice, qui est une vertu, et la justice consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû. Or, il y a un premier élément constitutif de la vertu de justice, qui s’appelle la vertu de religion. D’un point de vue philosophique les grecs en ont parlé quatre siècles avant Jésus-Christ, soit cinq siècles, même, qui consiste à rendre à Dieu un culte d’adoration, d’action de grâce et de louange car il est la source de tout bien et à cette hauteur de tous les biens, on va lui rendre l’adoration, l’action de grâce et la louange qui lui est due. Eh bien voyez-vous, l’adoration eucharistique permet de remplir ce devoir fondamental de l’être humain à l’égard de son Dieu Créateur, de lui rendre ce qui lui est dû : l’adoration, la louange et l’action de grâce. De sorte que Benoît XVI pouvait même dire que, quelque part, avant même, du point de vue non pas de l’ordre chronologique, où l’Eucharistie, la messe, précède l’adoration, mais du point de vue de l’excellence, l’adoration précède encore tout. Et l’adoration est l’accomplissement du devoir premier du cœur de l’homme, en justice. Et je crois que c’est important de revenir à cela.
 Saint Augustin disait que « personne ne mange cette chair sans auparavant l’avoir adorée. Nous pécherions si nous ne l’adorions pas. » Alors lui il l’entendait de manière très concrète puisqu’on communiait dans la main. On va recevoir le corps du Christ, on va L’adorer avant de Le porter à sa bouche. C’est ce que disait saint Augustin dans cette façon de faire. Mais profondément, cite Benoît XVI, il va faire précéder dans l’ordre de l’excellence l’adoration par rapport au reste pour montrer que c’est le premier devoir de l’être humain, en justice, que de dire : « Mais Dieu, Tu es mon Seigneur et mon Tout ! » Et donc de s’amener vers la gratitude et l’action de grâce, de dire merci. De dire merci à Dieu. C’est le mot efcharisto. Eucharistie ça veut dire merci. C’est l’attitude de l’homme qui dit merci, tout bien vient de Toi. L’ingratitude, l’acharistia en grec, est une catastrophe. Et l’eucharistia est le chemin de la délivrance. Même psychologiquement, aussi aujourd’hui. On se rend compte que la chose la plus importante pour vivre, dans la psychologie positive, c’est de dire merci, d’être dans l’action de grâce. Ceux qui rouspètent tout le temps, ceux qui marmonnent tout le temps, ceux qui sont dans la plainte tout le temps, dans le murmure, eh bien, c’est une tragédie. Le peuple hébreu quand il a commencé à murmurer, plutôt que de traverser le désert en quarante jours a mis quarante ans. Ce n’est pas très agréable, ça fait un peu plus long, vous voyez. Refusant l’eucharistie, ils sont enfermés dans l’acharistia et donc se sont retrouvés dans cette tragédie du murmure perpétuel. Eh bien, l’adoration eucharistique nous sort et nous disons : « Merci à toi Jésus, Gloire à Toi, Gloire à Toi ! » Donc, de sorte qu’à l’adoration on ne commence pas par soi mais on commence par le Christ : Ô Jésus, Toi, Toi, Toi… Vous voyez, ce mouvement de sortie de soi. Il y a un très beau conte soufi de la tradition mystique musulmane : c’est un fiancé qui rentre d’un long voyage et il se réjouit de rencontrer sa fiancée. Il frappe à la porte et la voix aimée à l’intérieur dit : « Mais qui est-ce ? » Il dit : « C’est moi, je suis ton fiancé, ça y est, je suis revenu ! C’est moi ! » La porte ne s’ouvre pas. Il se dit : « Mais ce n’est pas possible ! Elle n’a pas pu m’oublier, elle n’a pas pu m’abandonner… » Alors, il va dans le désert, il prie, il réfléchit, il jeûne. Il revient quelques jours plus tard, il frappe à la porte. La même voix aimée, dedans, dit : « Qui est-ce ? » Il dit : « C’est moi, je suis ton bien-aimé, je suis ton fiancé, je suis revenu du long voyage. Ouvre-moi ! » Et la porte ne s’ouvre pas. Alors il repart dans le désert, il prie, il jeûne, il réfléchit et il revient. Une troisième fois il frappe à la porte. La même voix aimée : « Mais qui est-ce ? » Á ce moment-là il va dire : « C’est toi, ma bien-aimée, c’est toi ! » Et la porte s’ouvre. Vous voyez, l’adoration eucharistique nous fait passer du moi à toi. Un philosophe juif et poète à sa manière, Martin Buber, a fait un poème extraordinaire. Du, qui veut dire en allemand toi. En haut Toi, en bas Toi, à gauche Toi, au-dessus Toi, dans le malheur Toi, dans la joie Toi, Toi, Toi, Toi, rien que Toi, uniquement Toi. Eh bien l’adoration c’est ça, voyez-vous… Je passe du je au Toi.
Saint Augustin disait que « personne ne mange cette chair sans auparavant l’avoir adorée. Nous pécherions si nous ne l’adorions pas. » Alors lui il l’entendait de manière très concrète puisqu’on communiait dans la main. On va recevoir le corps du Christ, on va L’adorer avant de Le porter à sa bouche. C’est ce que disait saint Augustin dans cette façon de faire. Mais profondément, cite Benoît XVI, il va faire précéder dans l’ordre de l’excellence l’adoration par rapport au reste pour montrer que c’est le premier devoir de l’être humain, en justice, que de dire : « Mais Dieu, Tu es mon Seigneur et mon Tout ! » Et donc de s’amener vers la gratitude et l’action de grâce, de dire merci. De dire merci à Dieu. C’est le mot efcharisto. Eucharistie ça veut dire merci. C’est l’attitude de l’homme qui dit merci, tout bien vient de Toi. L’ingratitude, l’acharistia en grec, est une catastrophe. Et l’eucharistia est le chemin de la délivrance. Même psychologiquement, aussi aujourd’hui. On se rend compte que la chose la plus importante pour vivre, dans la psychologie positive, c’est de dire merci, d’être dans l’action de grâce. Ceux qui rouspètent tout le temps, ceux qui marmonnent tout le temps, ceux qui sont dans la plainte tout le temps, dans le murmure, eh bien, c’est une tragédie. Le peuple hébreu quand il a commencé à murmurer, plutôt que de traverser le désert en quarante jours a mis quarante ans. Ce n’est pas très agréable, ça fait un peu plus long, vous voyez. Refusant l’eucharistie, ils sont enfermés dans l’acharistia et donc se sont retrouvés dans cette tragédie du murmure perpétuel. Eh bien, l’adoration eucharistique nous sort et nous disons : « Merci à toi Jésus, Gloire à Toi, Gloire à Toi ! » Donc, de sorte qu’à l’adoration on ne commence pas par soi mais on commence par le Christ : Ô Jésus, Toi, Toi, Toi… Vous voyez, ce mouvement de sortie de soi. Il y a un très beau conte soufi de la tradition mystique musulmane : c’est un fiancé qui rentre d’un long voyage et il se réjouit de rencontrer sa fiancée. Il frappe à la porte et la voix aimée à l’intérieur dit : « Mais qui est-ce ? » Il dit : « C’est moi, je suis ton fiancé, ça y est, je suis revenu ! C’est moi ! » La porte ne s’ouvre pas. Il se dit : « Mais ce n’est pas possible ! Elle n’a pas pu m’oublier, elle n’a pas pu m’abandonner… » Alors, il va dans le désert, il prie, il réfléchit, il jeûne. Il revient quelques jours plus tard, il frappe à la porte. La même voix aimée, dedans, dit : « Qui est-ce ? » Il dit : « C’est moi, je suis ton bien-aimé, je suis ton fiancé, je suis revenu du long voyage. Ouvre-moi ! » Et la porte ne s’ouvre pas. Alors il repart dans le désert, il prie, il jeûne, il réfléchit et il revient. Une troisième fois il frappe à la porte. La même voix aimée : « Mais qui est-ce ? » Á ce moment-là il va dire : « C’est toi, ma bien-aimée, c’est toi ! » Et la porte s’ouvre. Vous voyez, l’adoration eucharistique nous fait passer du moi à toi. Un philosophe juif et poète à sa manière, Martin Buber, a fait un poème extraordinaire. Du, qui veut dire en allemand toi. En haut Toi, en bas Toi, à gauche Toi, au-dessus Toi, dans le malheur Toi, dans la joie Toi, Toi, Toi, Toi, rien que Toi, uniquement Toi. Eh bien l’adoration c’est ça, voyez-vous… Je passe du je au Toi.
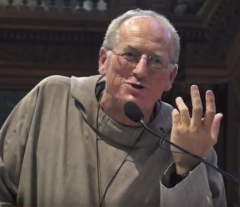 Peut-être un autre point très important dans l’adoration eucharistique, que j’aimerais soulever… Saint Thomas d’Aquin nous dit qu’il y a deux drames qui rongent le cœur de l’homme. C’est la présomption et le désespoir. La présomption c’est croire qu’on peut faire par nous-même les choses. Et le désespoir, c’est se retrouver dans cette pauvreté, cette vulnérabilité où on ne sait plus où donner de la tête, jusqu’à la dépression. Et saint Thomas d’Aquin dit que la présomption et le désespoir sont les deux péchés contre la vertu d’espérance. Ah, c’est intéressant, la vertu d’espérance ! Et l’espérance, dit-il, se nourrit de la prière. Et la prière en particulier du Notre Père qui es au cieux. Or, saint Paul nous dit que personne ne peut dire Abba, Père, sans la puissance de l’Esprit Saint. Or, il se trouve une chose incroyable : l’Eucharistie est justement le lieu de la pentecôte perpétuelle. Saint Jean Chrysostome, un père de l’Église, disait que, à l’origine, la Pentecôte n’était pas qu’un fait initial, c’était un mouvement qui avait été inauguré une fois et que Dieu ne cessait pas de donner l’Esprit Saint, et que l’Esprit Saint est un jaillissement permanent du Cœur eucharistique de Jésus. Il y a deux Pentecôte, on les connaît tous : celle de saint Luc dans les Actes des Apôtres cinquante jours après Pâque, où une flamme arrive, où l’Esprit Saint arrive, de grands signes et de grands phénomènes, avec les flammes sur la tête des apôtres. Ils sortent, Pierre fait un sermon et trois mille conversions. Un ami prêtre m’a dit un jour : « Tu te rends compte ! Un sermon, trois mille conversions ! Moi, trois mille sermons et pas une conversion ! » Je dis : « Non… Le Seigneur travaille quand même, pas de souci ! » Voilà. Et il y a une Pentecôte dont on parle moins, c’est la Pentecôte de saint Jean. Saint Jean ne situe pas la Pentecôte de la même manière que saint Luc, mais pour Jean la Pentecôte est immédiatement à la Croix. Au dernier jour de la fête de Soukkot, la fête des Tentes, où le peuple juif vivait sous des tentes en dehors de leur maison, rappelant le séjour au désert, le dernier jour il y avait un rite particulier où le grand prêtre descendait à la fontaine de Siloé, qui était la seule fontaine jaillissante d’eau vie à Jérusalem. Le reste c’était des puits. Il allait chercher l’eau vive, l’amenait sur l’autel du Temple pour verser l’eau en offrande. Et à ce moment-là, dans une acclamation, ̶ le commentaire du Talmud dit qui n’a pas vu la joie de la fête de l’eau qui clôt la fête des Tentes ne peut pas connaître la joie. C’était l’apothéose de la joie. Et Jésus crie à ce moment-là : « Si quelqu’un a soif qu’il vienne à moi, car il est écrit de son sein jaillira l’eau vive. Il parlait de l’Esprit Saint qui jaillirait de son côté, à sa glorification », c’est-à-dire au moment de la Pâque. Donc, pour saint Jean le Cœur ouvert du Christ est la Pentecôte. Or, le Cœur du Christ ne cesse de palpiter au Saint Sacrement. Et l’Esprit Saint ne cesse d’être donné. De sorte que, en l’adoration eucharistique, Dieu vient me libérer de la présomption et du désespoir. Qui suis-je pour, pardonnez-moi l’expression un peu directe, me la péter devant le Bon Dieu, au Saint Sacrement ? Qui suis-je pour avoir quelque sentiment d’orgueil devant Jésus au Saint Sacrement ? Lui, le Tout-puissant s’est fait dans une telle vulnérabilité, sous l’apparence d’un bout de pain inerte, et c’est Dieu qui est là. Et en même temps qui suis-je pour désespérer, puisque la grâce m’est donnée. Puisqu’Il s’est revêtu de mon humanité, Il a pris l’humilité de descendre et vient aux tréfonds me rechercher et m’empoigner. On a accueilli une fille chez nous qui avait fait cinq tentatives de suicides, des violences extrêmes, la drogue depuis douze ans, son copain était un dealer qui s’est fait assassiné, dans la rue comme ça… Enfin voilà, c’était vraiment un truc incroyable. Et quand elle a débarqué chez nous, elle était en hôpital psychiatrique juste avant. Elle avait fracassé l’infirmière qui était venue lui faire une piqûre de calmants, du coup l’infirmière avait dû être hospitalisée pour coups et blessures. Elle avait quinze ans, on ne savait plus que faire d’elle. Alors on l’a amenée chez nous. Un jour elle a pété les plombs, c’était horrible. Et puis elle me dit : « J’me casse ! » J’dis : « Écoute, de toute façon il n’y a plus personne qui peut te supporter ici, donc… Mais avant, on cause. » Et puis elle me dit : « J’ai pas envie de parler avec toi, tu dégages, connard ! » Très bien. Alors j’dis : « Mais on cause. » Alors je la poursuis, j’arrive à la chambre, elle m’envoie la porte à la figure, je bloque la porte. Je dis : « Écoute, j’ai dit qu’on causait ! » Elle me dit : « T’as pas l’droit de rentrer ici ! » J’dis : « Écoute, c’est ni chez toi, ni chez moi, c’est chez le Bon Dieu, donc on est chez le Bon Dieu tous les deux. » Elle commence à faire sa valise. Á ce moment-là je ferme la valise, je m’assieds dessus, j’dis : « J’t’ai dit qu’on causait avant que tu te casses, quoi ! » Et là, elle vient vers moi avec le poing comme ça, vous savez… Alors j’enlève vite mes lunettes parce que j’me dis qu’il vaut mieux un œil au beurre noir qu’un œil crevé. Et elle s’arrête à ça de moi avec le poing ! J’étais très content, d’ailleurs. Et elle me dit : « Mais pourquoi je suis comme ça, Nicolas ? » « Ah !, j’dis, ça c’est une très bonne question, assied-toi. » On a passé un long moment à discuter, et puis à la fin, elle me dit : « J’fais quoi, maintenant ? » « Si tu veux t’casser, tu veux t’casser… Á moins que tu aies une autre idée, maintenant. » « Tu veux que j’aille où ? » J’dis : « J’suis tout à fait d’accord avec toi, à part la rue, tu n’as rien. » Elle me dit : « Tu m’gardes encore ici ? » J’dis : « Ouais ! Mais à une condition. C’est que quand tu pètes les plombs, tu vas à la chapelle. » Elle me dit : « Non ! mais moi je n’y crois pas à ton machin de Jésus, avec ton machin blanc, là ! J’y crois rien ! » J’dis : « C’est pas ça que je t’ai dit. Je t’ai dit : Il n’y en a qu’un seul qui te supporte ici, c’est Jésus. Et la chapelle est insonorisée. Et il n’y a personne qui te supporte, par ailleurs. Donc, quand tu as envie de péter les plombs, tu vas chez Jésus péter les plombs. D’abord on n’entend pas, ensuite c’est Lui qui te supportera. » Et elle faisait ça très gentiment d’ailleurs, par obéissance. Et un jour, elle sortait de la chapelle, je la vois arriver. Je passais juste devant la chapelle à ce moment-là, c’est vraiment providentiel et elle me dit : « Aïe ! Aïe ! Nicolas ! » J’dis : « Quoi ? » « - Le cœur !... » J’dis : « Saute dans la voiture, on part à l’hôpital tout de suite ! » Je me suis dit, avec toutes les substances qu’elle a prises, le cœur est en train de… Elle dit : « Non, c’est pas ça, c’est l’amour de Jésus ! » « Ah, j’dis, c’est bon ! » Elle me dit : « Tu vois, j’ai dit à Jésus : Tu as une heure, montre suisse en main, tu as une heure pour me dire si tu existes ou pas. Soit tu existes et tu fais quelque chose, soit, s’il n’y a pas de réponse, je vais me suicider. Peut-être, si tu existes, on se retrouvera de l’autre côté. Mais moi je ne supporte plus la vie comme ça. » Elle s’est mise à genoux, une heure montre en main. Après une heure, elle s’est levée et elle a dit : « Tu n’m’as rien dit. Peut-être qu’on se reverra de l’autre côté, si tu existes. » Et à ce moment-là elle me dit : « Je ne sais pas ce qui s’est passé Nicolas, j’ai senti mon cœur brûler, je me suis effondrée au pied du… Elle était à ça de Jésus ! Á ça de l’ostensoir, au bord de l’autel, comme ça ! Elle a dit : « J’l’ai pas quitté des yeux, hein ! J’te lâche pas ! J’te lâche pas les baskets ! » Elle m’a dit : « J’me suis effondrée là, je sors maintenant de la chapelle. Il m’a dit qu’Il existait et qu’Il m’aimait. » Elle avait des médocs à n’en plus finir. On a fait le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Elle a fait un chemin comme ça. Bref, elle a fait son Bac, elle a terminé son Master en Sciences Po, croyante et tout… Avec cette expérience du Christ qui vient sauver, qui vient regarder. Tout d’un coup, entre la présomption et le désespoir, il y a le cœur de l’enfant de Dieu qui nous est restitué par l’effusion de l’Esprit Saint jaillissant du Cœur eucharistique du Christ. De sorte qu’il y a cette Pentecôte permanente qui est là, et qui fait que tout d’un coup je peux venir à ce Cœur miséricordieux.
Peut-être un autre point très important dans l’adoration eucharistique, que j’aimerais soulever… Saint Thomas d’Aquin nous dit qu’il y a deux drames qui rongent le cœur de l’homme. C’est la présomption et le désespoir. La présomption c’est croire qu’on peut faire par nous-même les choses. Et le désespoir, c’est se retrouver dans cette pauvreté, cette vulnérabilité où on ne sait plus où donner de la tête, jusqu’à la dépression. Et saint Thomas d’Aquin dit que la présomption et le désespoir sont les deux péchés contre la vertu d’espérance. Ah, c’est intéressant, la vertu d’espérance ! Et l’espérance, dit-il, se nourrit de la prière. Et la prière en particulier du Notre Père qui es au cieux. Or, saint Paul nous dit que personne ne peut dire Abba, Père, sans la puissance de l’Esprit Saint. Or, il se trouve une chose incroyable : l’Eucharistie est justement le lieu de la pentecôte perpétuelle. Saint Jean Chrysostome, un père de l’Église, disait que, à l’origine, la Pentecôte n’était pas qu’un fait initial, c’était un mouvement qui avait été inauguré une fois et que Dieu ne cessait pas de donner l’Esprit Saint, et que l’Esprit Saint est un jaillissement permanent du Cœur eucharistique de Jésus. Il y a deux Pentecôte, on les connaît tous : celle de saint Luc dans les Actes des Apôtres cinquante jours après Pâque, où une flamme arrive, où l’Esprit Saint arrive, de grands signes et de grands phénomènes, avec les flammes sur la tête des apôtres. Ils sortent, Pierre fait un sermon et trois mille conversions. Un ami prêtre m’a dit un jour : « Tu te rends compte ! Un sermon, trois mille conversions ! Moi, trois mille sermons et pas une conversion ! » Je dis : « Non… Le Seigneur travaille quand même, pas de souci ! » Voilà. Et il y a une Pentecôte dont on parle moins, c’est la Pentecôte de saint Jean. Saint Jean ne situe pas la Pentecôte de la même manière que saint Luc, mais pour Jean la Pentecôte est immédiatement à la Croix. Au dernier jour de la fête de Soukkot, la fête des Tentes, où le peuple juif vivait sous des tentes en dehors de leur maison, rappelant le séjour au désert, le dernier jour il y avait un rite particulier où le grand prêtre descendait à la fontaine de Siloé, qui était la seule fontaine jaillissante d’eau vie à Jérusalem. Le reste c’était des puits. Il allait chercher l’eau vive, l’amenait sur l’autel du Temple pour verser l’eau en offrande. Et à ce moment-là, dans une acclamation, ̶ le commentaire du Talmud dit qui n’a pas vu la joie de la fête de l’eau qui clôt la fête des Tentes ne peut pas connaître la joie. C’était l’apothéose de la joie. Et Jésus crie à ce moment-là : « Si quelqu’un a soif qu’il vienne à moi, car il est écrit de son sein jaillira l’eau vive. Il parlait de l’Esprit Saint qui jaillirait de son côté, à sa glorification », c’est-à-dire au moment de la Pâque. Donc, pour saint Jean le Cœur ouvert du Christ est la Pentecôte. Or, le Cœur du Christ ne cesse de palpiter au Saint Sacrement. Et l’Esprit Saint ne cesse d’être donné. De sorte que, en l’adoration eucharistique, Dieu vient me libérer de la présomption et du désespoir. Qui suis-je pour, pardonnez-moi l’expression un peu directe, me la péter devant le Bon Dieu, au Saint Sacrement ? Qui suis-je pour avoir quelque sentiment d’orgueil devant Jésus au Saint Sacrement ? Lui, le Tout-puissant s’est fait dans une telle vulnérabilité, sous l’apparence d’un bout de pain inerte, et c’est Dieu qui est là. Et en même temps qui suis-je pour désespérer, puisque la grâce m’est donnée. Puisqu’Il s’est revêtu de mon humanité, Il a pris l’humilité de descendre et vient aux tréfonds me rechercher et m’empoigner. On a accueilli une fille chez nous qui avait fait cinq tentatives de suicides, des violences extrêmes, la drogue depuis douze ans, son copain était un dealer qui s’est fait assassiné, dans la rue comme ça… Enfin voilà, c’était vraiment un truc incroyable. Et quand elle a débarqué chez nous, elle était en hôpital psychiatrique juste avant. Elle avait fracassé l’infirmière qui était venue lui faire une piqûre de calmants, du coup l’infirmière avait dû être hospitalisée pour coups et blessures. Elle avait quinze ans, on ne savait plus que faire d’elle. Alors on l’a amenée chez nous. Un jour elle a pété les plombs, c’était horrible. Et puis elle me dit : « J’me casse ! » J’dis : « Écoute, de toute façon il n’y a plus personne qui peut te supporter ici, donc… Mais avant, on cause. » Et puis elle me dit : « J’ai pas envie de parler avec toi, tu dégages, connard ! » Très bien. Alors j’dis : « Mais on cause. » Alors je la poursuis, j’arrive à la chambre, elle m’envoie la porte à la figure, je bloque la porte. Je dis : « Écoute, j’ai dit qu’on causait ! » Elle me dit : « T’as pas l’droit de rentrer ici ! » J’dis : « Écoute, c’est ni chez toi, ni chez moi, c’est chez le Bon Dieu, donc on est chez le Bon Dieu tous les deux. » Elle commence à faire sa valise. Á ce moment-là je ferme la valise, je m’assieds dessus, j’dis : « J’t’ai dit qu’on causait avant que tu te casses, quoi ! » Et là, elle vient vers moi avec le poing comme ça, vous savez… Alors j’enlève vite mes lunettes parce que j’me dis qu’il vaut mieux un œil au beurre noir qu’un œil crevé. Et elle s’arrête à ça de moi avec le poing ! J’étais très content, d’ailleurs. Et elle me dit : « Mais pourquoi je suis comme ça, Nicolas ? » « Ah !, j’dis, ça c’est une très bonne question, assied-toi. » On a passé un long moment à discuter, et puis à la fin, elle me dit : « J’fais quoi, maintenant ? » « Si tu veux t’casser, tu veux t’casser… Á moins que tu aies une autre idée, maintenant. » « Tu veux que j’aille où ? » J’dis : « J’suis tout à fait d’accord avec toi, à part la rue, tu n’as rien. » Elle me dit : « Tu m’gardes encore ici ? » J’dis : « Ouais ! Mais à une condition. C’est que quand tu pètes les plombs, tu vas à la chapelle. » Elle me dit : « Non ! mais moi je n’y crois pas à ton machin de Jésus, avec ton machin blanc, là ! J’y crois rien ! » J’dis : « C’est pas ça que je t’ai dit. Je t’ai dit : Il n’y en a qu’un seul qui te supporte ici, c’est Jésus. Et la chapelle est insonorisée. Et il n’y a personne qui te supporte, par ailleurs. Donc, quand tu as envie de péter les plombs, tu vas chez Jésus péter les plombs. D’abord on n’entend pas, ensuite c’est Lui qui te supportera. » Et elle faisait ça très gentiment d’ailleurs, par obéissance. Et un jour, elle sortait de la chapelle, je la vois arriver. Je passais juste devant la chapelle à ce moment-là, c’est vraiment providentiel et elle me dit : « Aïe ! Aïe ! Nicolas ! » J’dis : « Quoi ? » « - Le cœur !... » J’dis : « Saute dans la voiture, on part à l’hôpital tout de suite ! » Je me suis dit, avec toutes les substances qu’elle a prises, le cœur est en train de… Elle dit : « Non, c’est pas ça, c’est l’amour de Jésus ! » « Ah, j’dis, c’est bon ! » Elle me dit : « Tu vois, j’ai dit à Jésus : Tu as une heure, montre suisse en main, tu as une heure pour me dire si tu existes ou pas. Soit tu existes et tu fais quelque chose, soit, s’il n’y a pas de réponse, je vais me suicider. Peut-être, si tu existes, on se retrouvera de l’autre côté. Mais moi je ne supporte plus la vie comme ça. » Elle s’est mise à genoux, une heure montre en main. Après une heure, elle s’est levée et elle a dit : « Tu n’m’as rien dit. Peut-être qu’on se reverra de l’autre côté, si tu existes. » Et à ce moment-là elle me dit : « Je ne sais pas ce qui s’est passé Nicolas, j’ai senti mon cœur brûler, je me suis effondrée au pied du… Elle était à ça de Jésus ! Á ça de l’ostensoir, au bord de l’autel, comme ça ! Elle a dit : « J’l’ai pas quitté des yeux, hein ! J’te lâche pas ! J’te lâche pas les baskets ! » Elle m’a dit : « J’me suis effondrée là, je sors maintenant de la chapelle. Il m’a dit qu’Il existait et qu’Il m’aimait. » Elle avait des médocs à n’en plus finir. On a fait le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Elle a fait un chemin comme ça. Bref, elle a fait son Bac, elle a terminé son Master en Sciences Po, croyante et tout… Avec cette expérience du Christ qui vient sauver, qui vient regarder. Tout d’un coup, entre la présomption et le désespoir, il y a le cœur de l’enfant de Dieu qui nous est restitué par l’effusion de l’Esprit Saint jaillissant du Cœur eucharistique du Christ. De sorte qu’il y a cette Pentecôte permanente qui est là, et qui fait que tout d’un coup je peux venir à ce Cœur miséricordieux.
Á sainte Faustine Jésus disait : « Tu vois, mon enfant, ce que tu es par toi-même, la cause de tes échecs, c’est que tu comptes trop sur toi et que tu t’appuies trop peu sur moi. Mais que cela ne t’attriste pas outre mesure, je suis le Dieu de la Miséricorde, ta misère ne saurait épuiser mon Amour, puisque je n’ai pas limité le nombre de mes pardons. Sache, mon enfant, que les plus grands obstacles à la sainteté sont le découragement et l’inquiétude. Toutes les tentations réunies ne devraient pas, même un instant, troubler la tranquillité intérieure. Quant à l’irritabilité et au découragement, ce sont les fruits de ton amour propre. » Le diagnostic est clair, c’est bien, on sait où on en est.
 Une autre chose fondamentale dans l’adoration eucharistique c’est qu’on a le choix entre adorer et idolâtrer. Le cœur de l’homme est ainsi fait qu’il ne puisse pas ne pas s’attacher à quelque chose. Qu’il ne puisse pas aller à un endroit où le sens de sa vie prend source, où il s’accroche. L’athéisme comme tel est impossible. J’aurais de toute façon une idole à la place de Dieu. Je peux être athée d’un certain Dieu, du Dieu de Jésus-Christ, je peux être athée d’un autre Dieu, peu importe… Mais je ne peux pas vivre d’un athéisme. J’aurais nécessairement quelque chose qui tient lieu : mon travail, mon sport, ma littérature, ma science, mon art, une personne, mon moi, mon ego… bref, quelqu’un tiendra lieu de Dieu qui remplira cette tâche dans mon existence. C’est subtil, parfois… Un petit enfant de cinq ans : « Maman, t’aimes mieux qui le plus au monde ? – Mais mon p’tit chou ! tu sais bien que je te préfère à tout ! – Ah, c’est là le problème, alors, maman. » C’est que tu n’as pas quelqu’un devant, qui est là et qui pourrait dire : eh bien, oui, c’est parce que j’aime Dieu en premier que je peux t’aimer toujours mieux. Donc l’idolâtrie sera toujours là et Benoît XVI disait : Enfin, avec Jésus au Saint Sacrement, on a quelqu’un devant qui plier le genou : « Celui qui plie le genou devant l’Eucharistie fait une profession de liberté. Il ne pourra plus jamais plier le genou devant quelque idole que ce soit. » Je suis libre quand je plie le genou devant Dieu, quand je m’agenouille devant le Seigneur et Sauveur, quand je me prosterne devant l’unique Seigneur. Ce geste d’adoration devient une contestation révolutionnaire face à notre monde des idoles. Adorer le Saint Sacrement, répandre l’adoration sur la terre entière devient la plus grande contestation révolutionnaire mais dans un sens prophétique et positif du terme de la révolution. Non pas dans un sens destructeur mais au contraire dans la proclamation d’un nouvel ordre du monde qui est un peu déboussolé, qui est un peu désorienté. Un monde qui a perdu l’Orient devient désastré. Il a perdu l’astre. Et c’est une catastrophe. Replier le genou devant celui qui est le Soleil levant qui porte en ses rayons notre guérison, le Christ, Soleil levant, c’est se tourner vers l’Orient, c’est réorienter le cœur de l’homme et le monde et retrouver l’astre du matin qui vient illuminer notre monde. Voilà. C’est ce renversement qui s’opère comme ça. Et je pense qu’il y a une profession de foi prophétique par l’adoration permanente du Saint Sacrement. Un jour à Lyon, un jeune qu’on avait accueilli qui s’était converti et qui allait être confirmé. Il avait invité à la fois des amis de la paroisse, des cathos bien engagés et ses amis du travail qui était athées, musulmans… Á la fin, il m’a dit : « Il faudrait que tu parles… Un petit mot comme ça, devant tout le monde… » J’dis : « Écoute, j’peux pas parler aux gens de ta paroisse de l’Emmanuel de la même manière que je vais parler à un musulman, ou à un athée… Enfin, c’est pas possible ! » Il fait : « Débrouille-toi, ça c’est ton problème, c’est pas le mien ! » C’était un hall de gymnastique, il avait mis une croix quelque part et il y avait un petit pique-nique, là, un petit buffet. Et puis… j’étais tellement perdu que je me suis prosterné devant la croix en mettant le front par terre et disant : « Jésus ! il n’y a plus que Toi qui peut me dire ce qu’il faut dire. » Je me relève. Je raconte, je ne sais pas ce que j’ai raconté… Á la fin, un monsieur vient me voir et me dit : « Voilà… j’aimerais vous dire que je suis musulman, j’aimerais devenir chrétien. » Je dis : « Ah bon ! Vous y pensez depuis longtemps ? » Il me dit : « Non, depuis tout à l’heure. » Je dis : « Quand ça ? » « Quand vous vous êtes prosterné le front par terre devant la Croix du Christ, comme nous on fait en direction de La Mecque, mais vous devant la Croix du Christ, j’ai su que vous adoriez le vrai Dieu ! » Et deux ans après il a été baptisé à Saint-Jean, à la cathédrale de Lyon. Dieu s’est servi de ce geste que j’avais fait de manière "égoïste", en disant Seigneur, moi je ne sais pas ce qu’il faut dire. Je n’avais aucune intention en posant ce geste. Dieu s’est servi de ce geste qui n’avait aucune intention. Je crois qu’il n’a pas écouté ce que j’ai dit après, il a bien fait d’ailleurs, tellement bouleversé par ce que Dieu lui avait donné, ou ce que l’Esprit Saint lui avait donné, par ce geste d’adoration. Professer le Christ dans l’adoration c’est délivrer l’homme de toutes les idoles.
Une autre chose fondamentale dans l’adoration eucharistique c’est qu’on a le choix entre adorer et idolâtrer. Le cœur de l’homme est ainsi fait qu’il ne puisse pas ne pas s’attacher à quelque chose. Qu’il ne puisse pas aller à un endroit où le sens de sa vie prend source, où il s’accroche. L’athéisme comme tel est impossible. J’aurais de toute façon une idole à la place de Dieu. Je peux être athée d’un certain Dieu, du Dieu de Jésus-Christ, je peux être athée d’un autre Dieu, peu importe… Mais je ne peux pas vivre d’un athéisme. J’aurais nécessairement quelque chose qui tient lieu : mon travail, mon sport, ma littérature, ma science, mon art, une personne, mon moi, mon ego… bref, quelqu’un tiendra lieu de Dieu qui remplira cette tâche dans mon existence. C’est subtil, parfois… Un petit enfant de cinq ans : « Maman, t’aimes mieux qui le plus au monde ? – Mais mon p’tit chou ! tu sais bien que je te préfère à tout ! – Ah, c’est là le problème, alors, maman. » C’est que tu n’as pas quelqu’un devant, qui est là et qui pourrait dire : eh bien, oui, c’est parce que j’aime Dieu en premier que je peux t’aimer toujours mieux. Donc l’idolâtrie sera toujours là et Benoît XVI disait : Enfin, avec Jésus au Saint Sacrement, on a quelqu’un devant qui plier le genou : « Celui qui plie le genou devant l’Eucharistie fait une profession de liberté. Il ne pourra plus jamais plier le genou devant quelque idole que ce soit. » Je suis libre quand je plie le genou devant Dieu, quand je m’agenouille devant le Seigneur et Sauveur, quand je me prosterne devant l’unique Seigneur. Ce geste d’adoration devient une contestation révolutionnaire face à notre monde des idoles. Adorer le Saint Sacrement, répandre l’adoration sur la terre entière devient la plus grande contestation révolutionnaire mais dans un sens prophétique et positif du terme de la révolution. Non pas dans un sens destructeur mais au contraire dans la proclamation d’un nouvel ordre du monde qui est un peu déboussolé, qui est un peu désorienté. Un monde qui a perdu l’Orient devient désastré. Il a perdu l’astre. Et c’est une catastrophe. Replier le genou devant celui qui est le Soleil levant qui porte en ses rayons notre guérison, le Christ, Soleil levant, c’est se tourner vers l’Orient, c’est réorienter le cœur de l’homme et le monde et retrouver l’astre du matin qui vient illuminer notre monde. Voilà. C’est ce renversement qui s’opère comme ça. Et je pense qu’il y a une profession de foi prophétique par l’adoration permanente du Saint Sacrement. Un jour à Lyon, un jeune qu’on avait accueilli qui s’était converti et qui allait être confirmé. Il avait invité à la fois des amis de la paroisse, des cathos bien engagés et ses amis du travail qui était athées, musulmans… Á la fin, il m’a dit : « Il faudrait que tu parles… Un petit mot comme ça, devant tout le monde… » J’dis : « Écoute, j’peux pas parler aux gens de ta paroisse de l’Emmanuel de la même manière que je vais parler à un musulman, ou à un athée… Enfin, c’est pas possible ! » Il fait : « Débrouille-toi, ça c’est ton problème, c’est pas le mien ! » C’était un hall de gymnastique, il avait mis une croix quelque part et il y avait un petit pique-nique, là, un petit buffet. Et puis… j’étais tellement perdu que je me suis prosterné devant la croix en mettant le front par terre et disant : « Jésus ! il n’y a plus que Toi qui peut me dire ce qu’il faut dire. » Je me relève. Je raconte, je ne sais pas ce que j’ai raconté… Á la fin, un monsieur vient me voir et me dit : « Voilà… j’aimerais vous dire que je suis musulman, j’aimerais devenir chrétien. » Je dis : « Ah bon ! Vous y pensez depuis longtemps ? » Il me dit : « Non, depuis tout à l’heure. » Je dis : « Quand ça ? » « Quand vous vous êtes prosterné le front par terre devant la Croix du Christ, comme nous on fait en direction de La Mecque, mais vous devant la Croix du Christ, j’ai su que vous adoriez le vrai Dieu ! » Et deux ans après il a été baptisé à Saint-Jean, à la cathédrale de Lyon. Dieu s’est servi de ce geste que j’avais fait de manière "égoïste", en disant Seigneur, moi je ne sais pas ce qu’il faut dire. Je n’avais aucune intention en posant ce geste. Dieu s’est servi de ce geste qui n’avait aucune intention. Je crois qu’il n’a pas écouté ce que j’ai dit après, il a bien fait d’ailleurs, tellement bouleversé par ce que Dieu lui avait donné, ou ce que l’Esprit Saint lui avait donné, par ce geste d’adoration. Professer le Christ dans l’adoration c’est délivrer l’homme de toutes les idoles.
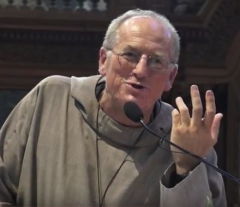 Peguy disait : « Tous les prosternements du monde ne valent pas le bel agenouillement droit d’un homme libre. Toutes les soumissions, tous les accablements du monde ne valent pas une belle prière bien droite, agenouillée, de ces hommes libres-là. Toutes les soumissions du monde ne valent pas le point d’élancement, bel élancement droit d’une seule invocation d’un libre amour. » C’est bouleversant, ça, voyez… Donc l’adoration est là au cœur du drame de notre humanité pour renverser les choses.
Peguy disait : « Tous les prosternements du monde ne valent pas le bel agenouillement droit d’un homme libre. Toutes les soumissions, tous les accablements du monde ne valent pas une belle prière bien droite, agenouillée, de ces hommes libres-là. Toutes les soumissions du monde ne valent pas le point d’élancement, bel élancement droit d’une seule invocation d’un libre amour. » C’est bouleversant, ça, voyez… Donc l’adoration est là au cœur du drame de notre humanité pour renverser les choses.
 Du point de vue anthropologique, le premier drame de l’humanité, c’est l’orgueil. Quand on est devant le Saint Sacrement exposé, quand on regarde Jésus dans son look du bout de pain, dans son apparence d’un bout de pain, dans cette vulnérabilité-là, vraiment, on est bouleversé. Le Tout-Puissant s’est fait le désarmé. Le Seigneur des armées est devenu le Seigneur désarmé. Désarmé, vulnérable, pauvre. Il ne peut même pas sortir du Tabernacle tout seul. Bon, des fois, il le fait. Avec sainte Faustine, un jour, Il débarque dans sa chambre et Il se pose sur ses mains, et dit : J’en ai marre, ici, il n’y a personne qui m’aime. Il n’y a que toi, donc je quitte cette maison et j’me casse ! Et Faustine négocie, elle dit : Tu ne peux pas Jésus, quand même, non… Il était sorti du Tabernacle, du ciboire, comme ça, et puis Il lui dit, bon, tu m’as convaincu, rapporte-moi au Tabernacle. Elle lui dit non, t’es venu tout seul, tu retournes… Il dit, non, j’y retournerai avec toi. Il lui a fait trois fois le coup comme ça. Trois fois Il lui a dit, non, je ne veux plus rester ici, ça va pas. Et trois fois Faustine dit, mais non, Jésus, écoute… Faut pas faire comme ça, elles sont bien mes sœurs quand même, tu sais… Et donc, elle ramènera trois fois Jésus au Tabernacle. Á part ça, il a besoin des mains du prêtre ou du diacre, pour sortir, être exposé. Benoît XVI dit : « Sa façon d’être Dieu provoque notre façon d’être homme. » C’est prodigieux cette phrase, aussi. Qui es-tu devant ce Dieu pour revendiquer quoi que ce soit ? Au point que Jean-Paul II a pu dire : « La première tâche de la théologie est l’intelligence de cet abaissement de Dieu ̶ qu’on appelle en grec la kénose, en français venant du grec ̶ le Dieu qui se vide de lui-même, vrai et grand mystère pour l’esprit humain. » Dieu s’abaisse jusqu’à la Croix, jusqu’à l’Hostie. « C’est pourtant dans ce mystère de l’abaissement de Dieu que le mystère de l’homme s’éclaire totalement. Le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. »
Du point de vue anthropologique, le premier drame de l’humanité, c’est l’orgueil. Quand on est devant le Saint Sacrement exposé, quand on regarde Jésus dans son look du bout de pain, dans son apparence d’un bout de pain, dans cette vulnérabilité-là, vraiment, on est bouleversé. Le Tout-Puissant s’est fait le désarmé. Le Seigneur des armées est devenu le Seigneur désarmé. Désarmé, vulnérable, pauvre. Il ne peut même pas sortir du Tabernacle tout seul. Bon, des fois, il le fait. Avec sainte Faustine, un jour, Il débarque dans sa chambre et Il se pose sur ses mains, et dit : J’en ai marre, ici, il n’y a personne qui m’aime. Il n’y a que toi, donc je quitte cette maison et j’me casse ! Et Faustine négocie, elle dit : Tu ne peux pas Jésus, quand même, non… Il était sorti du Tabernacle, du ciboire, comme ça, et puis Il lui dit, bon, tu m’as convaincu, rapporte-moi au Tabernacle. Elle lui dit non, t’es venu tout seul, tu retournes… Il dit, non, j’y retournerai avec toi. Il lui a fait trois fois le coup comme ça. Trois fois Il lui a dit, non, je ne veux plus rester ici, ça va pas. Et trois fois Faustine dit, mais non, Jésus, écoute… Faut pas faire comme ça, elles sont bien mes sœurs quand même, tu sais… Et donc, elle ramènera trois fois Jésus au Tabernacle. Á part ça, il a besoin des mains du prêtre ou du diacre, pour sortir, être exposé. Benoît XVI dit : « Sa façon d’être Dieu provoque notre façon d’être homme. » C’est prodigieux cette phrase, aussi. Qui es-tu devant ce Dieu pour revendiquer quoi que ce soit ? Au point que Jean-Paul II a pu dire : « La première tâche de la théologie est l’intelligence de cet abaissement de Dieu ̶ qu’on appelle en grec la kénose, en français venant du grec ̶ le Dieu qui se vide de lui-même, vrai et grand mystère pour l’esprit humain. » Dieu s’abaisse jusqu’à la Croix, jusqu’à l’Hostie. « C’est pourtant dans ce mystère de l’abaissement de Dieu que le mystère de l’homme s’éclaire totalement. Le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. »
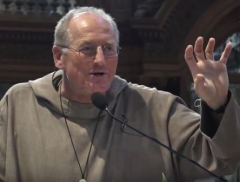 Deuxième point : l’égoïsme et le repliement sur soi. Nous sommes libres mais nous avons tous besoin d’être libérés. Si de manière générale, théologiquement, l’adoration renverse le mouvement du péché, qui est la préférence de la créature pour le Créateur, d’un point de vue très concret, l’adoration me donne ce goût de la liberté, élargit mon espace, élargit mon cœur. Dans la confiance de la présence de Celui qui me regarde et qui m’aime il y a un mouvement de libération qui peut se faire.
Deuxième point : l’égoïsme et le repliement sur soi. Nous sommes libres mais nous avons tous besoin d’être libérés. Si de manière générale, théologiquement, l’adoration renverse le mouvement du péché, qui est la préférence de la créature pour le Créateur, d’un point de vue très concret, l’adoration me donne ce goût de la liberté, élargit mon espace, élargit mon cœur. Dans la confiance de la présence de Celui qui me regarde et qui m’aime il y a un mouvement de libération qui peut se faire.
 Troisième point de ce côté-là : les troubles de l’estime de soi, les maladies du refus de vivre. Vous savez, on est très marqué par rapport à ça : Je ne m’estime pas, je ne vaux rien, je suis nul, c’est n’importe quoi, rien à foutre… C’est une fille que j’avais accueillie, qui avait fait aussi plusieurs tentatives de suicide. Qui était dans un état aussi incroyable. Elle a passé neuf nuits d’adoration. Neuf nuits de 10h du soir à 6h du matin. Sans trop y croire, d’ailleurs. Après ces neuf nuits elle m’a écrit un mot. Elle ne pouvait pas encore parler parce qu’elle était tellement blessée, traumatisée. Je lui avais dit, t’es trop cassée. Il n’y a qu’une chose qui peut te relever c’est te laisser regarder par Jésus. Elle me dit : « Mais j’y crois pas ! » « Ça fait rien, Lui croit en toi. Alors si tu veux passer une nuit d’adoration, je peux accepter. » La première nuit, de 10h du soir à 6h du matin, elle n’a pas bougé. Moi j’avais la tête qui tombait. Elle rien, rien. Je dis : « Tu peux revenir une fois, si tu veux. » Elle me dit : « Je reviens ce soir. » Je dis : « Non, pas toutes les nuits, une nuit sur deux, quand même ! » Et donc, elle a fait les neuf nuits. Elle m’a écrit : « Tu vois, Nicolas, je me trouvais moche, nulle et conne. Et Dieu dans l’adoration m’a dit : « Tu es belle, tu as du prix à mes yeux et je t’aime. » Et j’ai compris que ce qui compte c’est pas ce que moi je pense de moi, même pas ce que mon père pense de moi. ̶ Qui avait dit en psychothérapie systémique : « Tu peux crever, j’en ai rien à faire », ce qui n’était pas son intention profonde, mais dans le désespoir et la souffrance qu’il avait, c’est la seule chose qu’il a pu sortir, mais elle l’a pris en pleine figure, comme une parole vraie. ̶ Et puis, c’est pas ce que pensent les copains de moi. Ce qui compte, c’est ce que Jésus pense de moi. » Et ça a été le chemin de la libération.
Troisième point de ce côté-là : les troubles de l’estime de soi, les maladies du refus de vivre. Vous savez, on est très marqué par rapport à ça : Je ne m’estime pas, je ne vaux rien, je suis nul, c’est n’importe quoi, rien à foutre… C’est une fille que j’avais accueillie, qui avait fait aussi plusieurs tentatives de suicide. Qui était dans un état aussi incroyable. Elle a passé neuf nuits d’adoration. Neuf nuits de 10h du soir à 6h du matin. Sans trop y croire, d’ailleurs. Après ces neuf nuits elle m’a écrit un mot. Elle ne pouvait pas encore parler parce qu’elle était tellement blessée, traumatisée. Je lui avais dit, t’es trop cassée. Il n’y a qu’une chose qui peut te relever c’est te laisser regarder par Jésus. Elle me dit : « Mais j’y crois pas ! » « Ça fait rien, Lui croit en toi. Alors si tu veux passer une nuit d’adoration, je peux accepter. » La première nuit, de 10h du soir à 6h du matin, elle n’a pas bougé. Moi j’avais la tête qui tombait. Elle rien, rien. Je dis : « Tu peux revenir une fois, si tu veux. » Elle me dit : « Je reviens ce soir. » Je dis : « Non, pas toutes les nuits, une nuit sur deux, quand même ! » Et donc, elle a fait les neuf nuits. Elle m’a écrit : « Tu vois, Nicolas, je me trouvais moche, nulle et conne. Et Dieu dans l’adoration m’a dit : « Tu es belle, tu as du prix à mes yeux et je t’aime. » Et j’ai compris que ce qui compte c’est pas ce que moi je pense de moi, même pas ce que mon père pense de moi. ̶ Qui avait dit en psychothérapie systémique : « Tu peux crever, j’en ai rien à faire », ce qui n’était pas son intention profonde, mais dans le désespoir et la souffrance qu’il avait, c’est la seule chose qu’il a pu sortir, mais elle l’a pris en pleine figure, comme une parole vraie. ̶ Et puis, c’est pas ce que pensent les copains de moi. Ce qui compte, c’est ce que Jésus pense de moi. » Et ça a été le chemin de la libération.
 On est vraiment aux antipodes, dans les Métamorphoses d’Ovide, avec le mythe de Narcisse. Ovide dit : « Il meurt victime de ses propres yeux. » C’est extraordinaire : à force de regarder là-dedans, il est séduit par lui-même, il meurt victime de son propre regard replié sur lui-même. Nous, nous allons vivre du regard du Christ posé sur nous. Á l’adoration où Jésus est exposé, nous nous exposons à son regard de miséricorde. Jean-Paul II dans la Théologie du corps dit : « L’homme accueille par un regard celle qui lui est donnée. » Il y a toujours un regard qui est là, voyez-vous. Au cœur de ce mystère, il y a ce regard. François Roustang, un thérapeute psychanalyste, disait : « Dans le regard sur ma propre chair, sur ma propre corporéité, sur ma propre sensibilité, j’ai la certitude d’être vivant en tant que tel, d’une pleine évidence telle qu’elle rejette dans l’ombre toutes les modalités de la vie individuelle. Je suis vivant, je suis assuré d’être vivant et cela me donne une fermeté et un aplomb que je n’avais jamais ressenti auparavant. » Pour lui, il le dit de manière psychanalytique athée, c’est-à-dire que le regard de l’autre me sort de mon narcissisme destructeur, de mon renfermement sur ce regard qui me fait mourir, parce qu’il m’enferme sur moi-même, et me met en présence de Celui qui m’extasie, justement, et qui me regarde. Cette parole d’un psychanalyste s’applique dans sa perfection et son excellence à l’adoration eucharistique. Jésus, avec son regard d’amour, il est là, il a ses yeux. J’étais avec un petit enfant, un jour, cinq ans, devant le Saint Sacrement. Il regarde l’Hostie comme ça, il dit : « Jésus, Toi tu ne me vois pas, hein, mais moi je sais que c’est Toi qui es là ! » Alors : « Oui, oui, Il te voit aussi… » Je l’ai trouvé tellement beau… Tu ne me vois pas, mais moi je sais… On est complice. Et le Pape François disait : « Dans l’adoration, j’ai l’expérience que Dieu m’aime. Cette sécurité, personne ne pourra nous l’enlever, personne ne pourra nous l’arracher. Personne. » Dieu est là. C’est juste l’inverse du regard de Sartre. Dans Les mots, Sartre raconte qu’il était dans le salon de la maison familiale. Il avait joué avec des allumettes, il avait mis le feu au tapis. Le tapis a cramé. Il a réussi à éteindre mais il restait les marques et il dit : Dieu m’a vu, j’étais devenu une cible vivante. J’essayais d’échapper à son regard. J’ai été me cacher sous la table du salon, il me voyait toujours. J’étais à la salle de bain, il me voyait toujours. Alors, je me suis mis à jurer comme mon grand-père. Sacré nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu, tu ne me regarderas plus ! Je n’ai pas immédiatement cru que Dieu n’existait pas, mais je ne voulais plus qu’il me regarde. Vous voyez l’image qu’il avait du regard de Dieu. Le père Fouettard. Je suis athée de ce Dieu-là de Sartre. Le Dieu auquel je crois n’est pas un Dieu qui regarde pour juger ou accuser. C’est un Dieu qui regarde pour relever, faire exister. Et au Saint Sacrement il me relève et me fait exister. On apprend par Jésus l’expérience de cela. Quand Jacob se bat dans son combat contre Dieu dans cette nuit à Penuel, le nom Penuel veut dire la face de Dieu, se tourner vers le seul vrai Dieu. Et saint Ambroise commentant Marie-Madeleine dit : « Qui cherche-tu ? demande le Christ à Marie. Regarde-moi ! Tant que tu ne me regardes pas je t’appelle femme. Tu me regardes, je t’appelle Marie. Tu reçois le nom de celles qui engendrent le Christ, car, en me regardant spirituellement, tu engendres le Christ dans ton âme. » Et Hagar, chassée par sa maîtresse, Saraï, pas très gentille, là, l’envoie au désert. Elle est là, elle croit qu’elle va mourir. Elle a son enfant d’un côté et va de l’autre côté. Et tout d’un coup, Dieu vient la visiter et lui montre le puits. Elle a l’audace, pour une esclave non juive, de donner un nom à Dieu. Elle va donner à Dieu le nom : « Toi tu es Dieu qui me voit ». Atta-El-roï. C’est pourquoi on appelait ce puits le puits pour le vivant qui me voit. C’est la seule qui ose donner un nom à Dieu. Vous voyez la liberté d’une esclave ! Elle ose donner un nom parce qu’elle a fait l’expérience que dans sa misère et dans la mort qui s’annonçait, pour sa descendance et pour elle, Dieu la voyait et lui a donné la vie. Il lui a donné l’eau vive. Donc n’ayons pas peur de nous présenter à Dieu comme ça, devant lui.
On est vraiment aux antipodes, dans les Métamorphoses d’Ovide, avec le mythe de Narcisse. Ovide dit : « Il meurt victime de ses propres yeux. » C’est extraordinaire : à force de regarder là-dedans, il est séduit par lui-même, il meurt victime de son propre regard replié sur lui-même. Nous, nous allons vivre du regard du Christ posé sur nous. Á l’adoration où Jésus est exposé, nous nous exposons à son regard de miséricorde. Jean-Paul II dans la Théologie du corps dit : « L’homme accueille par un regard celle qui lui est donnée. » Il y a toujours un regard qui est là, voyez-vous. Au cœur de ce mystère, il y a ce regard. François Roustang, un thérapeute psychanalyste, disait : « Dans le regard sur ma propre chair, sur ma propre corporéité, sur ma propre sensibilité, j’ai la certitude d’être vivant en tant que tel, d’une pleine évidence telle qu’elle rejette dans l’ombre toutes les modalités de la vie individuelle. Je suis vivant, je suis assuré d’être vivant et cela me donne une fermeté et un aplomb que je n’avais jamais ressenti auparavant. » Pour lui, il le dit de manière psychanalytique athée, c’est-à-dire que le regard de l’autre me sort de mon narcissisme destructeur, de mon renfermement sur ce regard qui me fait mourir, parce qu’il m’enferme sur moi-même, et me met en présence de Celui qui m’extasie, justement, et qui me regarde. Cette parole d’un psychanalyste s’applique dans sa perfection et son excellence à l’adoration eucharistique. Jésus, avec son regard d’amour, il est là, il a ses yeux. J’étais avec un petit enfant, un jour, cinq ans, devant le Saint Sacrement. Il regarde l’Hostie comme ça, il dit : « Jésus, Toi tu ne me vois pas, hein, mais moi je sais que c’est Toi qui es là ! » Alors : « Oui, oui, Il te voit aussi… » Je l’ai trouvé tellement beau… Tu ne me vois pas, mais moi je sais… On est complice. Et le Pape François disait : « Dans l’adoration, j’ai l’expérience que Dieu m’aime. Cette sécurité, personne ne pourra nous l’enlever, personne ne pourra nous l’arracher. Personne. » Dieu est là. C’est juste l’inverse du regard de Sartre. Dans Les mots, Sartre raconte qu’il était dans le salon de la maison familiale. Il avait joué avec des allumettes, il avait mis le feu au tapis. Le tapis a cramé. Il a réussi à éteindre mais il restait les marques et il dit : Dieu m’a vu, j’étais devenu une cible vivante. J’essayais d’échapper à son regard. J’ai été me cacher sous la table du salon, il me voyait toujours. J’étais à la salle de bain, il me voyait toujours. Alors, je me suis mis à jurer comme mon grand-père. Sacré nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu, tu ne me regarderas plus ! Je n’ai pas immédiatement cru que Dieu n’existait pas, mais je ne voulais plus qu’il me regarde. Vous voyez l’image qu’il avait du regard de Dieu. Le père Fouettard. Je suis athée de ce Dieu-là de Sartre. Le Dieu auquel je crois n’est pas un Dieu qui regarde pour juger ou accuser. C’est un Dieu qui regarde pour relever, faire exister. Et au Saint Sacrement il me relève et me fait exister. On apprend par Jésus l’expérience de cela. Quand Jacob se bat dans son combat contre Dieu dans cette nuit à Penuel, le nom Penuel veut dire la face de Dieu, se tourner vers le seul vrai Dieu. Et saint Ambroise commentant Marie-Madeleine dit : « Qui cherche-tu ? demande le Christ à Marie. Regarde-moi ! Tant que tu ne me regardes pas je t’appelle femme. Tu me regardes, je t’appelle Marie. Tu reçois le nom de celles qui engendrent le Christ, car, en me regardant spirituellement, tu engendres le Christ dans ton âme. » Et Hagar, chassée par sa maîtresse, Saraï, pas très gentille, là, l’envoie au désert. Elle est là, elle croit qu’elle va mourir. Elle a son enfant d’un côté et va de l’autre côté. Et tout d’un coup, Dieu vient la visiter et lui montre le puits. Elle a l’audace, pour une esclave non juive, de donner un nom à Dieu. Elle va donner à Dieu le nom : « Toi tu es Dieu qui me voit ». Atta-El-roï. C’est pourquoi on appelait ce puits le puits pour le vivant qui me voit. C’est la seule qui ose donner un nom à Dieu. Vous voyez la liberté d’une esclave ! Elle ose donner un nom parce qu’elle a fait l’expérience que dans sa misère et dans la mort qui s’annonçait, pour sa descendance et pour elle, Dieu la voyait et lui a donné la vie. Il lui a donné l’eau vive. Donc n’ayons pas peur de nous présenter à Dieu comme ça, devant lui.
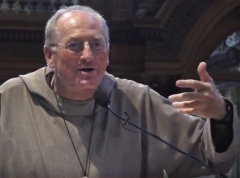 Un autre point. On vit beaucoup dans l’affectivité, l’émotion, le ressenti. L’adoration eucharistique est une guérison de mon émotionnalité. Je ne sais pas si ceux qui adorent régulièrement parmi vous ont beaucoup de guili-guili qui partent de l’occiput à la pointe du petit orteil, mais… Moi, en tout cas, c’est pas trop le cas, depuis des années que je fais cela… Par contre, je vois une chose qui est absolument prodigieuse qui se passe en moi. Ce n’est pas ma sensibilité qui rejoint Dieu. D’ailleurs, elle ne permet jamais de rejoindre Dieu. Elle peut être un cadeau, il ne faut pas rejeter les cadeaux de Dieu dans notre sensibilité, si sa bonté, sa tendresse nous donne ça. Mais c’est un cadeau de Dieu, ce n’est pas Dieu lui-même. Dieu lui-même ne se touche que par la foi, l’espérance et la charité. Par les vertus que l’on appelle théologales. Et donc, l’adoration eucharistique… Si les Pères de l’Église disaient il faut fixer son regard ̶ et toute l’adoration eucharistique au XIIIème siècle est née du fait que l’on voulait voir Dieu avec nos yeux de chair, puisque certains contestaient sa présence réelle ̶ On a toujours dit : oui, mais nos yeux de chair, qui sont le vecteur de ce regard posé sur Dieu, portent un autre regard, ceux de l’âme, qui est perfectionné par la foi, l’espérance et la charité. Donc, toute l’adoration eucharistique consiste à poser des actes de foi, d’espérance et de charité. Je crois que Tu es là, Seigneur. Je T’aime, Seigneur, je T’adore et je compte sur Toi, parce que sans Toi, je ne peux rien faire. Et un jour je te verrai face à face. Acte de foi, acte d’espérance et de charité. De sorte que quelques soient mes émotions, quand je ressens, je dis merci Jésus, mais ce n’est pas ça ce à quoi je veux m’attacher. C’est à Toi que je veux m’attacher. Ce n’est pas pour tes cadeaux que je T’aime, c’est pour Toi-même. Et quand je ne ressens rien, encore mieux : je peux au moins m’attacher à Toi par la foi, l’espérance et la charité. Et donc je suis lié à Lui de manière indéfectible. Un jour, un petit enfant de 6 ans, qui préparait sa première communion, devant le Saint Sacrement : « Nicolas, c’est fou, hein ? de penser que c’est Jésus qui est là ! » Je dis, génial, on va… Il me dit : « Enfin, c’est la Toute-Puissance de Dieu, quoi ! » Oui, t’as raison, c’est vrai, la Toute-Puissance peut se faire toute petite.
Un autre point. On vit beaucoup dans l’affectivité, l’émotion, le ressenti. L’adoration eucharistique est une guérison de mon émotionnalité. Je ne sais pas si ceux qui adorent régulièrement parmi vous ont beaucoup de guili-guili qui partent de l’occiput à la pointe du petit orteil, mais… Moi, en tout cas, c’est pas trop le cas, depuis des années que je fais cela… Par contre, je vois une chose qui est absolument prodigieuse qui se passe en moi. Ce n’est pas ma sensibilité qui rejoint Dieu. D’ailleurs, elle ne permet jamais de rejoindre Dieu. Elle peut être un cadeau, il ne faut pas rejeter les cadeaux de Dieu dans notre sensibilité, si sa bonté, sa tendresse nous donne ça. Mais c’est un cadeau de Dieu, ce n’est pas Dieu lui-même. Dieu lui-même ne se touche que par la foi, l’espérance et la charité. Par les vertus que l’on appelle théologales. Et donc, l’adoration eucharistique… Si les Pères de l’Église disaient il faut fixer son regard ̶ et toute l’adoration eucharistique au XIIIème siècle est née du fait que l’on voulait voir Dieu avec nos yeux de chair, puisque certains contestaient sa présence réelle ̶ On a toujours dit : oui, mais nos yeux de chair, qui sont le vecteur de ce regard posé sur Dieu, portent un autre regard, ceux de l’âme, qui est perfectionné par la foi, l’espérance et la charité. Donc, toute l’adoration eucharistique consiste à poser des actes de foi, d’espérance et de charité. Je crois que Tu es là, Seigneur. Je T’aime, Seigneur, je T’adore et je compte sur Toi, parce que sans Toi, je ne peux rien faire. Et un jour je te verrai face à face. Acte de foi, acte d’espérance et de charité. De sorte que quelques soient mes émotions, quand je ressens, je dis merci Jésus, mais ce n’est pas ça ce à quoi je veux m’attacher. C’est à Toi que je veux m’attacher. Ce n’est pas pour tes cadeaux que je T’aime, c’est pour Toi-même. Et quand je ne ressens rien, encore mieux : je peux au moins m’attacher à Toi par la foi, l’espérance et la charité. Et donc je suis lié à Lui de manière indéfectible. Un jour, un petit enfant de 6 ans, qui préparait sa première communion, devant le Saint Sacrement : « Nicolas, c’est fou, hein ? de penser que c’est Jésus qui est là ! » Je dis, génial, on va… Il me dit : « Enfin, c’est la Toute-Puissance de Dieu, quoi ! » Oui, t’as raison, c’est vrai, la Toute-Puissance peut se faire toute petite.
 L’adoration nous délivre des maladies de la subjectivité ̶ qui se transforment d’ailleurs en pathologies : boulimie, anorexie, dépression, crise identitaire, toxicomanies diverses… ̶ pour nous établir dans une structuration de notre être profond par la dimension essentielle de notre dignité humaine, qui est l’âme spirituelle, qui elle-même est faite d’intelligence et de volonté, qui elles-mêmes, ces facultés, sont perfectionnées par la foi, l’espérance et la charité. Ce qui ne me désincarne pas, ce serait une tragédie, mais qui assume toute ma chair et ma psychologie pour la tourner vers Dieu.
L’adoration nous délivre des maladies de la subjectivité ̶ qui se transforment d’ailleurs en pathologies : boulimie, anorexie, dépression, crise identitaire, toxicomanies diverses… ̶ pour nous établir dans une structuration de notre être profond par la dimension essentielle de notre dignité humaine, qui est l’âme spirituelle, qui elle-même est faite d’intelligence et de volonté, qui elles-mêmes, ces facultés, sont perfectionnées par la foi, l’espérance et la charité. Ce qui ne me désincarne pas, ce serait une tragédie, mais qui assume toute ma chair et ma psychologie pour la tourner vers Dieu.
 Un autre point qui me paraît important. Parfois, on a une maladie que l’on appelle l’acédie. Acédie veut dire la perte du désir, la perte de la soif, la perte de la faim ; le train-train, la paresse ; l’assoupissement, le manque de force et de détermination pour aller vers Dieu. L’adoration m’amène à crier vers Dieu en permanence. L’adoration est vraiment ce cri qui me tourne vers Dieu perpétuellement. Paul Claudel disait : « Lève les yeux et tiens-les fixés devant toi. C’est là ! Et regarde l’azyme (le pain) dans la monstrance. Le voile des choses, pour moi, sur un point est devenu transparent. J’étreins la substance, enfin, à travers l’accident. » C’est-à-dire : j’étreins Jésus à travers l’apparence du pain. Il y a donc là un désir. L’adoration est le lieu du désir. C’est Toi que je veux ! J’ai faim de Toi, j’ai soif de Toi ! Je le mange des yeux ! Je le mange du regard et je nourris ma foi, mon espérance et ma charité. Je n’arrête pas de le désirer. Saint Augustin dit : « Le gémissement de mon cœur me faisait rugir. Et qui connaissait la cause de mon rugissement ? Tout mon désir est devant Toi. Non pas devant les hommes mais devant Dieu. Car ton désir c’est ta prière. Si le désir est continuel, la prière est continuelle. » Ça, c’est beau ! Donc, j’apprends le désir. En même temps devant le Saint Sacrement, j’apprends à être moi-même, aussi. Ma vulnérabilité, ma pauvreté, je suis là. Le monde nous pousse à la performance, nous pousse à la réussite. Nietzsche avait parlé du surhomme, aujourd’hui c’est le transhumanisme qui fait fureur partout. J’en parlais avec un spécialiste du transhumanisme ici, en France, Laurent Alexandre, qui me disait : « Mais qui, aujourd’hui, voudrait vivre avec 120 de QI ? Mais c’est 175 minimum, voire 200 ! Il n’y a plus de raison de vivre avez 120 ! » Je dis : « Moi, je n’ai encore jamais rencontré une seule personne qui m’a parlé de son QI ! Mais toutes les personnes que j’ai rencontrées m’ont parlé de leur cœur. Qui souffraient de ne pas être aimées. De ne pas avoir l’amour. De ne pas trouver sens à la vie. Ça oui. Mais personne ne m’a dit, là, j’ai un problème avec mon QI. Jamais. Ou alors avec des gros intellos. Mais c’était très bien pour eux. » Finalement, devant cet appel au culte de la performance et à la fatigue d’être soi (Nietzsche) il y a, devant Jésus, la pauvreté, l’expérience que ma vulnérabilité est aimée, que ma vulnérabilité est le lieu de l’entrée de la grâce, que ma pauvreté est le lieu par lequel Dieu va passer. C’est le lieu par lequel Dieu va me rejoindre. La désappropriation radicale de l’humanité de Jésus dans l’Eucharistie est un lieu pour que je puisse aussi m’abandonner tel que je suis. Ma pauvreté est la porte d’entrée de la grâce. Ma misère est la porte d’entrée de la grâce. Elle est le reposoir de la miséricorde de Dieu et le lieu par lequel Dieu va tout transformer. Et c’est par-là que ça se passe, voyez-vous. C’est capital de redécouvrir cela. De redécouvrir que la vulnérabilité est au cœur de l’existence humaine et au cœur de l’étreinte divine. Dieu vient épouser ma vulnérabilité. Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin. Ce sont les malades. « Je suis venu pour les pécheurs et pas pour les justes. » Vous voyez. Et quand j’arrive comme ça devant Dieu, je peux Lui dire : « Tu n’es pas venu pour rien, Seigneur, tu n’es vraiment pas venu pour rien. Tu as trouvé ton bonhomme devant Toi. »
Un autre point qui me paraît important. Parfois, on a une maladie que l’on appelle l’acédie. Acédie veut dire la perte du désir, la perte de la soif, la perte de la faim ; le train-train, la paresse ; l’assoupissement, le manque de force et de détermination pour aller vers Dieu. L’adoration m’amène à crier vers Dieu en permanence. L’adoration est vraiment ce cri qui me tourne vers Dieu perpétuellement. Paul Claudel disait : « Lève les yeux et tiens-les fixés devant toi. C’est là ! Et regarde l’azyme (le pain) dans la monstrance. Le voile des choses, pour moi, sur un point est devenu transparent. J’étreins la substance, enfin, à travers l’accident. » C’est-à-dire : j’étreins Jésus à travers l’apparence du pain. Il y a donc là un désir. L’adoration est le lieu du désir. C’est Toi que je veux ! J’ai faim de Toi, j’ai soif de Toi ! Je le mange des yeux ! Je le mange du regard et je nourris ma foi, mon espérance et ma charité. Je n’arrête pas de le désirer. Saint Augustin dit : « Le gémissement de mon cœur me faisait rugir. Et qui connaissait la cause de mon rugissement ? Tout mon désir est devant Toi. Non pas devant les hommes mais devant Dieu. Car ton désir c’est ta prière. Si le désir est continuel, la prière est continuelle. » Ça, c’est beau ! Donc, j’apprends le désir. En même temps devant le Saint Sacrement, j’apprends à être moi-même, aussi. Ma vulnérabilité, ma pauvreté, je suis là. Le monde nous pousse à la performance, nous pousse à la réussite. Nietzsche avait parlé du surhomme, aujourd’hui c’est le transhumanisme qui fait fureur partout. J’en parlais avec un spécialiste du transhumanisme ici, en France, Laurent Alexandre, qui me disait : « Mais qui, aujourd’hui, voudrait vivre avec 120 de QI ? Mais c’est 175 minimum, voire 200 ! Il n’y a plus de raison de vivre avez 120 ! » Je dis : « Moi, je n’ai encore jamais rencontré une seule personne qui m’a parlé de son QI ! Mais toutes les personnes que j’ai rencontrées m’ont parlé de leur cœur. Qui souffraient de ne pas être aimées. De ne pas avoir l’amour. De ne pas trouver sens à la vie. Ça oui. Mais personne ne m’a dit, là, j’ai un problème avec mon QI. Jamais. Ou alors avec des gros intellos. Mais c’était très bien pour eux. » Finalement, devant cet appel au culte de la performance et à la fatigue d’être soi (Nietzsche) il y a, devant Jésus, la pauvreté, l’expérience que ma vulnérabilité est aimée, que ma vulnérabilité est le lieu de l’entrée de la grâce, que ma pauvreté est le lieu par lequel Dieu va passer. C’est le lieu par lequel Dieu va me rejoindre. La désappropriation radicale de l’humanité de Jésus dans l’Eucharistie est un lieu pour que je puisse aussi m’abandonner tel que je suis. Ma pauvreté est la porte d’entrée de la grâce. Ma misère est la porte d’entrée de la grâce. Elle est le reposoir de la miséricorde de Dieu et le lieu par lequel Dieu va tout transformer. Et c’est par-là que ça se passe, voyez-vous. C’est capital de redécouvrir cela. De redécouvrir que la vulnérabilité est au cœur de l’existence humaine et au cœur de l’étreinte divine. Dieu vient épouser ma vulnérabilité. Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin. Ce sont les malades. « Je suis venu pour les pécheurs et pas pour les justes. » Vous voyez. Et quand j’arrive comme ça devant Dieu, je peux Lui dire : « Tu n’es pas venu pour rien, Seigneur, tu n’es vraiment pas venu pour rien. Tu as trouvé ton bonhomme devant Toi. »
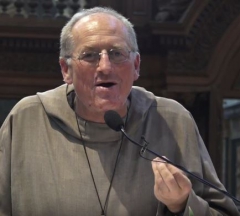 Je pense qu’il y a aussi dans l’adoration eucharistique quelque chose d’assez extraordinaire qui se produit. C’est une… Je disais tout à l’heure que si l’homme est fait pour trouver le sens à sa vie, pour ad-orer, ̶ adorer veut dire "mettre une source à sa bouche pour en vivre". On ne peut pas vivre sans eau. Ou je mets ma bouche à la source de Dieu ; ou je la mets à d’autres sources frelatées. Il y a une autre chose qui me caractérise : je ne peux pas vivre sans une certaine dépendance. Si je ne dépends pas de l’unique nécessaire qui est Dieu, je vivrais dans des dépendances affectives diverses. Mon cœur sera balloté. Et ce cœur balloté va se trouver aussi, parfois, souillé. Et Dieu vient me redonner par l’adoration eucharistique la possibilité de m’attacher à l’unique nécessaire, Lui, et une purification aussi du cœur, une chasteté. « Tu nous as fait pour Toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose pas en Toi » dit saint Augustin. Il y a, par ce regard posé sur le Christ, une chasteté qui nous est donnée. Jésus dit : « Ton regard, c’est la fenêtre de ton cœur. Garde ton regard pur afin que ton regard soit pur. » On a accueilli une fille qui était dans la prostitution sadomasochiste, dix ans de prostitution, de violence et d’horreur « mais je ne peux même pas, Nicolas, te raconter ce que j’ai fait, parce que tu ne supporterais pas d’écouter ce que moi j’ai vécu. » Et à l’adoration eucharistique, elle passait des heures chaque jour. Elle s’en est sortie. Elle fait de belles études maintenant. Et un jour elle vient vers moi et elle me dit : « Mais tu sais, Nicolas, il semble que Jésus m’a recréé ma virginité. « Je dis, d’accord. Elle me dit : « Je la sens même physiquement. Mon corps qui me faisait mal en permanence, ma féminité qui avait mal en permanence… » pas tant physiquement… Je ne sais pas, je n’ai pas exploré ce qu’elle voulait me dire dans ces mots… Mais en tout cas, dans sa chair meurtrie par ce qu’on lui avait fait par son corps, sa virginité lui était restituée par l’adoration eucharistique. Le regard chaste du Christ et son regard à elle posé sur le Christ venaient à la fois purifier son cœur et purifier son corps. Je crois que dans un monde très marqué par ça, par l’érotisme et la pornographie, l’adoration devient un lieu de guérison profonde. Qui a posé son regard sur le corps du Christ ne peut pas regarder le corps de l’autre n’importe comment. De la même manière que lorsque l’on a touché le corps du Christ on ne peut plus toucher son corps ou le corps de l’autre n’importe comment. La charnalité du Christ, la corporalité du Christ au Saint Sacrement me met en rapport immédiat avec mon corps. Et le respect du corps du Christ et l’adoration du corps du Christ renverse aussi ce mouvement-là. « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. »
Je pense qu’il y a aussi dans l’adoration eucharistique quelque chose d’assez extraordinaire qui se produit. C’est une… Je disais tout à l’heure que si l’homme est fait pour trouver le sens à sa vie, pour ad-orer, ̶ adorer veut dire "mettre une source à sa bouche pour en vivre". On ne peut pas vivre sans eau. Ou je mets ma bouche à la source de Dieu ; ou je la mets à d’autres sources frelatées. Il y a une autre chose qui me caractérise : je ne peux pas vivre sans une certaine dépendance. Si je ne dépends pas de l’unique nécessaire qui est Dieu, je vivrais dans des dépendances affectives diverses. Mon cœur sera balloté. Et ce cœur balloté va se trouver aussi, parfois, souillé. Et Dieu vient me redonner par l’adoration eucharistique la possibilité de m’attacher à l’unique nécessaire, Lui, et une purification aussi du cœur, une chasteté. « Tu nous as fait pour Toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose pas en Toi » dit saint Augustin. Il y a, par ce regard posé sur le Christ, une chasteté qui nous est donnée. Jésus dit : « Ton regard, c’est la fenêtre de ton cœur. Garde ton regard pur afin que ton regard soit pur. » On a accueilli une fille qui était dans la prostitution sadomasochiste, dix ans de prostitution, de violence et d’horreur « mais je ne peux même pas, Nicolas, te raconter ce que j’ai fait, parce que tu ne supporterais pas d’écouter ce que moi j’ai vécu. » Et à l’adoration eucharistique, elle passait des heures chaque jour. Elle s’en est sortie. Elle fait de belles études maintenant. Et un jour elle vient vers moi et elle me dit : « Mais tu sais, Nicolas, il semble que Jésus m’a recréé ma virginité. « Je dis, d’accord. Elle me dit : « Je la sens même physiquement. Mon corps qui me faisait mal en permanence, ma féminité qui avait mal en permanence… » pas tant physiquement… Je ne sais pas, je n’ai pas exploré ce qu’elle voulait me dire dans ces mots… Mais en tout cas, dans sa chair meurtrie par ce qu’on lui avait fait par son corps, sa virginité lui était restituée par l’adoration eucharistique. Le regard chaste du Christ et son regard à elle posé sur le Christ venaient à la fois purifier son cœur et purifier son corps. Je crois que dans un monde très marqué par ça, par l’érotisme et la pornographie, l’adoration devient un lieu de guérison profonde. Qui a posé son regard sur le corps du Christ ne peut pas regarder le corps de l’autre n’importe comment. De la même manière que lorsque l’on a touché le corps du Christ on ne peut plus toucher son corps ou le corps de l’autre n’importe comment. La charnalité du Christ, la corporalité du Christ au Saint Sacrement me met en rapport immédiat avec mon corps. Et le respect du corps du Christ et l’adoration du corps du Christ renverse aussi ce mouvement-là. « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. »
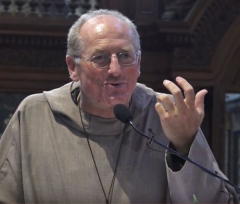 Tout ça passe aussi par ce fameux regard dont je vous parlais. Je crois que c’est très important. Si l’on expose Jésus au Saint Sacrement, c’est pour le regarder, voyez-vous. Autrement, c’est pas le Tabernacle. En Suisse, j’étais dans une chapelle, un jour… Il n’y a que les suisses pour faire ça… Le tabernacle était un coffre-fort. Les portes blindées du coffre-fort, vous voyez. Il fallait y penser, moi je n’y avais pas pensé… Mais… Voilà. En fait, c’est vrai, c’est un trésor, Jésus. Le seul trésor. C’est même plus important que tout ce qu’il y a dans les coffres-forts de toutes les banques suisses. Ce n’est même pas cette porte blindée qui empêchait Jésus de rayonner. Alors, pourquoi l’expose-t-on s’il est là dans le Tabernacle ? C’est parce qu’il y a ce mystère du regard qui peut se poser sur le vrai corps du Christ, sur la vraie corporalité. Le cardinal Journet avait cet exemple, il disait : Imaginez deux amoureux qui se téléphonent. Ils se parlent : je t’aime, moi aussi, mon petit lapin, ma petite chérie… tout ce qu’on veut comme petits diminutifs et tout d’un coup, paf ! ils tombent l’un sur l’autre. Ils se voient et ils s’embrassent. Vous voyez la différence ? Entre le coup de fil et l’étreinte. Si vous n’avez pas compris, vous ne pouvez pas comprendre l’adoration eucharistique. Si vous avez compris la différence qu’il y a entre un coup de fil et une étreinte, vous avez compris l’adoration eucharistique. C’est-à-dire qu’à un moment donné, vous passez d’une communication avec Jésus, d’une présence réelle, spirituelle, à une présence réelle, spirituelle et corporelle. Et la chair est importante.
Tout ça passe aussi par ce fameux regard dont je vous parlais. Je crois que c’est très important. Si l’on expose Jésus au Saint Sacrement, c’est pour le regarder, voyez-vous. Autrement, c’est pas le Tabernacle. En Suisse, j’étais dans une chapelle, un jour… Il n’y a que les suisses pour faire ça… Le tabernacle était un coffre-fort. Les portes blindées du coffre-fort, vous voyez. Il fallait y penser, moi je n’y avais pas pensé… Mais… Voilà. En fait, c’est vrai, c’est un trésor, Jésus. Le seul trésor. C’est même plus important que tout ce qu’il y a dans les coffres-forts de toutes les banques suisses. Ce n’est même pas cette porte blindée qui empêchait Jésus de rayonner. Alors, pourquoi l’expose-t-on s’il est là dans le Tabernacle ? C’est parce qu’il y a ce mystère du regard qui peut se poser sur le vrai corps du Christ, sur la vraie corporalité. Le cardinal Journet avait cet exemple, il disait : Imaginez deux amoureux qui se téléphonent. Ils se parlent : je t’aime, moi aussi, mon petit lapin, ma petite chérie… tout ce qu’on veut comme petits diminutifs et tout d’un coup, paf ! ils tombent l’un sur l’autre. Ils se voient et ils s’embrassent. Vous voyez la différence ? Entre le coup de fil et l’étreinte. Si vous n’avez pas compris, vous ne pouvez pas comprendre l’adoration eucharistique. Si vous avez compris la différence qu’il y a entre un coup de fil et une étreinte, vous avez compris l’adoration eucharistique. C’est-à-dire qu’à un moment donné, vous passez d’une communication avec Jésus, d’une présence réelle, spirituelle, à une présence réelle, spirituelle et corporelle. Et la chair est importante.
Et donc, dans la chair, le regard, qui est le sens qui m’extasie le plus ̶ alors que l’ouïe m’enstasie, fait rentrer en moi les sons et fait vibrer en moi le son qui rentre en moi ̶ le regard, l’adoration m’extasie, me sort de moi-même et me permet de voir celui qui m’aime. Á sainte Gertrude d’Helfta Jésus dit : « Autant de fois l’homme regarde avec amour et révérence l’Hostie qui contient sacramentellement le Corps et le Sang du Christ, autant il augmente ses mérites futurs. J’ai réservé des trésors d’amour et des récompenses particulières pour chaque regard qu’on aura dirigé vers le Saint Sacrement. » Á l’adoration, à l’élévation. Alors, ses sœurs baissaient la tête à l’élévation. Et elle, elle trichait. Elle regardait par-dessous comme ça. Et puis elle dit : « Jésus, ça t’embête ? – Non, ça me fait tellement plaisir. » Au point que le pape Pie X a dû accorder une indulgence particulière de plus de sept ans à quiconque au moment de l’élévation à la messe regarde Jésus en disant : « Mon Seigneur et mon Dieu ! ». Parce que l’amour veut regarder. L’amour regarde. Je voyais un couple, récemment. Ils viennent vers moi, ils ne se regardaient pas l’un l’autre. Ils disent : « On peut parler avec vous ? On a un problème. » Je dis : « Je savais. » « - Quelqu’un vous a dit ? » « - Non, j’ai vu. Vous ne vous êtes pas regardés depuis que vous êtes entrés ici. Vous n’avez pas échangé de regard entre vous. Quand on ne peut plus se regarder, on ne peut plus se voir. » C’est Raymond Devos, l’humoriste, qui disait : « Ma femme et moi on était tellement timide, qu’on n’osait pas se regarder. Après, on ne pouvait plus se voir. » Se regarder et se voir.
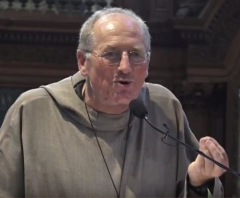 Autre maladie très forte aujourd’hui : la solitude. On parle beaucoup de cette maladie de la solitude. Et elle est réelle pour tant de personnes. Si je vais à l’adoration, le Christ vient rejoindre ce qui est le plus profond, ce qui est ma solitude. Mais ma solitude en tant que capacité d’être moi-même. Ce que Jean-Paul II appelait la solitude originelle dans le texte de la Genèse. Cette capacité d’exister sous le regard de Dieu, seul, qui me permet la vraie relation avec l’autre et avec les choses. Dieu, en venant combler ma solitude affective par sa Présence réelle, vient me restituer à cette solitude profonde qu’est la solitude originelle, seule capable de me mettre en relation avec les autres de manière juste et guérissante. Je passe donc, avec l’adoration, de Dieu pour moi, à moi pour Dieu. Je peux être capable de venir enfin dans ce qui est l’apothéose de ma dignité humaine, de m’offrir totalement à Dieu, de me donner à Dieu. Lui s’est offert à moi : « Prenez, mangez. » Ce n’est pas rien ! Il s’offre à moi pour que je m’offre à Lui.
Autre maladie très forte aujourd’hui : la solitude. On parle beaucoup de cette maladie de la solitude. Et elle est réelle pour tant de personnes. Si je vais à l’adoration, le Christ vient rejoindre ce qui est le plus profond, ce qui est ma solitude. Mais ma solitude en tant que capacité d’être moi-même. Ce que Jean-Paul II appelait la solitude originelle dans le texte de la Genèse. Cette capacité d’exister sous le regard de Dieu, seul, qui me permet la vraie relation avec l’autre et avec les choses. Dieu, en venant combler ma solitude affective par sa Présence réelle, vient me restituer à cette solitude profonde qu’est la solitude originelle, seule capable de me mettre en relation avec les autres de manière juste et guérissante. Je passe donc, avec l’adoration, de Dieu pour moi, à moi pour Dieu. Je peux être capable de venir enfin dans ce qui est l’apothéose de ma dignité humaine, de m’offrir totalement à Dieu, de me donner à Dieu. Lui s’est offert à moi : « Prenez, mangez. » Ce n’est pas rien ! Il s’offre à moi pour que je m’offre à Lui.
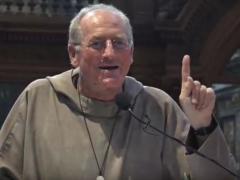 Et Dieu devient aussi la force des martyrs. Le bienheureux Fulton Sheen disait que ce qui l’a bouleversé dans sa vie ̶ c’était un évêque américain, il a fait des émissions télévisées, des millions de personnes regardaient ça, Pie XII le regardait, ou l’écoutait à la radio, en tout cas ̶ et donc, il dit : Enfant, j’ai appris ça un jour, à l’époque de la révolution des boxers en Chine, en 1917. Des gens sont venus dans une église, ont profané le Saint Sacrement, ont mis le prêtre aux arrêts dans le presbytère. Et le prêtre voyait une jeune fille de onze ans, une petite chinoise. Ils avaient jeté le Saint Sacrement par terre et le prêtre savait exactement qu’il y avait trente-deux hosties dans le tabernacle, trente-deux parcelles du Corps du Christ qui étaient là. Et le prêtre voyait depuis sa fenêtre, toutes les nuits, quand les gardes dormaient ou étaient distraits, cette fille qui allait là-bas. Pendant une heure, elle adorait Jésus sur le sol et avec sa langue, elle prenait une hostie, comme ça. Un jour, deux jours, trente et un jours. Il dit : Le trente deuxième jour, j’ai vu arriver cette fille : « L’enfant revînt et échappant à la vigilance des gardes, s’agenouillait, se baissait à quatre pattes après avoir passé une heure en adoration et lapait une hostie de sa langue. Un jour, il ne restait plus qu’une dernière hostie que la petite consomma comme d’habitude. Mais elle fit, sans le vouloir, un bruit qui éveilla l’attention du garde. Celui-ci courut derrière elle, l’attrapa, et la frappa avec la crosse de son arme. » Il l’a tuée comme ça. Fulton Sheen dit : « Depuis ce récit j’ai fait la promesse que jusqu’à ma mort je passerai une heure d’adoration chaque jour devant le Saint Sacrement. Une promesse que j’ai tenue pendant les soixante années de ma vie sacerdotale. » Puisque c’est devant le Saint Sacrement exposé, dans sa chapelle privée, qu’il est mort le 9 décembre 1979.
Et Dieu devient aussi la force des martyrs. Le bienheureux Fulton Sheen disait que ce qui l’a bouleversé dans sa vie ̶ c’était un évêque américain, il a fait des émissions télévisées, des millions de personnes regardaient ça, Pie XII le regardait, ou l’écoutait à la radio, en tout cas ̶ et donc, il dit : Enfant, j’ai appris ça un jour, à l’époque de la révolution des boxers en Chine, en 1917. Des gens sont venus dans une église, ont profané le Saint Sacrement, ont mis le prêtre aux arrêts dans le presbytère. Et le prêtre voyait une jeune fille de onze ans, une petite chinoise. Ils avaient jeté le Saint Sacrement par terre et le prêtre savait exactement qu’il y avait trente-deux hosties dans le tabernacle, trente-deux parcelles du Corps du Christ qui étaient là. Et le prêtre voyait depuis sa fenêtre, toutes les nuits, quand les gardes dormaient ou étaient distraits, cette fille qui allait là-bas. Pendant une heure, elle adorait Jésus sur le sol et avec sa langue, elle prenait une hostie, comme ça. Un jour, deux jours, trente et un jours. Il dit : Le trente deuxième jour, j’ai vu arriver cette fille : « L’enfant revînt et échappant à la vigilance des gardes, s’agenouillait, se baissait à quatre pattes après avoir passé une heure en adoration et lapait une hostie de sa langue. Un jour, il ne restait plus qu’une dernière hostie que la petite consomma comme d’habitude. Mais elle fit, sans le vouloir, un bruit qui éveilla l’attention du garde. Celui-ci courut derrière elle, l’attrapa, et la frappa avec la crosse de son arme. » Il l’a tuée comme ça. Fulton Sheen dit : « Depuis ce récit j’ai fait la promesse que jusqu’à ma mort je passerai une heure d’adoration chaque jour devant le Saint Sacrement. Une promesse que j’ai tenue pendant les soixante années de ma vie sacerdotale. » Puisque c’est devant le Saint Sacrement exposé, dans sa chapelle privée, qu’il est mort le 9 décembre 1979.
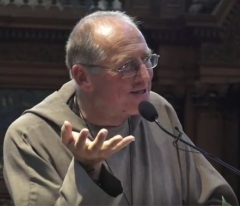 Je vous parle aussi, mais j’irai très vite, de l’aspect cosmique et social. En un mot : ou le monde est dévoré par la consommation et défiguré par la consommation, ou il est transfiguré par l’adoration. C’est l’alternative dans laquelle nous nous trouvons. Ou la défiguration par la consommation, ou la transfiguration par l’adoration. L’adoration nous donne un vrai rapport aux choses et aux biens. Non pas un rapport de possession, de maîtrise et d’absorption. Mais un rapport de respect et d’utilisation pour le bien de tous. L’Eucharistie est donc à la charnière, aussi, d’un monde nouveau. Elle est aussi l’adoration réparatrice. C’est là que le monde nouveau est en train de se créer. Saint Pierre-Julien Eymard disait : « Le culte de l’adoration est nécessaire pour sauver la société. La société se meurt parce qu’elle n’a pas de centre de vérité, de charité. Mais elle renaîtra pleine de vigueur quand tous ses membres viendront se réunir autour de la vie à Jésus dans l’Eucharistie. Il faut Le faire sortir de sa retraite pour qu’Il se mette de nouveau à la tête des sociétés chrétiennes qu’Il dirigera et sauvera. Il faut lui construire un palais, un trône royal, une cour de fidèles serviteurs, une famille d’amis, un peuple d’adorateurs. Maintenant, il faut se mettre à l’œuvre, sauver les âmes et le monde par la divine eucharistie. Réveiller la France et l’Europe engourdis dans un sommeil d’indifférence parce qu’elles ne connaissent pas le don de Dieu, Jésus, l’Emmanuel eucharistique. C’est la torche de l’amour qu’il faut porter dans les âmes tièdes et qui se croient pieuses et ne le sont pas, parce qu’elles n’ont pas établi leur centre et leur vie dans Jésus-Eucharistie. » Au point que Jean-Paul II pouvait dire que tous les maux de la terre peuvent être guéris grâce à l’adoration permanente du Saint Sacrement. Quand on demandait à Mère Teresa comment faire pour guérir ce monde et ramener… – ce sont des américains qui avaient écrit L’Amérique à Jésus : « Instaurez dans toutes vos paroisses l’adoration perpétuelle du Saint Sacrement. » Voilà la réponse de Mère Teresa. Guérison aussi des communautés paroissiales grâce à ça. Benoît XVI disait que la vraie crise de l’Occident c’était la crise de la foi. Comment ramener les gens à la foi et à l’expérience de Jésus ? Il disait : « Une telle voie pourrait être des petites communautés où se vivent les amitiés qui sont approfondies dans la fréquente adoration communautaire de Dieu. » Voilà le remède que Benoît XVI trouve. Il disait cela en Allemagne, dans l’Église organisée d’Allemagne, extrêmement structurée, riche et tout ce que vous voulez, mais morte, disait Benoît XVI, parce qu’elle n’a pas son centre de gravité là où c’est important. Au monde de la violence va s’établir le monde de la paix du Christ eucharistique. Jésus dit à Faustine : « Dis bien au monde entier qu’il n’y aura pas de paix dans le monde si l’on ne vient pas à ma miséricorde. Or, le trône de ma miséricorde sur la terre, c’est l’Eucharistie, c’est le Tabernacle. » Ça veut dire : Dis bien au monde entier qu’il n’y aura pas de paix dans les cœurs, dans les familles, dans la société, si l’on ne vient pas à l’Eucharistie. Et pas de paix, à mon avis c’est aussi grave que ce que Marie disait à Fatima : « Si l’on ne vient pas à Jésus, une guerre plus grave éclatera sous le pontificat de Pie XI. » C’était Benoît XV qui était pape à l’époque. Pie XI arrive en 22 alors que cette révélation est en 17. Et la guerre éclatera en 38 avec soixante millions de morts. Cette parole à sainte Faustine est capitale. La paix que nous cherchons, la paix que nous désirons, en Syrie, partout, c’est au cœur miséricordieux eucharistique du Christ qu’on va pouvoir la puiser et la voir.
Je vous parle aussi, mais j’irai très vite, de l’aspect cosmique et social. En un mot : ou le monde est dévoré par la consommation et défiguré par la consommation, ou il est transfiguré par l’adoration. C’est l’alternative dans laquelle nous nous trouvons. Ou la défiguration par la consommation, ou la transfiguration par l’adoration. L’adoration nous donne un vrai rapport aux choses et aux biens. Non pas un rapport de possession, de maîtrise et d’absorption. Mais un rapport de respect et d’utilisation pour le bien de tous. L’Eucharistie est donc à la charnière, aussi, d’un monde nouveau. Elle est aussi l’adoration réparatrice. C’est là que le monde nouveau est en train de se créer. Saint Pierre-Julien Eymard disait : « Le culte de l’adoration est nécessaire pour sauver la société. La société se meurt parce qu’elle n’a pas de centre de vérité, de charité. Mais elle renaîtra pleine de vigueur quand tous ses membres viendront se réunir autour de la vie à Jésus dans l’Eucharistie. Il faut Le faire sortir de sa retraite pour qu’Il se mette de nouveau à la tête des sociétés chrétiennes qu’Il dirigera et sauvera. Il faut lui construire un palais, un trône royal, une cour de fidèles serviteurs, une famille d’amis, un peuple d’adorateurs. Maintenant, il faut se mettre à l’œuvre, sauver les âmes et le monde par la divine eucharistie. Réveiller la France et l’Europe engourdis dans un sommeil d’indifférence parce qu’elles ne connaissent pas le don de Dieu, Jésus, l’Emmanuel eucharistique. C’est la torche de l’amour qu’il faut porter dans les âmes tièdes et qui se croient pieuses et ne le sont pas, parce qu’elles n’ont pas établi leur centre et leur vie dans Jésus-Eucharistie. » Au point que Jean-Paul II pouvait dire que tous les maux de la terre peuvent être guéris grâce à l’adoration permanente du Saint Sacrement. Quand on demandait à Mère Teresa comment faire pour guérir ce monde et ramener… – ce sont des américains qui avaient écrit L’Amérique à Jésus : « Instaurez dans toutes vos paroisses l’adoration perpétuelle du Saint Sacrement. » Voilà la réponse de Mère Teresa. Guérison aussi des communautés paroissiales grâce à ça. Benoît XVI disait que la vraie crise de l’Occident c’était la crise de la foi. Comment ramener les gens à la foi et à l’expérience de Jésus ? Il disait : « Une telle voie pourrait être des petites communautés où se vivent les amitiés qui sont approfondies dans la fréquente adoration communautaire de Dieu. » Voilà le remède que Benoît XVI trouve. Il disait cela en Allemagne, dans l’Église organisée d’Allemagne, extrêmement structurée, riche et tout ce que vous voulez, mais morte, disait Benoît XVI, parce qu’elle n’a pas son centre de gravité là où c’est important. Au monde de la violence va s’établir le monde de la paix du Christ eucharistique. Jésus dit à Faustine : « Dis bien au monde entier qu’il n’y aura pas de paix dans le monde si l’on ne vient pas à ma miséricorde. Or, le trône de ma miséricorde sur la terre, c’est l’Eucharistie, c’est le Tabernacle. » Ça veut dire : Dis bien au monde entier qu’il n’y aura pas de paix dans les cœurs, dans les familles, dans la société, si l’on ne vient pas à l’Eucharistie. Et pas de paix, à mon avis c’est aussi grave que ce que Marie disait à Fatima : « Si l’on ne vient pas à Jésus, une guerre plus grave éclatera sous le pontificat de Pie XI. » C’était Benoît XV qui était pape à l’époque. Pie XI arrive en 22 alors que cette révélation est en 17. Et la guerre éclatera en 38 avec soixante millions de morts. Cette parole à sainte Faustine est capitale. La paix que nous cherchons, la paix que nous désirons, en Syrie, partout, c’est au cœur miséricordieux eucharistique du Christ qu’on va pouvoir la puiser et la voir.
 Ultimement, le dernier point, le quatrième point c’est que l’Eucharistie est déjà la vie éternelle. Jésus va venir dans la gloire, on appelle ça la parousie. La venue ultime : plus de larmes, plus rien, les cieux nouveaux, une terre nouvelle. Nous croyons à ça ! Parousie veut dire en grec venue mais aussi présence. Il y a déjà dans la parousie eucharistique la présence du Christ, déjà les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Et c’est ce qu’on va recevoir tout à l’heure. Amen.
Ultimement, le dernier point, le quatrième point c’est que l’Eucharistie est déjà la vie éternelle. Jésus va venir dans la gloire, on appelle ça la parousie. La venue ultime : plus de larmes, plus rien, les cieux nouveaux, une terre nouvelle. Nous croyons à ça ! Parousie veut dire en grec venue mais aussi présence. Il y a déjà dans la parousie eucharistique la présence du Christ, déjà les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Et c’est ce qu’on va recevoir tout à l’heure. Amen.
Père Nicolas Buttet
Enseignement L’Eucharistie et la guérison
du mercredi 12 juillet 2017
Basilique Ste Marie-Madeleine, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var).
Congrès sur l'Adoration Eucharistique, Adoratio 2017,
avec pour thème "Adorer au Cœur du Monde"
du 9 au 14 juillet 2017.

Retrouvez cet article sur la page enrichie :
Adoration Saint Martin
 10 minutes de présentation aux élèves d’une classe de 3ème
10 minutes de présentation aux élèves d’une classe de 3ème 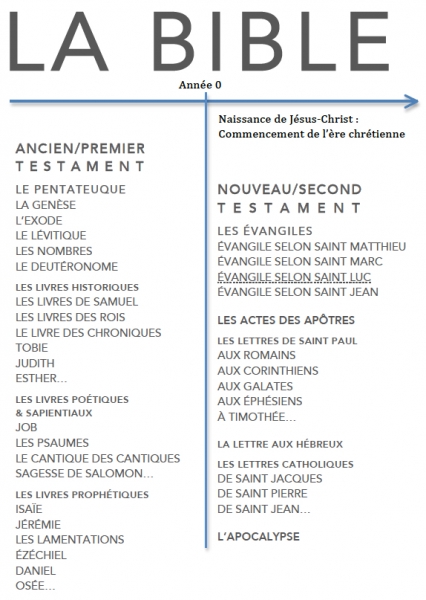


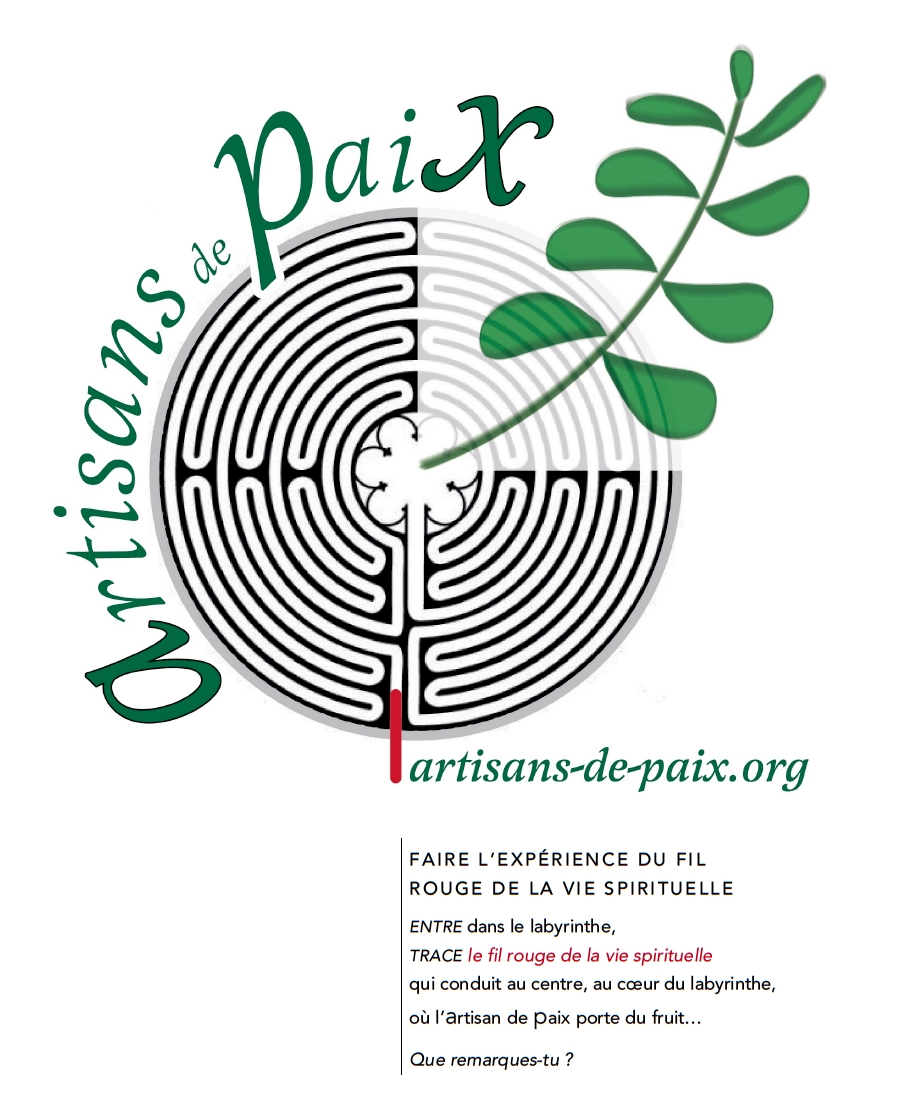
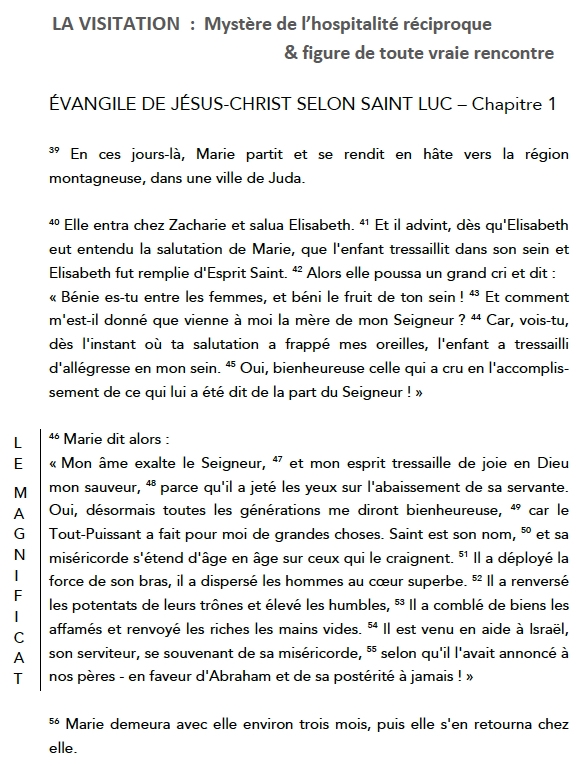


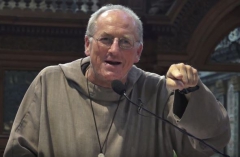

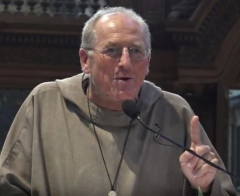

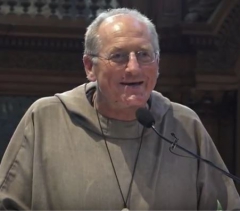



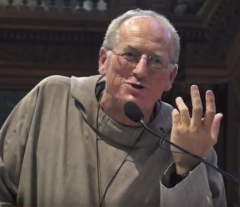

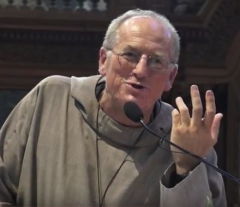

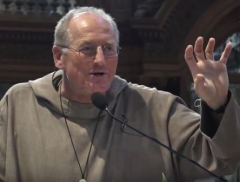


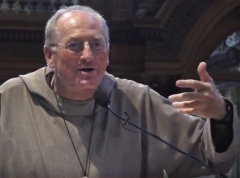


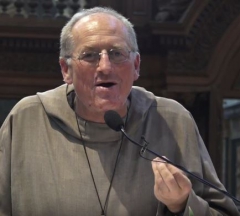
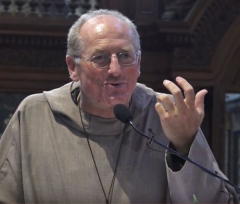
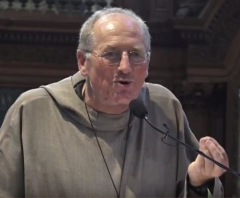
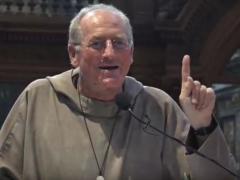
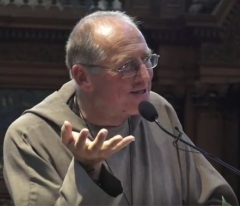 Je vous parle aussi, mais j’irai très vite, de l’aspect cosmique et social. En un mot : ou le monde est dévoré par la consommation et défiguré par la consommation, ou il est transfiguré par l’adoration. C’est l’alternative dans laquelle nous nous trouvons. Ou la défiguration par la consommation, ou la transfiguration par l’adoration. L’adoration nous donne un vrai rapport aux choses et aux biens. Non pas un rapport de possession, de maîtrise et d’absorption. Mais un rapport de respect et d’utilisation pour le bien de tous. L’Eucharistie est donc à la charnière, aussi, d’un monde nouveau. Elle est aussi l’adoration réparatrice. C’est là que le monde nouveau est en train de se créer. Saint Pierre-Julien Eymard disait : « Le culte de l’adoration est nécessaire pour sauver la société. La société se meurt parce qu’elle n’a pas de centre de vérité, de charité. Mais elle renaîtra pleine de vigueur quand tous ses membres viendront se réunir autour de la vie à Jésus dans l’Eucharistie. Il faut Le faire sortir de sa retraite pour qu’Il se mette de nouveau à la tête des sociétés chrétiennes qu’Il dirigera et sauvera. Il faut lui construire un palais, un trône royal, une cour de fidèles serviteurs, une famille d’amis, un peuple d’adorateurs. Maintenant, il faut se mettre à l’œuvre, sauver les âmes et le monde par la divine eucharistie. Réveiller la France et l’Europe engourdis dans un sommeil d’indifférence parce qu’elles ne connaissent pas le don de Dieu, Jésus, l’Emmanuel eucharistique. C’est la torche de l’amour qu’il faut porter dans les âmes tièdes et qui se croient pieuses et ne le sont pas, parce qu’elles n’ont pas établi leur centre et leur vie dans Jésus-Eucharistie. » Au point que Jean-Paul II pouvait dire que tous les maux de la terre peuvent être guéris grâce à l’adoration permanente du Saint Sacrement. Quand on demandait à Mère Teresa comment faire pour guérir ce monde et ramener… – ce sont des américains qui avaient écrit L’Amérique à Jésus
Je vous parle aussi, mais j’irai très vite, de l’aspect cosmique et social. En un mot : ou le monde est dévoré par la consommation et défiguré par la consommation, ou il est transfiguré par l’adoration. C’est l’alternative dans laquelle nous nous trouvons. Ou la défiguration par la consommation, ou la transfiguration par l’adoration. L’adoration nous donne un vrai rapport aux choses et aux biens. Non pas un rapport de possession, de maîtrise et d’absorption. Mais un rapport de respect et d’utilisation pour le bien de tous. L’Eucharistie est donc à la charnière, aussi, d’un monde nouveau. Elle est aussi l’adoration réparatrice. C’est là que le monde nouveau est en train de se créer. Saint Pierre-Julien Eymard disait : « Le culte de l’adoration est nécessaire pour sauver la société. La société se meurt parce qu’elle n’a pas de centre de vérité, de charité. Mais elle renaîtra pleine de vigueur quand tous ses membres viendront se réunir autour de la vie à Jésus dans l’Eucharistie. Il faut Le faire sortir de sa retraite pour qu’Il se mette de nouveau à la tête des sociétés chrétiennes qu’Il dirigera et sauvera. Il faut lui construire un palais, un trône royal, une cour de fidèles serviteurs, une famille d’amis, un peuple d’adorateurs. Maintenant, il faut se mettre à l’œuvre, sauver les âmes et le monde par la divine eucharistie. Réveiller la France et l’Europe engourdis dans un sommeil d’indifférence parce qu’elles ne connaissent pas le don de Dieu, Jésus, l’Emmanuel eucharistique. C’est la torche de l’amour qu’il faut porter dans les âmes tièdes et qui se croient pieuses et ne le sont pas, parce qu’elles n’ont pas établi leur centre et leur vie dans Jésus-Eucharistie. » Au point que Jean-Paul II pouvait dire que tous les maux de la terre peuvent être guéris grâce à l’adoration permanente du Saint Sacrement. Quand on demandait à Mère Teresa comment faire pour guérir ce monde et ramener… – ce sont des américains qui avaient écrit L’Amérique à Jésus 

 Je me souviens de la démarche intellectuelle des deux derniers papes, Jean Paul II et Benoit XVI. Tous les deux professeurs d’université qui, voyant un élève adhérer à des positions inverses de celles qu’ils développaient, se taisaient et se mettaient avec une acuité accrue à l’écoute profonde et sincère de ”leur adversaire”. Ils cherchaient en celui-ci les raisons justes qui l’avaient amené à cette position. Non pas pour les réfuter systématiquement mais pour dégager la vérité profonde qui pouvait sortir des éléments passionnels ou idéologiques. Cette position fût celle du Cal Ratzinger avec ”son ami” Hans Küng, ou Wojtyla proposant les conférences au journal Znack avec des personnalités comme Martin Frybes ou Adam Michnick ”marxiste anti communiste !! ”. C’est grâce à cette logique du principe des recoupements que le régime de fer communiste est tombé. Le diable diabolos effaçant toute possibilité de raisonnement pour ne retenir que la peur et la colère qui sont les lieux où il se complait en insistant sur ce qui divise les personnes, même les plus proches.
Je me souviens de la démarche intellectuelle des deux derniers papes, Jean Paul II et Benoit XVI. Tous les deux professeurs d’université qui, voyant un élève adhérer à des positions inverses de celles qu’ils développaient, se taisaient et se mettaient avec une acuité accrue à l’écoute profonde et sincère de ”leur adversaire”. Ils cherchaient en celui-ci les raisons justes qui l’avaient amené à cette position. Non pas pour les réfuter systématiquement mais pour dégager la vérité profonde qui pouvait sortir des éléments passionnels ou idéologiques. Cette position fût celle du Cal Ratzinger avec ”son ami” Hans Küng, ou Wojtyla proposant les conférences au journal Znack avec des personnalités comme Martin Frybes ou Adam Michnick ”marxiste anti communiste !! ”. C’est grâce à cette logique du principe des recoupements que le régime de fer communiste est tombé. Le diable diabolos effaçant toute possibilité de raisonnement pour ne retenir que la peur et la colère qui sont les lieux où il se complait en insistant sur ce qui divise les personnes, même les plus proches. 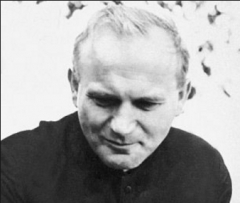 Mon temps polonais pour moi a beaucoup construit mon jugement. Une violence d’état interdisant tout débat sur le fond, comme aujourd’hui en France, nécessitait une intelligence de comportement dans les positions politiques. Les professeurs Tischner et Wojniakowski rappelaient à tous la priorité du combat au-delà de toute attache partisane : Défendre l’identité polonaise, l’apport de la culture polonaise dans la construction de l’unité de la patrie et rassembler autour de ces principes simples la nation polonaise. Les héroïques professeurs de l’université Jagelon, comme le Pr Wojniakovski soutenus par l’archevêque de Cracovie Mgr Wojtyla, maintenaient le fil.
Mon temps polonais pour moi a beaucoup construit mon jugement. Une violence d’état interdisant tout débat sur le fond, comme aujourd’hui en France, nécessitait une intelligence de comportement dans les positions politiques. Les professeurs Tischner et Wojniakowski rappelaient à tous la priorité du combat au-delà de toute attache partisane : Défendre l’identité polonaise, l’apport de la culture polonaise dans la construction de l’unité de la patrie et rassembler autour de ces principes simples la nation polonaise. Les héroïques professeurs de l’université Jagelon, comme le Pr Wojniakovski soutenus par l’archevêque de Cracovie Mgr Wojtyla, maintenaient le fil.  À l’exemple de cet immense pape, sans renier notre personnalité ni nos convictions, définissons paisiblement dans nos positions politiques nos priorités : l’identité de ma patrie et la culture propre de ma civilisation. Le Père Popiełuzsko, dans ses sermons pour la patrie, touchait là les fondements de l’autorité morale de l’Etat communiste. Celui-ci avait bien compris que cette catéchèse mettait à jour l’incohérence de son système et la contradiction brutale de l’idéologie marxiste avec l’âme polonaise. On connaît sa réponse à celui dont la cause de canonisation est en route. La mort. Comme Jean Paul II, sera l’objet d’un attentat. Tout le travail de résistance de ce dernier s’est centré sur ce ”combat”. Abattre le marxisme pour lui passait par la construction de l’âme polonaise comme Soljenitsyne fera un immense travail de reconstruction culturelle de l’âme russe. On en trouve la synthèse dans son dernier petit livre : Comment reconstruire notre Russie. C’est un peu la réponse à son fameux discours de Harvard qui dénonçait la mort de l’âme de nos nations, ce qui pour nous est d’une cruelle actualité.
À l’exemple de cet immense pape, sans renier notre personnalité ni nos convictions, définissons paisiblement dans nos positions politiques nos priorités : l’identité de ma patrie et la culture propre de ma civilisation. Le Père Popiełuzsko, dans ses sermons pour la patrie, touchait là les fondements de l’autorité morale de l’Etat communiste. Celui-ci avait bien compris que cette catéchèse mettait à jour l’incohérence de son système et la contradiction brutale de l’idéologie marxiste avec l’âme polonaise. On connaît sa réponse à celui dont la cause de canonisation est en route. La mort. Comme Jean Paul II, sera l’objet d’un attentat. Tout le travail de résistance de ce dernier s’est centré sur ce ”combat”. Abattre le marxisme pour lui passait par la construction de l’âme polonaise comme Soljenitsyne fera un immense travail de reconstruction culturelle de l’âme russe. On en trouve la synthèse dans son dernier petit livre : Comment reconstruire notre Russie. C’est un peu la réponse à son fameux discours de Harvard qui dénonçait la mort de l’âme de nos nations, ce qui pour nous est d’une cruelle actualité. Il faut prendre acte que l’autre, en raison des innombrables couches sédimentaires qui ont construit son raisonnement et sa psychologie, ne peut pas en un dîner adhérer à tout ce qui nous a structurés parfois de façon privilégiée. Présentons à l’exemple de Ste Bernadette ce que nous savons de notre patrie mais avec la conscience que nous ne savons pas si notre interlocuteur le croira. « Nous ne sommes pas là pour vous le faire croire mais pour vous le dire » ! Or Bernadette Soubirous est venu au moment où les loges prenaient une grande ampleur sur les consciences en France.
Il faut prendre acte que l’autre, en raison des innombrables couches sédimentaires qui ont construit son raisonnement et sa psychologie, ne peut pas en un dîner adhérer à tout ce qui nous a structurés parfois de façon privilégiée. Présentons à l’exemple de Ste Bernadette ce que nous savons de notre patrie mais avec la conscience que nous ne savons pas si notre interlocuteur le croira. « Nous ne sommes pas là pour vous le faire croire mais pour vous le dire » ! Or Bernadette Soubirous est venu au moment où les loges prenaient une grande ampleur sur les consciences en France. Contingentement et sans passion :
Contingentement et sans passion : 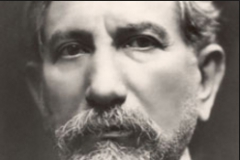 Ma priorité est de bloquer au premier tour toute possibilité à ce monde délétère d’être présent. C’est mon choix pour Fillon. Si malgré cela Macron devait passer au premier tour je voterai sans hésiter pour une fille qui dit vouloir défendre la France, refuser tout compromis avec la GPA et la PMA et proclame haut et fort que la France a une longue histoire fondée sur ses racines chrétiennes. Je n’ai aucune sympathie et pour l’un et pour l’autre et je comprends qu’on puisse ne pas en avoir ; ceux qui m’ont développé leur opposition à celle-ci ont des arguments. Mais je reste Maurrassien (toujours) ; j’estime que dans une guerre il faut faire des choix, les non choix sont des choix par défaut qui profitent à l’ennemi ; ici ils donnent du terrain à celui qu’on a défini comme le plus dangereux pour notre âme. Toujours Maurras : la politique du pire n’est jamais la meilleure. Pie XII a officiellement soutenu ceux qui prêchaient l’alliance avec l’URSS en 1942 pour abattre le nazisme. De Gaulle n’a eu aucun état d’âme à employer les communistes qui, six mois plus tôt étaient les alliés des allemands ! dans sa lutte contre les nazis. Sans vouloir accabler la pauvre Marine d’une telle comparaison j’ai conscience que l’alternative proposée est pire pour notre âme avec Macron qu’avec celle-ci. C’est la position cohérente de Villiers, même si celui-ci fait l’erreur de laisser entendre qu’il soutiendrait celle-ci dès le premier tour, ce qui n’est pas tactiquement judicieux. Mais ses raisons tiennent pour lui à des règlements de compte personnels à assouvir.
Ma priorité est de bloquer au premier tour toute possibilité à ce monde délétère d’être présent. C’est mon choix pour Fillon. Si malgré cela Macron devait passer au premier tour je voterai sans hésiter pour une fille qui dit vouloir défendre la France, refuser tout compromis avec la GPA et la PMA et proclame haut et fort que la France a une longue histoire fondée sur ses racines chrétiennes. Je n’ai aucune sympathie et pour l’un et pour l’autre et je comprends qu’on puisse ne pas en avoir ; ceux qui m’ont développé leur opposition à celle-ci ont des arguments. Mais je reste Maurrassien (toujours) ; j’estime que dans une guerre il faut faire des choix, les non choix sont des choix par défaut qui profitent à l’ennemi ; ici ils donnent du terrain à celui qu’on a défini comme le plus dangereux pour notre âme. Toujours Maurras : la politique du pire n’est jamais la meilleure. Pie XII a officiellement soutenu ceux qui prêchaient l’alliance avec l’URSS en 1942 pour abattre le nazisme. De Gaulle n’a eu aucun état d’âme à employer les communistes qui, six mois plus tôt étaient les alliés des allemands ! dans sa lutte contre les nazis. Sans vouloir accabler la pauvre Marine d’une telle comparaison j’ai conscience que l’alternative proposée est pire pour notre âme avec Macron qu’avec celle-ci. C’est la position cohérente de Villiers, même si celui-ci fait l’erreur de laisser entendre qu’il soutiendrait celle-ci dès le premier tour, ce qui n’est pas tactiquement judicieux. Mais ses raisons tiennent pour lui à des règlements de compte personnels à assouvir.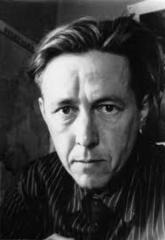 Dans tous les cas nous devrons travailler à l’exemple de Soljenystsine pour la Russie, de Jean Paul II pour la Pologne, à la reconstruction des intelligences de nos enfants.
Dans tous les cas nous devrons travailler à l’exemple de Soljenystsine pour la Russie, de Jean Paul II pour la Pologne, à la reconstruction des intelligences de nos enfants.
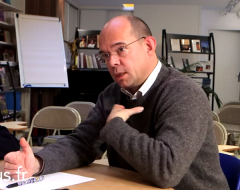 Xavier Lemoine
Xavier Lemoine Camel Bechikh
Camel Bechikh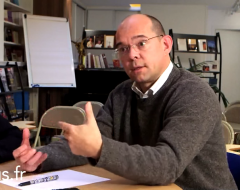 X.L.
X.L.
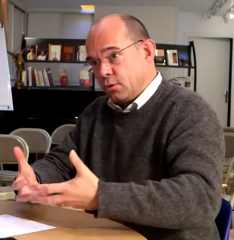 X.L.
X.L. C.B.
C.B. C.B.
C.B.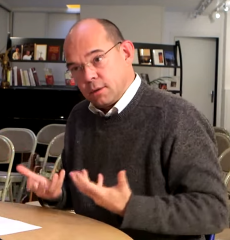 X.L.
X.L. C.B.
C.B. 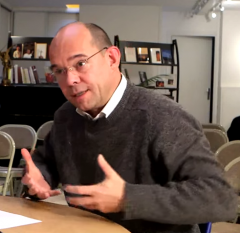 X.L.
X.L.  C.B.
C.B.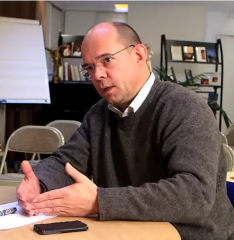 X.L. -
X.L. - C.B.
C.B. X.L.
X.L.  Propos recueillis par Guillaume de Prémare (
Propos recueillis par Guillaume de Prémare (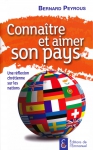
 J’avais le choix entre parler avec un micro ou parler en chaire. J’ai préféré parler en chaire. J’espère que vous allez m’entendre jusqu'au bout… Ça va ? Voyez-vous, c’était fait pour ça. La chaire que nous n’employons plus était justement une manière de surélever celui qui parlait, parce que comme le son tend à retomber, tout le monde l’entendait. En revanche, si vous faites un sermon depuis l’autel, finalement les gens vous entendent moins. J’ai fait deux conférences aujourd’hui avec un micro, dans une église, vous êtes les quatrièmes, et là je me suis dit que ce serait bien de le faire sans micro. On ne réfléchit jamais à ce que fait le micro. Le micro se propose comme un instrument, technique, qui vient simplement nous aider, de telle sorte que la voix est amplifiée. Donc ça, comme un petit plus. Mais en réalité l’introduction de cette technique, de cette technologie, qui apparaissait juste comme un instrument, vous voyez, a transformé les usages liturgiques. Avant, on proclamait l’Evangile. On était obligé de projeter sa voix. Quand vous lisez l’Évangile en projetant votre voix, forcément, vous ne pouvez pas entrer dans de la petite psychologie, de l’intimisme, parler de ‘Jésus’. Ce côté qui est lié à une sorte d’“efféminement”, un peu, on pourrait dire, de la pratique liturgique. Autrefois, vous étiez là-bas, vous étiez obligé de projeter votre voix, et c’était justement une messe solennelle, avec une vraie proclamation. Mais ce qui s’est passé, c’est que quand on a introduit le micro, on a changé le style de la célébration qui devenait intimiste, gentillet, entre nous, sentimental. Et puis, surtout, il n’y avait plus de messe solennelle : on n’a fait qu’amplifier des messes basses. Tout devenait dans le style, de l’ordre de la messe basse. Alors, vous savez qu’il y a des querelles liturgiques sur la forme ordinaire, extraordinaire, les rubriques à suivre ou pas. Mais il y a très peu de réflexion sur l’introduction de certaine technologie qui ont transformé nos usages liturgiques. La lumière électrique : est-ce qu’une église est faite pour être éclairée avec un éclairage électrique ? Autrefois, il y avait des bougies. Les flammes faisaient danser les couleurs des statues. Le micro fait que l’espace d’une église qui était comme une caisse de résonnance est devenu un problème. Parce que dès que vous commencez à mettre un micro, vous devez sonoriser ; mais quand vous sonorisez, vous êtes obligé de compenser les problèmes de réverbérations de l’église ; vous devez donc acheter des enceintes très spécifiques, allongées, pour que le son passe mieux… Et même, on va dire : « On va condamner la chaire. » Vous voyez, cette chaire, normalement on ne l’utilise plus depuis quelques décennies. De telle sorte que l’église devient un problème : il vaudrait mieux une salle de concert, ou une salle de cours. Parce qu’elle résonne trop, tout d’un coup. Pourquoi est-ce que je commence par cela ? D’abord parce que je dois tout le temps parler sur le même thème mais je ne supporte pas de dire la même chose, donc j’ai pris un autre point de départ. J’ai changé les conditions de la conférence pour vous parler autrement que je ne l’ai fait dans les autres conférences. J’ai prévu pour la dernière conférence que je dois faire à 21h30 de boire plusieurs bières, comme ça je serai dans un état différent.
J’avais le choix entre parler avec un micro ou parler en chaire. J’ai préféré parler en chaire. J’espère que vous allez m’entendre jusqu'au bout… Ça va ? Voyez-vous, c’était fait pour ça. La chaire que nous n’employons plus était justement une manière de surélever celui qui parlait, parce que comme le son tend à retomber, tout le monde l’entendait. En revanche, si vous faites un sermon depuis l’autel, finalement les gens vous entendent moins. J’ai fait deux conférences aujourd’hui avec un micro, dans une église, vous êtes les quatrièmes, et là je me suis dit que ce serait bien de le faire sans micro. On ne réfléchit jamais à ce que fait le micro. Le micro se propose comme un instrument, technique, qui vient simplement nous aider, de telle sorte que la voix est amplifiée. Donc ça, comme un petit plus. Mais en réalité l’introduction de cette technique, de cette technologie, qui apparaissait juste comme un instrument, vous voyez, a transformé les usages liturgiques. Avant, on proclamait l’Evangile. On était obligé de projeter sa voix. Quand vous lisez l’Évangile en projetant votre voix, forcément, vous ne pouvez pas entrer dans de la petite psychologie, de l’intimisme, parler de ‘Jésus’. Ce côté qui est lié à une sorte d’“efféminement”, un peu, on pourrait dire, de la pratique liturgique. Autrefois, vous étiez là-bas, vous étiez obligé de projeter votre voix, et c’était justement une messe solennelle, avec une vraie proclamation. Mais ce qui s’est passé, c’est que quand on a introduit le micro, on a changé le style de la célébration qui devenait intimiste, gentillet, entre nous, sentimental. Et puis, surtout, il n’y avait plus de messe solennelle : on n’a fait qu’amplifier des messes basses. Tout devenait dans le style, de l’ordre de la messe basse. Alors, vous savez qu’il y a des querelles liturgiques sur la forme ordinaire, extraordinaire, les rubriques à suivre ou pas. Mais il y a très peu de réflexion sur l’introduction de certaine technologie qui ont transformé nos usages liturgiques. La lumière électrique : est-ce qu’une église est faite pour être éclairée avec un éclairage électrique ? Autrefois, il y avait des bougies. Les flammes faisaient danser les couleurs des statues. Le micro fait que l’espace d’une église qui était comme une caisse de résonnance est devenu un problème. Parce que dès que vous commencez à mettre un micro, vous devez sonoriser ; mais quand vous sonorisez, vous êtes obligé de compenser les problèmes de réverbérations de l’église ; vous devez donc acheter des enceintes très spécifiques, allongées, pour que le son passe mieux… Et même, on va dire : « On va condamner la chaire. » Vous voyez, cette chaire, normalement on ne l’utilise plus depuis quelques décennies. De telle sorte que l’église devient un problème : il vaudrait mieux une salle de concert, ou une salle de cours. Parce qu’elle résonne trop, tout d’un coup. Pourquoi est-ce que je commence par cela ? D’abord parce que je dois tout le temps parler sur le même thème mais je ne supporte pas de dire la même chose, donc j’ai pris un autre point de départ. J’ai changé les conditions de la conférence pour vous parler autrement que je ne l’ai fait dans les autres conférences. J’ai prévu pour la dernière conférence que je dois faire à 21h30 de boire plusieurs bières, comme ça je serai dans un état différent. Mais ce que je veux vous dire c'est que nous touchons à un problème très contemporain, qui est le fait que la technologie se présente comme une aide, comme un petit plus, alors qu’en fait elle transforme notre condition. Vous voyez, comme j’ai dit : l’introduction du micro transforme l’espace liturgique, transforme le style de célébration. On va vous dire qu’il y a de petites choses qu’on va vous apporter qui vont vous aider par la technologie, mais qui en fait vont transformer vos modes de vie. Quand on a inventé la voiture, on a dit, la voiture est un moyen qui vous permet d’aller plus rapidement d’un point à un autre. C’est magnifique. C’est hyper efficace. Et en réalité, ce qui s’est passé, c’est qu’on a transformé les villes, on a transformé les paysages, pour les adapter à la circulation des voitures. Et qu’on a transformé nos modes de vie, puisqu’on s’est mis à travailler plus loin, de telle sorte qu’on passe toujours autant de temps dans les transports, voire même plus aujourd’hui, qu’autrefois.
Mais ce que je veux vous dire c'est que nous touchons à un problème très contemporain, qui est le fait que la technologie se présente comme une aide, comme un petit plus, alors qu’en fait elle transforme notre condition. Vous voyez, comme j’ai dit : l’introduction du micro transforme l’espace liturgique, transforme le style de célébration. On va vous dire qu’il y a de petites choses qu’on va vous apporter qui vont vous aider par la technologie, mais qui en fait vont transformer vos modes de vie. Quand on a inventé la voiture, on a dit, la voiture est un moyen qui vous permet d’aller plus rapidement d’un point à un autre. C’est magnifique. C’est hyper efficace. Et en réalité, ce qui s’est passé, c’est qu’on a transformé les villes, on a transformé les paysages, pour les adapter à la circulation des voitures. Et qu’on a transformé nos modes de vie, puisqu’on s’est mis à travailler plus loin, de telle sorte qu’on passe toujours autant de temps dans les transports, voire même plus aujourd’hui, qu’autrefois. Alors le sujet qu’on m’a proposé de traiter, c’est : devenir homme, devenir père. Vous allez me dire : Quel est le rapport ? Mais justement, devenir homme, devenir père, à l’âge de la technologie, c’est là qu’est le problème. Les conditions de notre vie ont été modifiées par notre environnement technologique. Je vois plusieurs Iphones branchés. Vous n’êtes pas forcément en train de jouer à PokemonGo dans cette église… Ne serait-ce que ça, vous voyez j’ai quand même un micro devant moi, qui ne me sert pas mais qui sert à un enregistrement, d’autres personnes sont en train d’enregistrer… C’est vachement bien, en fait, la chaire, parce que vous êtes surveillé, quoi ! C’est beaucoup mieux, maintenant je comprends ! C’était très intelligent. Ce n’est pas que des questions acoustiques, c’était une question optique aussi. On pouvait voir tout le monde, et de haut. Déjà, par exemple, cet enregistreur fait que je ne m’adresse pas, ou plus, qu’à vous. Si je n’étais seulement qu’avec vous, je n’adresserais des choses qu’à vous et maintenant que je sais que c’est enregistré, il y a des choses que je ne pourrai pas dire. Et de fait, car il y a des choses qui ne peuvent pas sortir de cette enceinte. Si par exemple je critique l’islam, en disant, comme le disait Michel Houellebecq, que « c’est la religion la plus con », je m’expose à une fatwa si c’est communiqué, vous voyez, quelqu’un qui enlève l’enregistreur. Si je commence à dire quelque chose pour vous à cet instant… Parce que je m’adresse à vous comme routiers. Si c’est enregistré, c’est d’autres qui vont entendre et ça ne va pas forcément les concerner, ils ne sont pas forcément de la route. Donc, vous comprenez, déjà, cet instrument modifie mon comportement. Et aujourd’hui, les conditions de l’existence technologiques modifient nos comportements. Et modifient, en fait, le rapport à la vie humaine et à la famille. Vous savez que le pape François a écrit une encyclique, LaudatoSi, sur l’écologie intégrale, mais surtout, une encyclique qui parle de quelque chose de très particulier. Il dit que notre monde est infecté par ce qu’il appelle un paradigme technologique, ou un paradigme techno-économique. Ce paradigme n’est pas simplement le fait qu’il y a des objets technologiques mais que désormais nous vivons sous l’influence de ces objets. Alors même que nous n’utiliserions pas ces objets, le mode de fonctionnement de ces objets devient notre manière d’être. Quand, autrefois, on était dans une époque de culture, c’est-à-dire où le rapport de base au monde était l’agriculture, nos représentations étaient profondément liées à l’agriculture. De telle sorte qu’on savait que pour que quelque chose soit efficace il fallait respecter un végétal, son mode de croissance ; il fallait respecter les saisons ; on savait qu’il y avait une incertitude, ça prenait du temps ; on ne pouvait pas faire pousser de l’herbe en tirant dessus. Maintenant, nous sommes dans une société où le modèle est celui de l’informatique et où notre rapport au monde est lié à ce que j’appelle une ‘push-button-attitude’. Nous appuyons sur des boutons, nous avons un effet immédiat. De telle sorte que notre rapport au monde va changer. Si vous êtes dans un monde agricole et que je vous parle d’obéissance, comment est-ce que vous allez penser l’obéissance ? L’obéissance dans cet imaginaire agricole est quelque chose qui prend du temps. C’est la pousse d’un végétal. Alors que si vous êtes dans le modèle techno-économique, l’obéissance ça doit être immédiat. Et vous allez penser à l’obéissance sous cette forme-là. Obéir c’est : j’appuie sur un bouton, j’ai un résultat. Regardez quand le Christ parle de l’obéissance dans la parabole du semeur, ce qui pousse trop vite n’est pas bon. La vitesse n’est pas un gage de fidélité, de persévérance. Et donc, de véritable obéissance. En revanche, ce qui va pousser lentement, disons à la bonne vitesse, plus lentement qu’un escargot, là il y aurait la véritable obéissance.
Alors le sujet qu’on m’a proposé de traiter, c’est : devenir homme, devenir père. Vous allez me dire : Quel est le rapport ? Mais justement, devenir homme, devenir père, à l’âge de la technologie, c’est là qu’est le problème. Les conditions de notre vie ont été modifiées par notre environnement technologique. Je vois plusieurs Iphones branchés. Vous n’êtes pas forcément en train de jouer à PokemonGo dans cette église… Ne serait-ce que ça, vous voyez j’ai quand même un micro devant moi, qui ne me sert pas mais qui sert à un enregistrement, d’autres personnes sont en train d’enregistrer… C’est vachement bien, en fait, la chaire, parce que vous êtes surveillé, quoi ! C’est beaucoup mieux, maintenant je comprends ! C’était très intelligent. Ce n’est pas que des questions acoustiques, c’était une question optique aussi. On pouvait voir tout le monde, et de haut. Déjà, par exemple, cet enregistreur fait que je ne m’adresse pas, ou plus, qu’à vous. Si je n’étais seulement qu’avec vous, je n’adresserais des choses qu’à vous et maintenant que je sais que c’est enregistré, il y a des choses que je ne pourrai pas dire. Et de fait, car il y a des choses qui ne peuvent pas sortir de cette enceinte. Si par exemple je critique l’islam, en disant, comme le disait Michel Houellebecq, que « c’est la religion la plus con », je m’expose à une fatwa si c’est communiqué, vous voyez, quelqu’un qui enlève l’enregistreur. Si je commence à dire quelque chose pour vous à cet instant… Parce que je m’adresse à vous comme routiers. Si c’est enregistré, c’est d’autres qui vont entendre et ça ne va pas forcément les concerner, ils ne sont pas forcément de la route. Donc, vous comprenez, déjà, cet instrument modifie mon comportement. Et aujourd’hui, les conditions de l’existence technologiques modifient nos comportements. Et modifient, en fait, le rapport à la vie humaine et à la famille. Vous savez que le pape François a écrit une encyclique, LaudatoSi, sur l’écologie intégrale, mais surtout, une encyclique qui parle de quelque chose de très particulier. Il dit que notre monde est infecté par ce qu’il appelle un paradigme technologique, ou un paradigme techno-économique. Ce paradigme n’est pas simplement le fait qu’il y a des objets technologiques mais que désormais nous vivons sous l’influence de ces objets. Alors même que nous n’utiliserions pas ces objets, le mode de fonctionnement de ces objets devient notre manière d’être. Quand, autrefois, on était dans une époque de culture, c’est-à-dire où le rapport de base au monde était l’agriculture, nos représentations étaient profondément liées à l’agriculture. De telle sorte qu’on savait que pour que quelque chose soit efficace il fallait respecter un végétal, son mode de croissance ; il fallait respecter les saisons ; on savait qu’il y avait une incertitude, ça prenait du temps ; on ne pouvait pas faire pousser de l’herbe en tirant dessus. Maintenant, nous sommes dans une société où le modèle est celui de l’informatique et où notre rapport au monde est lié à ce que j’appelle une ‘push-button-attitude’. Nous appuyons sur des boutons, nous avons un effet immédiat. De telle sorte que notre rapport au monde va changer. Si vous êtes dans un monde agricole et que je vous parle d’obéissance, comment est-ce que vous allez penser l’obéissance ? L’obéissance dans cet imaginaire agricole est quelque chose qui prend du temps. C’est la pousse d’un végétal. Alors que si vous êtes dans le modèle techno-économique, l’obéissance ça doit être immédiat. Et vous allez penser à l’obéissance sous cette forme-là. Obéir c’est : j’appuie sur un bouton, j’ai un résultat. Regardez quand le Christ parle de l’obéissance dans la parabole du semeur, ce qui pousse trop vite n’est pas bon. La vitesse n’est pas un gage de fidélité, de persévérance. Et donc, de véritable obéissance. En revanche, ce qui va pousser lentement, disons à la bonne vitesse, plus lentement qu’un escargot, là il y aurait la véritable obéissance. Les rythmes de nos vies ont changé, notre rapport au monde a changé : nous voulons une efficacité immédiate. Nous avons perdu le sens du temps long. Et, avec cette modification qui vient de la technologie, ce qui est changé, c’est notre humanité-même, qui de plus en plus veut passer par ce rapport immédiat au monde. Avec le désir où j’ai des résultats immédiats, mais ça veut dire aussi : je trouve rapidement le bien-être, je vais trouver… je ne sais pas moi, des implants cérébraux qui vont me permettre de vivre dans une sorte d’orgasme permanent. Imaginez… C’est un projet déjà en place, hein ! Il y a donc quelque chose qui s’est modifié de notre humanité. Et notre technologie va en plus modifier notre rapport au don de la vie. Parce que pourquoi dans ces conditions-là même continuer à être père ? D’une part, on va se représenter notre vie, dans cette impatience-là, comme une vie qui n’a pas forcément à enfanter, parce qu’enfanter c’est entrer dans le temps de la maturation, dans un temps long. Mais en plus, si on met au monde des enfants, mieux vaut les mettre au monde par le biais de la technologie.
Les rythmes de nos vies ont changé, notre rapport au monde a changé : nous voulons une efficacité immédiate. Nous avons perdu le sens du temps long. Et, avec cette modification qui vient de la technologie, ce qui est changé, c’est notre humanité-même, qui de plus en plus veut passer par ce rapport immédiat au monde. Avec le désir où j’ai des résultats immédiats, mais ça veut dire aussi : je trouve rapidement le bien-être, je vais trouver… je ne sais pas moi, des implants cérébraux qui vont me permettre de vivre dans une sorte d’orgasme permanent. Imaginez… C’est un projet déjà en place, hein ! Il y a donc quelque chose qui s’est modifié de notre humanité. Et notre technologie va en plus modifier notre rapport au don de la vie. Parce que pourquoi dans ces conditions-là même continuer à être père ? D’une part, on va se représenter notre vie, dans cette impatience-là, comme une vie qui n’a pas forcément à enfanter, parce qu’enfanter c’est entrer dans le temps de la maturation, dans un temps long. Mais en plus, si on met au monde des enfants, mieux vaut les mettre au monde par le biais de la technologie. Des technologies se sont présentées comme thérapeutiques. On présente des avancées comme des choses thérapeutiques mais qui en fait ont changé radicalement notre rapport à l’enfantement. Ça a été le grand drame de quelqu’un que vous connaissez peut-être, le professeur Lejeune dont la cause est en béatification. Le professeur Lejeune a inventé le diagnostic prénatal. C’est une chose incroyable, le diagnostic prénatal. C’est savoir le code génétique d’un enfant avant même de le voir. Avant même qu’il soit né. Imaginez qu’on ait inventé ça avant la Nativité, ce qu’on aurait célébré, c’est le diagnostic prénatal du Christ, parce que c’était son entrée dans une sorte de visibilité humaine, génétique, on aurait eu un code. S’il y avait eu l’échographie, on aurait célébré la première échographie du Christ. La fête de la Nativité c’est l’entrée de Jésus dans la visibilité. Mais à partir du moment où vous avez cette technologie-là, vous avez un truc qui fait qu’on anticipe sur la naissance. La naissance n’est plus l’événement qu’on croyait. Le professeur Lejeune a inventé ce diagnostic, bien sûr, pour pouvoir soigner les personnes trisomiques. Pour qu’on puisse notamment… C’est lui qui avait découvert que ce qu’on appelait le mongolisme autrefois, relevait d’un chromosome, le chromosome 21. Et c’est lui qui a découvert que ça n’était pas une régression de la race blanche vers la race jaune, comme certains le pensaient, notamment Down ; ça n’était pas non plus dû à des mauvais comportements des parents. C’était quelque chose qui pouvait advenir, génétiquement, aléatoirement. Et il invente donc ce test.
Des technologies se sont présentées comme thérapeutiques. On présente des avancées comme des choses thérapeutiques mais qui en fait ont changé radicalement notre rapport à l’enfantement. Ça a été le grand drame de quelqu’un que vous connaissez peut-être, le professeur Lejeune dont la cause est en béatification. Le professeur Lejeune a inventé le diagnostic prénatal. C’est une chose incroyable, le diagnostic prénatal. C’est savoir le code génétique d’un enfant avant même de le voir. Avant même qu’il soit né. Imaginez qu’on ait inventé ça avant la Nativité, ce qu’on aurait célébré, c’est le diagnostic prénatal du Christ, parce que c’était son entrée dans une sorte de visibilité humaine, génétique, on aurait eu un code. S’il y avait eu l’échographie, on aurait célébré la première échographie du Christ. La fête de la Nativité c’est l’entrée de Jésus dans la visibilité. Mais à partir du moment où vous avez cette technologie-là, vous avez un truc qui fait qu’on anticipe sur la naissance. La naissance n’est plus l’événement qu’on croyait. Le professeur Lejeune a inventé ce diagnostic, bien sûr, pour pouvoir soigner les personnes trisomiques. Pour qu’on puisse notamment… C’est lui qui avait découvert que ce qu’on appelait le mongolisme autrefois, relevait d’un chromosome, le chromosome 21. Et c’est lui qui a découvert que ça n’était pas une régression de la race blanche vers la race jaune, comme certains le pensaient, notamment Down ; ça n’était pas non plus dû à des mauvais comportements des parents. C’était quelque chose qui pouvait advenir, génétiquement, aléatoirement. Et il invente donc ce test. Aujourd’hui, ce test est employé pour éliminer les populations trisomiques. C’est-à-dire qu’il a inventé quelque chose en disant : « On va bien s’en servir. C’est une technologie, il suffit d’en faire bon usage. » Mais en réalité la technologie va induire un type de comportement où on pratique, en France vous le savez bien, déjà, ce qu’on appelle un eugénisme. Non pas positif, mais négatif, c’est-à-dire où on élimine tout ce qui ne nous paraît pas être conforme à une bonne vie humaine. Mais il va falloir aller plus loin. Á partir du moment où vous avez la possibilité par exemple de modifier génétiquement votre enfant pour être sûr qu’il n’aura pas tel ou tel cancer, ou qu’il l’aura très tard. Modifier génétiquement votre enfant pour être sûr qu’il aura les capacités cognitives très développées, de telle sorte qu’il pourra entrer à l’Ecole Normale Supérieure, à Polytechnique ou à HEC. Á partir du moment où vous êtes sûr même qu’on pourra lui assurer une longévité plus grande. Voire même lui assurer l’immortalité. Qu’est-ce que vous allez faire ? Vous allez dire que vous voulez le bien de votre enfant, vous allez dire : « Fabriquez-le. Je ne veux pas être père, je veux me tourner vers des ingénieurs, des experts qui eux vont fabriquer une vie meilleure. »
Aujourd’hui, ce test est employé pour éliminer les populations trisomiques. C’est-à-dire qu’il a inventé quelque chose en disant : « On va bien s’en servir. C’est une technologie, il suffit d’en faire bon usage. » Mais en réalité la technologie va induire un type de comportement où on pratique, en France vous le savez bien, déjà, ce qu’on appelle un eugénisme. Non pas positif, mais négatif, c’est-à-dire où on élimine tout ce qui ne nous paraît pas être conforme à une bonne vie humaine. Mais il va falloir aller plus loin. Á partir du moment où vous avez la possibilité par exemple de modifier génétiquement votre enfant pour être sûr qu’il n’aura pas tel ou tel cancer, ou qu’il l’aura très tard. Modifier génétiquement votre enfant pour être sûr qu’il aura les capacités cognitives très développées, de telle sorte qu’il pourra entrer à l’Ecole Normale Supérieure, à Polytechnique ou à HEC. Á partir du moment où vous êtes sûr même qu’on pourra lui assurer une longévité plus grande. Voire même lui assurer l’immortalité. Qu’est-ce que vous allez faire ? Vous allez dire que vous voulez le bien de votre enfant, vous allez dire : « Fabriquez-le. Je ne veux pas être père, je veux me tourner vers des ingénieurs, des experts qui eux vont fabriquer une vie meilleure. » Nous sommes dans cette situation-là. Une situation où l’homme disparaît au profit d’une sorte de cyborg performant et où le père doit laisser la place à l’expert. C’est la situation généralisée de notre société. De telle sorte que se posent pour nous des questions absolument neuves. Á partir du moment où on peut modifier l’être humain, la question se pose de savoir pourquoi rester humain. Non seulement devenir humain, mais à la limite pourquoi le rester ? Et puis, une autre question fondamentale : pourquoi donner la vie ? Non seulement pourquoi la donner, pourquoi continuer avec l’humanité dont on sait qu’elle est finie, limitée, etc., mais même aussi pourquoi la donner par cette voie qui est celle ancestrale de la transmission de père en fils par la voie sexuelle ? Est-ce qu’il ne faudrait pas déléguer cela à des gens qui feront des enfants absolument compétents, adaptés, résistants aux conditions nouvelles du monde techno-industriel ? Vous savez que dès lors si vous dites : « Non il faut continuer à être humains, et donc renoncer à certains phénomènes technologiques ; il faut continuer à avoir des enfants sur le mode sexuel, c’est-à-dire aléatoire, avec des risques ; il faut continuer à être des pères et des mères plutôt que des experts en pédagogie… » … On va dire que vous êtes cruels. On va dire que vous êtes réactionnaires. Et c’est ce qui se passe aujourd’hui.
Nous sommes dans cette situation-là. Une situation où l’homme disparaît au profit d’une sorte de cyborg performant et où le père doit laisser la place à l’expert. C’est la situation généralisée de notre société. De telle sorte que se posent pour nous des questions absolument neuves. Á partir du moment où on peut modifier l’être humain, la question se pose de savoir pourquoi rester humain. Non seulement devenir humain, mais à la limite pourquoi le rester ? Et puis, une autre question fondamentale : pourquoi donner la vie ? Non seulement pourquoi la donner, pourquoi continuer avec l’humanité dont on sait qu’elle est finie, limitée, etc., mais même aussi pourquoi la donner par cette voie qui est celle ancestrale de la transmission de père en fils par la voie sexuelle ? Est-ce qu’il ne faudrait pas déléguer cela à des gens qui feront des enfants absolument compétents, adaptés, résistants aux conditions nouvelles du monde techno-industriel ? Vous savez que dès lors si vous dites : « Non il faut continuer à être humains, et donc renoncer à certains phénomènes technologiques ; il faut continuer à avoir des enfants sur le mode sexuel, c’est-à-dire aléatoire, avec des risques ; il faut continuer à être des pères et des mères plutôt que des experts en pédagogie… » … On va dire que vous êtes cruels. On va dire que vous êtes réactionnaires. Et c’est ce qui se passe aujourd’hui. Le grand paradoxe de notre époque est que les chrétiens qui sont normalement les témoins de la charité, de la compassion, apparaissent comme des personnes cruelles. Elles sont contre l’euthanasie. C’est la compassion, l’euthanasie ! Elles sont contre le fait qu’on puisse, par exemple, modifier le génome pour faire des êtres immortels. Imaginez, vous avez un gamin, il est né, vous l’avez eu comme ça. Il a ses copains à l’école qui ont été modifiés génétiquement, et puis vous allez lui dire : « Nous on est chrétiens, mon chéri tu dois crever ! ». C’est normal. On en est là. Alors, qu’est-ce qui nous pousse, nous, à vouloir rester humains et à vouloir continuer d’essayer de le devenir ? D’abord, vous faites cette expérience dans le scoutisme de ce qu’est une vie simplement humaine. D’abord, et surtout les routiers, vous marchez. C’est un truc incroyable de marcher aujourd’hui ! Vous marchez. Je ne parle pas des machines qui marchent, parce qu’elles marchent aussi. Nous, nous ne marchons plus. Je ne parle pas non plus de faire dix milles pas par jour selon les recommandations de l’OMS. Ça c’est encore la logique du calcul, ce n’est pas la marche. Vous, vous vivez la marche comme une expérience humaine de proximité, de parole, de rencontre. Mais ça n’existe quasiment plus ! Aujourd’hui, il faut croire en Dieu pour marcher ! Regardez, si ce n’est pas pour le fitness. On est dans une société où les gens ne marchent quasiment plus. Ils prennent la voiture, ils ont des trucs… Pour mener une vie simplement humaine, il va falloir croire en Dieu, pour continuer à avoir des enfants selon la loi naturelle, avec un père et une mère. Et même, il va falloir croire en Dieu, pour dire moi je ne veux pas être de l’humanité 2.0 augmentée par la technologie. Et même pas n’importe quel Dieu : il faudra croire au Dieu qui s’est fait homme. Et qui nous garantit qu’être humain, que c’est en étant humain que l’on devient vraiment divin. Non pas en sortant de l’humanité.
Le grand paradoxe de notre époque est que les chrétiens qui sont normalement les témoins de la charité, de la compassion, apparaissent comme des personnes cruelles. Elles sont contre l’euthanasie. C’est la compassion, l’euthanasie ! Elles sont contre le fait qu’on puisse, par exemple, modifier le génome pour faire des êtres immortels. Imaginez, vous avez un gamin, il est né, vous l’avez eu comme ça. Il a ses copains à l’école qui ont été modifiés génétiquement, et puis vous allez lui dire : « Nous on est chrétiens, mon chéri tu dois crever ! ». C’est normal. On en est là. Alors, qu’est-ce qui nous pousse, nous, à vouloir rester humains et à vouloir continuer d’essayer de le devenir ? D’abord, vous faites cette expérience dans le scoutisme de ce qu’est une vie simplement humaine. D’abord, et surtout les routiers, vous marchez. C’est un truc incroyable de marcher aujourd’hui ! Vous marchez. Je ne parle pas des machines qui marchent, parce qu’elles marchent aussi. Nous, nous ne marchons plus. Je ne parle pas non plus de faire dix milles pas par jour selon les recommandations de l’OMS. Ça c’est encore la logique du calcul, ce n’est pas la marche. Vous, vous vivez la marche comme une expérience humaine de proximité, de parole, de rencontre. Mais ça n’existe quasiment plus ! Aujourd’hui, il faut croire en Dieu pour marcher ! Regardez, si ce n’est pas pour le fitness. On est dans une société où les gens ne marchent quasiment plus. Ils prennent la voiture, ils ont des trucs… Pour mener une vie simplement humaine, il va falloir croire en Dieu, pour continuer à avoir des enfants selon la loi naturelle, avec un père et une mère. Et même, il va falloir croire en Dieu, pour dire moi je ne veux pas être de l’humanité 2.0 augmentée par la technologie. Et même pas n’importe quel Dieu : il faudra croire au Dieu qui s’est fait homme. Et qui nous garantit qu’être humain, que c’est en étant humain que l’on devient vraiment divin. Non pas en sortant de l’humanité. Le Christ a mené une vie d’homme. Il a mené une vie de charpentier. Trente ans à Nazareth, de charpente, et après, trois années de marche et de prédication. Quand vous marchez, vous renouez aussi avec la vie apostolique. Les apôtres qui marchaient, qui faisaient des kilomètres et qui parlaient aux gens qu’ils rencontraient. Qui leur parlaient du Royaume. Tout proche. « Le Royaume est proche de vous. » Le Royaume en fait se joue dans cette proximité humaine. Voilà ce qu’était la vie du Christ. Or, on sait que c’est la vie de l’homme parfait. 0n sait qu’on ne peut pas aller plus loin que cette vie-là. On sait même que mourir à trente-trois ans, ça peut être la chose la plus extraordinaire, la plus merveilleuse qui se fait dans l’Histoire. C’est quand même difficile à accepter, hein ! Mais on le sait. La grâce divine nous fait accepter notre condition humaine sur elle : mortelle. La grâce divine nous fait plus entrer dans cette condition-là et nous rappelle que le travail manuel, le travail du charpentier, peut être un travail divin. Parce que c’est ce rapport avec la nature, avec le monde tel qu’il est donné par Dieu. Ce rapport de culture et pas ce simple rapport d’ingénierie.
Le Christ a mené une vie d’homme. Il a mené une vie de charpentier. Trente ans à Nazareth, de charpente, et après, trois années de marche et de prédication. Quand vous marchez, vous renouez aussi avec la vie apostolique. Les apôtres qui marchaient, qui faisaient des kilomètres et qui parlaient aux gens qu’ils rencontraient. Qui leur parlaient du Royaume. Tout proche. « Le Royaume est proche de vous. » Le Royaume en fait se joue dans cette proximité humaine. Voilà ce qu’était la vie du Christ. Or, on sait que c’est la vie de l’homme parfait. 0n sait qu’on ne peut pas aller plus loin que cette vie-là. On sait même que mourir à trente-trois ans, ça peut être la chose la plus extraordinaire, la plus merveilleuse qui se fait dans l’Histoire. C’est quand même difficile à accepter, hein ! Mais on le sait. La grâce divine nous fait accepter notre condition humaine sur elle : mortelle. La grâce divine nous fait plus entrer dans cette condition-là et nous rappelle que le travail manuel, le travail du charpentier, peut être un travail divin. Parce que c’est ce rapport avec la nature, avec le monde tel qu’il est donné par Dieu. Ce rapport de culture et pas ce simple rapport d’ingénierie.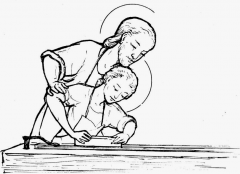 Vous comprenez maintenant ce qui se joue aujourd’hui. Mon but n’est pas de condamner toute forme de technique, puisqu’au contraire je fais l’éloge de la technique comme savoir-faire, de la technique qui était encore une culture, qui accompagnait la nature, qui était encore humaine. Je critique certains types de technologie qui, d’une certaine façon, vont contre la technique. Parce que ce qui est en train de se passer, c’est que le progrès technologique est une régression de la technique. Le projet technologique entraîne une disparition des savoir-faire humains. Humain, ça veut dire avec les mains. Ça veut dire l’artisanat, ça veut dire les arts, ça veut dire… toutes ces choses-là. La réalité de notre existence aujourd’hui, qui nous fait rêver d’être des cyborgs. Nous rêvons d’être des cyborgs parce que nous avons créé une société qui nous empêche de déployer nos vraies potentialités humaines. En fait, c’est quand vous n’avez pas commencé à être humain que vous rêvé d’être un surhomme. Mais quand vous voyez ce que c’est qu’être humain et tout ce qu’on peut déployer en étant humain, à ce moment-là vous n’avez pas du tout envie de devenir un cyborg. Si vous savez jouer d’un instrument de musique, si vous savez vous servir d’une feuille et d’un stylo, pourquoi auriez-vous besoin de la dernière version de GTA ? Dante a écrit La Divine Comédie avec du papier et un stylo, hein ! Léonard de Vinci ou Mozart de quoi ont-ils eu besoin ? Ils ont déployé des choses dont on peut dire qu’elles sont divines, dans leur beauté. Mais ils n’ont pas besoin d’avoir une super technologie. Simplement c’était leurs mains, et leurs mains animées par leur esprit et par leur cœur avec une contemplation du réel. Qui était une contemplation amoureuse, attentive, que nous avons perdue.
Vous comprenez maintenant ce qui se joue aujourd’hui. Mon but n’est pas de condamner toute forme de technique, puisqu’au contraire je fais l’éloge de la technique comme savoir-faire, de la technique qui était encore une culture, qui accompagnait la nature, qui était encore humaine. Je critique certains types de technologie qui, d’une certaine façon, vont contre la technique. Parce que ce qui est en train de se passer, c’est que le progrès technologique est une régression de la technique. Le projet technologique entraîne une disparition des savoir-faire humains. Humain, ça veut dire avec les mains. Ça veut dire l’artisanat, ça veut dire les arts, ça veut dire… toutes ces choses-là. La réalité de notre existence aujourd’hui, qui nous fait rêver d’être des cyborgs. Nous rêvons d’être des cyborgs parce que nous avons créé une société qui nous empêche de déployer nos vraies potentialités humaines. En fait, c’est quand vous n’avez pas commencé à être humain que vous rêvé d’être un surhomme. Mais quand vous voyez ce que c’est qu’être humain et tout ce qu’on peut déployer en étant humain, à ce moment-là vous n’avez pas du tout envie de devenir un cyborg. Si vous savez jouer d’un instrument de musique, si vous savez vous servir d’une feuille et d’un stylo, pourquoi auriez-vous besoin de la dernière version de GTA ? Dante a écrit La Divine Comédie avec du papier et un stylo, hein ! Léonard de Vinci ou Mozart de quoi ont-ils eu besoin ? Ils ont déployé des choses dont on peut dire qu’elles sont divines, dans leur beauté. Mais ils n’ont pas besoin d’avoir une super technologie. Simplement c’était leurs mains, et leurs mains animées par leur esprit et par leur cœur avec une contemplation du réel. Qui était une contemplation amoureuse, attentive, que nous avons perdue. Donc, régression liée au développement technologique, régression technique et même régression morale. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, plus se développe la technologie, plus les objets se raffinent, plus nous devenons primaires. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce truc-là ? Et… en fait je découvre qu’il y a une sorte de chaise, en plus ils s’asseyaient, ils faisaient semblant d’être debout. Mes chers frères… Vous voyez, c’est ça, c’est toute cette science-là qu’on a perdue… ! Je ne sais pas si vous avez remarqué… les appareils technologiques qui nous poussent à vivre dans un monde où on appuie sur un bouton et où on a des effets extraordinaires cultivent en nous l’impatience. Cette mécanique de la ‘push-button-attitude’ où on veut des résultats immédiats fait qu’on est devenus de plus en plus impatients. Regardez ! : Dès que votre ordinateur rame un peu… Vous avez des types, pourtant qui avaient l’air à peu près intelligents, ils se mettent à parler à leur machine et à l’insulter. Et même ces gens qui disent « eh, moi, je ne prie pas Dieu et tout ça… » sont devant l’ordinateur et disent : « Allez, s’te plaît, marche, s’te plaît… » Ils font des prières. Á leur écran. Parce qu’ils n’en peuvent plus. Parce qu’en réalité, cette technologie qui ne nous donne pas la patience du travail des mains, la patience d’un apprentissage, d’un savoir-faire, la patience de la culture, de l’agriculture, de l’élevage… parce qu’on n’a plus cette patience-là, nous entrons dans un domaine qui est de plus en plus pulsionnel. Et d’ailleurs, pulsionnel, c’est la pulsion, c’est appuyer sur des boutons. Ça veut dire ça. Donc, nous avons largement régressé, nous avons grandi en impatience.
Donc, régression liée au développement technologique, régression technique et même régression morale. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, plus se développe la technologie, plus les objets se raffinent, plus nous devenons primaires. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce truc-là ? Et… en fait je découvre qu’il y a une sorte de chaise, en plus ils s’asseyaient, ils faisaient semblant d’être debout. Mes chers frères… Vous voyez, c’est ça, c’est toute cette science-là qu’on a perdue… ! Je ne sais pas si vous avez remarqué… les appareils technologiques qui nous poussent à vivre dans un monde où on appuie sur un bouton et où on a des effets extraordinaires cultivent en nous l’impatience. Cette mécanique de la ‘push-button-attitude’ où on veut des résultats immédiats fait qu’on est devenus de plus en plus impatients. Regardez ! : Dès que votre ordinateur rame un peu… Vous avez des types, pourtant qui avaient l’air à peu près intelligents, ils se mettent à parler à leur machine et à l’insulter. Et même ces gens qui disent « eh, moi, je ne prie pas Dieu et tout ça… » sont devant l’ordinateur et disent : « Allez, s’te plaît, marche, s’te plaît… » Ils font des prières. Á leur écran. Parce qu’ils n’en peuvent plus. Parce qu’en réalité, cette technologie qui ne nous donne pas la patience du travail des mains, la patience d’un apprentissage, d’un savoir-faire, la patience de la culture, de l’agriculture, de l’élevage… parce qu’on n’a plus cette patience-là, nous entrons dans un domaine qui est de plus en plus pulsionnel. Et d’ailleurs, pulsionnel, c’est la pulsion, c’est appuyer sur des boutons. Ça veut dire ça. Donc, nous avons largement régressé, nous avons grandi en impatience.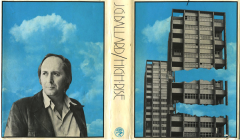 Vous avez un auteur très intéressant, un auteur anglais qui s’appelle G.J. Ballard, auteur notamment d’un roman assez célèbre qui s’intitule Crash. David Cronenberg a fait un film à partir de ce roman, un film assez trash, d’ailleurs… Il a fait aussi d’autres romans comme Immeuble de grande hauteur, etc. Je crois qu’il y a un film avec Jeremy Irons qui est sorti là-dessus… où il montre que c’est une sorte d’immeuble immense où il y a mille appartements, où tout est organisé, il y a des jacuzzis, des piscines à certains étages, des supermarchés à l’intérieur. Mais voilà que des ascenseurs se détraquent. Et à partir de ce détraquage de l’ascenseur les gens sont dans une sorte d’impatience, d’hystérie, et on voit que petit à petit, à cause du détraquement des machines, comme les gens n’ont pas appris à se maîtriser devant le réel, mais à croire qu’ils dominaient le réel parce qu’ils étaient face à du virtuel, en fait, dans cette domination qu’ils avaient dans le monde virtuel, quand ils sont confrontés à du réel, à une panne.. ils perdent les pédales. Et alors tous les gens bourgeois qui vivaient dans cet immeuble, des ingénieurs, des cinéastes… commencent à devenir fous, et la vie de l’immeuble se change en une vie de plus en plus primitive. Ils vont faire des razzias sur les étages inférieurs, des clans vont se créer entre ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas… Parce que justement la technologie a développé leur côté pulsionnel.
Vous avez un auteur très intéressant, un auteur anglais qui s’appelle G.J. Ballard, auteur notamment d’un roman assez célèbre qui s’intitule Crash. David Cronenberg a fait un film à partir de ce roman, un film assez trash, d’ailleurs… Il a fait aussi d’autres romans comme Immeuble de grande hauteur, etc. Je crois qu’il y a un film avec Jeremy Irons qui est sorti là-dessus… où il montre que c’est une sorte d’immeuble immense où il y a mille appartements, où tout est organisé, il y a des jacuzzis, des piscines à certains étages, des supermarchés à l’intérieur. Mais voilà que des ascenseurs se détraquent. Et à partir de ce détraquage de l’ascenseur les gens sont dans une sorte d’impatience, d’hystérie, et on voit que petit à petit, à cause du détraquement des machines, comme les gens n’ont pas appris à se maîtriser devant le réel, mais à croire qu’ils dominaient le réel parce qu’ils étaient face à du virtuel, en fait, dans cette domination qu’ils avaient dans le monde virtuel, quand ils sont confrontés à du réel, à une panne.. ils perdent les pédales. Et alors tous les gens bourgeois qui vivaient dans cet immeuble, des ingénieurs, des cinéastes… commencent à devenir fous, et la vie de l’immeuble se change en une vie de plus en plus primitive. Ils vont faire des razzias sur les étages inférieurs, des clans vont se créer entre ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas… Parce que justement la technologie a développé leur côté pulsionnel. L’enjeu à être humain c’est donc de retrouver cette vie simple. Qui est aussi la vraie vie spirituelle. Regardez la vie monastique : c’est une vie déconnectée. C’est une vie souvent liée à la terre, liée au travail manuel : ora et labora dit la devise bénédictine. On se rend donc compte que si Jésus était charpentier ce n’était pas un hasard. C’est qu’il y a un lien entre cette vie simple, entre le travail de nos mains et l’élévation de notre esprit. C’est souvent cela qu’on a perdu. Et vous, en réapprenant le travail des mains, par des installations, au scoutisme, peut-être qu’un jour, aussi, le scoutisme s’intéressera au travail de la terre… en marchant, en vivant cette vie de proximité, vous êtes des défenseurs de l’humanité. Et vous êtes les êtres les plus spirituels à une époque où tout se dissipe dans le virtuel. Ce que vous faites là est d’une importance majeure pour devenir humain.
L’enjeu à être humain c’est donc de retrouver cette vie simple. Qui est aussi la vraie vie spirituelle. Regardez la vie monastique : c’est une vie déconnectée. C’est une vie souvent liée à la terre, liée au travail manuel : ora et labora dit la devise bénédictine. On se rend donc compte que si Jésus était charpentier ce n’était pas un hasard. C’est qu’il y a un lien entre cette vie simple, entre le travail de nos mains et l’élévation de notre esprit. C’est souvent cela qu’on a perdu. Et vous, en réapprenant le travail des mains, par des installations, au scoutisme, peut-être qu’un jour, aussi, le scoutisme s’intéressera au travail de la terre… en marchant, en vivant cette vie de proximité, vous êtes des défenseurs de l’humanité. Et vous êtes les êtres les plus spirituels à une époque où tout se dissipe dans le virtuel. Ce que vous faites là est d’une importance majeure pour devenir humain. Maintenant, qu’en est-il de la paternité ? Il faut bien que j’en dise quelques mots. Qu’est-ce que ça veut dire être père ? Pourquoi est-ce que c’est l’autre dimension du déploiement de l’humanité ? Je voudrais juste d’abord vous faire une remarque : vous ne pouvez pas être pères si vous êtes seulement entre routiers. Il faut qu’intervienne cet être complètement inattendu dans ce lieu, même si on en trouve quelques spécimens intrus, ici-même, il faut qu’il y ait la rencontre avec la femme. La rencontre avec une femme va vous faire sortir de la logique de la planification technologique. L’homme croise une femme, il avait des tas de projets, tout d’un coup, non, c’est fini. Il est dépassé. Et ce n’est pas parce qu’il a des affinités simplement avec elle. Ce n’est pas comme un bon copain, une femme. Bon copain : on partage les mêmes sujets de discussion, on a les mêmes préoccupations. Non. Une femme, on l’aime d’abord parce que c’est une femme. On ne l’aime pas parce qu’elle nous ressemble, mais parce qu’elle est autre. C’est très mystérieux. Déjà, ce n’est pas être dans la logique de la réalisation de soi à travers un projet où je maîtrise tout. Et la relation érotique, la relation homme-femme est déjà une relation qui échappe au règne de la technologie. Si vous regardez dans 1984, ce grand roman contre des utopies technologiques, c’est précisément la rencontre d’une femme qui va faire que Wilson, le héros, va s’extraire tout d’un coup du monde totalitaire dans lequel il est.
Maintenant, qu’en est-il de la paternité ? Il faut bien que j’en dise quelques mots. Qu’est-ce que ça veut dire être père ? Pourquoi est-ce que c’est l’autre dimension du déploiement de l’humanité ? Je voudrais juste d’abord vous faire une remarque : vous ne pouvez pas être pères si vous êtes seulement entre routiers. Il faut qu’intervienne cet être complètement inattendu dans ce lieu, même si on en trouve quelques spécimens intrus, ici-même, il faut qu’il y ait la rencontre avec la femme. La rencontre avec une femme va vous faire sortir de la logique de la planification technologique. L’homme croise une femme, il avait des tas de projets, tout d’un coup, non, c’est fini. Il est dépassé. Et ce n’est pas parce qu’il a des affinités simplement avec elle. Ce n’est pas comme un bon copain, une femme. Bon copain : on partage les mêmes sujets de discussion, on a les mêmes préoccupations. Non. Une femme, on l’aime d’abord parce que c’est une femme. On ne l’aime pas parce qu’elle nous ressemble, mais parce qu’elle est autre. C’est très mystérieux. Déjà, ce n’est pas être dans la logique de la réalisation de soi à travers un projet où je maîtrise tout. Et la relation érotique, la relation homme-femme est déjà une relation qui échappe au règne de la technologie. Si vous regardez dans 1984, ce grand roman contre des utopies technologiques, c’est précisément la rencontre d’une femme qui va faire que Wilson, le héros, va s’extraire tout d’un coup du monde totalitaire dans lequel il est. Parce que la rencontre d’une femme, c’est une relation primitive. Ça existe depuis l’origine des temps, c’est l’aventure de base. Vous marchez ensemble, entre hommes, et je vous ai dit, c’est déjà défendre l’humanité. Mais il y a cet autre aspect de l’humanité qui est la rencontre avec l’autre sexe et qui est vraiment un événement absolu. Je vous rappelle que... Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire que racontait Alfred Hitchcock, le grand réalisateur. C’est l’histoire d’un scénariste qui, pendant la nuit, a l’idée d’un scénario absolument incroyable, auquel personne n’avait vraiment pensé. Il se dit, c’est génial, avec ça, à Hollywood, je vais avoir un succès fou, les gens vont dire c’est ce qu’on attendait… Et il se recouche et quand il se lève le lendemain matin, il a complètement oublié. Alors, il se dit, bon, si ça me revient, il faut vraiment que je m’en souvienne. Alors au milieu de la nuit il se souvient encore de ce super scénario, il dit là, maintenant, je vais m’en souvenir. Il se recouche, le lendemain matin il a encore oublié. Alors il dit, bon, là, il faut absolument que je prenne un cahier et je vais noter mon idée si elle me revient pendant la nuit ! Et dans la nuit, l’idée lui revient, il la note dans le cahier : l’argument, le scénario absolument génial et puis… il laisse le cahier. Il dit : « demain matin je pourrai relire ça à tête reposée. » Il se lève le lendemain matin, avec grande joie il ouvre son cahier, et qu’est-ce qu’il voit comme scénario extraordinaire ? Un homme tombe amoureux d’une femme. C’est tout.
Parce que la rencontre d’une femme, c’est une relation primitive. Ça existe depuis l’origine des temps, c’est l’aventure de base. Vous marchez ensemble, entre hommes, et je vous ai dit, c’est déjà défendre l’humanité. Mais il y a cet autre aspect de l’humanité qui est la rencontre avec l’autre sexe et qui est vraiment un événement absolu. Je vous rappelle que... Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire que racontait Alfred Hitchcock, le grand réalisateur. C’est l’histoire d’un scénariste qui, pendant la nuit, a l’idée d’un scénario absolument incroyable, auquel personne n’avait vraiment pensé. Il se dit, c’est génial, avec ça, à Hollywood, je vais avoir un succès fou, les gens vont dire c’est ce qu’on attendait… Et il se recouche et quand il se lève le lendemain matin, il a complètement oublié. Alors, il se dit, bon, si ça me revient, il faut vraiment que je m’en souvienne. Alors au milieu de la nuit il se souvient encore de ce super scénario, il dit là, maintenant, je vais m’en souvenir. Il se recouche, le lendemain matin il a encore oublié. Alors il dit, bon, là, il faut absolument que je prenne un cahier et je vais noter mon idée si elle me revient pendant la nuit ! Et dans la nuit, l’idée lui revient, il la note dans le cahier : l’argument, le scénario absolument génial et puis… il laisse le cahier. Il dit : « demain matin je pourrai relire ça à tête reposée. » Il se lève le lendemain matin, avec grande joie il ouvre son cahier, et qu’est-ce qu’il voit comme scénario extraordinaire ? Un homme tombe amoureux d’une femme. C’est tout.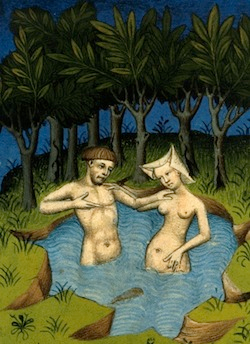 Alors vous comprenez pourquoi il croyait l’avoir oublié quand il était réveillé ! Mais, parce qu’effectivement, c’est la base, c’est l’exclamation d’Adam au départ. Les animaux, il arrive à les nommer, il est encore debout, il n’a pas encore perdu toute contenance, mais quand la femme est devant lui, il dit : « Ah ! ». Il est dans une exclamation, il entre dans un cantique, il est dépassé. Et déjà, vous voyez, accepter cette aventure où l’on est dépassé. Mais être dépassé, ça veut dire aussi entrer dans cette aventure. C’est donc ne pas réduire la femme à un objet de jouissance. Sinon, vous n’entrez pas dans cette aventure. Vous en faites un lieu de soulagement, de délassement physiologique, mais ce n’est pas la véritable aventure de la rencontre avec une femme. Et cela vous entraîne, en plus, dans un autre truc : la paternité. Alors, le truc complètement fou, parce que quand vous réfléchissez bien... Moi, quand je vais vers ma femme, je pense à ma femme… J’aime ma femme et puis tout d’un coup elle m’apprend qu’on va avoir un enfant. Quel rapport ? Non mais, franchement, quel rapport ? Parce que dans l’étreinte, je ne pense pas aux enfants, sinon je serais un pervers. Je pense pas aux enfants, je pense pas à ça, enfin, c’est pas à ça qu’on pense ! On est dans quelque chose qui est l’amour. L’homme se tourne vers sa femme, ce n’est pas avec le projet d’avoir des enfants. Simplement s’il laisse faire l’amour tel qu’il est tout d’un coup apparaît cette surabondance à laquelle il n’est donc pas préparé.
Alors vous comprenez pourquoi il croyait l’avoir oublié quand il était réveillé ! Mais, parce qu’effectivement, c’est la base, c’est l’exclamation d’Adam au départ. Les animaux, il arrive à les nommer, il est encore debout, il n’a pas encore perdu toute contenance, mais quand la femme est devant lui, il dit : « Ah ! ». Il est dans une exclamation, il entre dans un cantique, il est dépassé. Et déjà, vous voyez, accepter cette aventure où l’on est dépassé. Mais être dépassé, ça veut dire aussi entrer dans cette aventure. C’est donc ne pas réduire la femme à un objet de jouissance. Sinon, vous n’entrez pas dans cette aventure. Vous en faites un lieu de soulagement, de délassement physiologique, mais ce n’est pas la véritable aventure de la rencontre avec une femme. Et cela vous entraîne, en plus, dans un autre truc : la paternité. Alors, le truc complètement fou, parce que quand vous réfléchissez bien... Moi, quand je vais vers ma femme, je pense à ma femme… J’aime ma femme et puis tout d’un coup elle m’apprend qu’on va avoir un enfant. Quel rapport ? Non mais, franchement, quel rapport ? Parce que dans l’étreinte, je ne pense pas aux enfants, sinon je serais un pervers. Je pense pas aux enfants, je pense pas à ça, enfin, c’est pas à ça qu’on pense ! On est dans quelque chose qui est l’amour. L’homme se tourne vers sa femme, ce n’est pas avec le projet d’avoir des enfants. Simplement s’il laisse faire l’amour tel qu’il est tout d’un coup apparaît cette surabondance à laquelle il n’est donc pas préparé. Vous avez un enfant, vous n’avez pas pris des cours pour en avoir. Vous vous rendez compte. On vous fait passer des permis pour conduire une voiture, on ne vous fait pas passer des permis pour être père. Alors que c’est beaucoup plus dangereux. Pour la vie des autres. Pour la vie de l’enfant. Alors certains pourraient dire : « Vous devriez passer des permis. » Et c’est ça que veulent vous dire les experts. Les experts vont vous dire : « Il faut passer des permis parce que c’est seulement si vous avez passé des permis que tout va bien se passer. Il y aura un code de l’enfantement, comme il y a un code de la route. » Mais pourquoi ce n’est pas cela, la paternité ? Parce que la paternité c’est précisément l’aventure des aventures.
Vous avez un enfant, vous n’avez pas pris des cours pour en avoir. Vous vous rendez compte. On vous fait passer des permis pour conduire une voiture, on ne vous fait pas passer des permis pour être père. Alors que c’est beaucoup plus dangereux. Pour la vie des autres. Pour la vie de l’enfant. Alors certains pourraient dire : « Vous devriez passer des permis. » Et c’est ça que veulent vous dire les experts. Les experts vont vous dire : « Il faut passer des permis parce que c’est seulement si vous avez passé des permis que tout va bien se passer. Il y aura un code de l’enfantement, comme il y a un code de la route. » Mais pourquoi ce n’est pas cela, la paternité ? Parce que la paternité c’est précisément l’aventure des aventures. Vous savez que c’est une phrase de Charles Péguy qui dit que le père de famille est l’aventurier des temps modernes. Ce n’est pas une phrase comme ça, sentimentale, pour faire l’éloge du père de famille dans un monde qui méprise les pères et qui vénèrent les experts. C’est parce que c’est vrai ! Regardez toutes les grandes aventures que vous connaissez sont souvent des histoires de rapport au père, et où le héros lui-même va devoir avoir un enfant. Je parle d’aventures récentes qui ont dépassé la figure du héros comme ‘lone some cow-boy’, vous voyez. Qui n’a pas de parents, pas d’enfants. Regardez Harry Potter. C’est vraiment la question de la paternité qui est en jeu. Et le dernier opus, d’ailleurs, le montre spécialement. Est-ce que vous vous rendez compte que dans le dernier opus, que le grand combat de Harry Potter, le grand défi de Harry Potter, la grande aventure pour lui, ce n’est pas de réussir ses examens à Poudlard, ce n’est pas de gagner la coupe de feu, ce n’est pas d’avoir vaincu Valdemort : c’est d’avoir à élever ses fils et filles. Et notamment, il a des difficultés avec son fils Albus. C’est la première fois qu’on parle de Harry Potter dans cette église, et surtout qu’on parle de Harry Potter en chaire… Ce que je veux vous dire ici, c’est que c’est une question… J’aurais pu parler de Star Wars aussi. Ce sont des histoires de paternité qui sont en jeu, tout le temps. La grande aventure de Dark Vador c’est la question de sa paternité. Et dans la suite, c’est encore des histoires de paternités qui vont être en jeu.
Vous savez que c’est une phrase de Charles Péguy qui dit que le père de famille est l’aventurier des temps modernes. Ce n’est pas une phrase comme ça, sentimentale, pour faire l’éloge du père de famille dans un monde qui méprise les pères et qui vénèrent les experts. C’est parce que c’est vrai ! Regardez toutes les grandes aventures que vous connaissez sont souvent des histoires de rapport au père, et où le héros lui-même va devoir avoir un enfant. Je parle d’aventures récentes qui ont dépassé la figure du héros comme ‘lone some cow-boy’, vous voyez. Qui n’a pas de parents, pas d’enfants. Regardez Harry Potter. C’est vraiment la question de la paternité qui est en jeu. Et le dernier opus, d’ailleurs, le montre spécialement. Est-ce que vous vous rendez compte que dans le dernier opus, que le grand combat de Harry Potter, le grand défi de Harry Potter, la grande aventure pour lui, ce n’est pas de réussir ses examens à Poudlard, ce n’est pas de gagner la coupe de feu, ce n’est pas d’avoir vaincu Valdemort : c’est d’avoir à élever ses fils et filles. Et notamment, il a des difficultés avec son fils Albus. C’est la première fois qu’on parle de Harry Potter dans cette église, et surtout qu’on parle de Harry Potter en chaire… Ce que je veux vous dire ici, c’est que c’est une question… J’aurais pu parler de Star Wars aussi. Ce sont des histoires de paternité qui sont en jeu, tout le temps. La grande aventure de Dark Vador c’est la question de sa paternité. Et dans la suite, c’est encore des histoires de paternités qui vont être en jeu.  Donc, pourquoi est-ce la grande aventure ? Pourquoi êtes-vous un véritable aventurier quand vous devenez père ? Eh bien, parce que, d’une part, vous entrez dans quelque chose qui dépasse vos compétences. Il n’y a pas d’experts en éducation. Ce n’est pas possible. C’est une contradiction dans les termes. Ou alors c’est réduire l’éducation à une technique. Pourquoi ne peut-il pas y avoir d’experts dans ce domaine-là ? Parce que l’enjeu c’est de transmettre la vie. Et de dire qu’il est bon d’être vivant. Ce n’est pas de devenir compétent dans tel ou tel domaine, ce n’est pas simplement d’aider votre fils à être bon en math, ou à réussir les concours des grandes écoles. On s’en fou de ça. Le plus important, qui dépasse les compétences techniques et qui ne relève pas d’une compétence mais que le père peut faire c’est, voilà : « J’ai consenti à la vie, je t’ai accueilli, j’ai accueilli la vie, et à ce moment-là, dans ma responsabilité, je suis le témoin que la vie est bonne. Alors même que je n’y comprends rien. Alors même que je suis nul. Alors même que je commets des tas d’erreurs. » Et l’essentiel, ce n’est pas le fait de développer les compétences de l’enfant, mais de passer du temps avec lui, de montrer qu’il est bon qu’il soit là. Et dès lors, on reconnaît quelque chose qui dépasse nos programmes, qui dépasse nos plans, qui est l’aventure même d’une vie qui nous échappe. Qui est un évènement permanent qui se renouvelle de génération en génération.
Donc, pourquoi est-ce la grande aventure ? Pourquoi êtes-vous un véritable aventurier quand vous devenez père ? Eh bien, parce que, d’une part, vous entrez dans quelque chose qui dépasse vos compétences. Il n’y a pas d’experts en éducation. Ce n’est pas possible. C’est une contradiction dans les termes. Ou alors c’est réduire l’éducation à une technique. Pourquoi ne peut-il pas y avoir d’experts dans ce domaine-là ? Parce que l’enjeu c’est de transmettre la vie. Et de dire qu’il est bon d’être vivant. Ce n’est pas de devenir compétent dans tel ou tel domaine, ce n’est pas simplement d’aider votre fils à être bon en math, ou à réussir les concours des grandes écoles. On s’en fou de ça. Le plus important, qui dépasse les compétences techniques et qui ne relève pas d’une compétence mais que le père peut faire c’est, voilà : « J’ai consenti à la vie, je t’ai accueilli, j’ai accueilli la vie, et à ce moment-là, dans ma responsabilité, je suis le témoin que la vie est bonne. Alors même que je n’y comprends rien. Alors même que je suis nul. Alors même que je commets des tas d’erreurs. » Et l’essentiel, ce n’est pas le fait de développer les compétences de l’enfant, mais de passer du temps avec lui, de montrer qu’il est bon qu’il soit là. Et dès lors, on reconnaît quelque chose qui dépasse nos programmes, qui dépasse nos plans, qui est l’aventure même d’une vie qui nous échappe. Qui est un évènement permanent qui se renouvelle de génération en génération.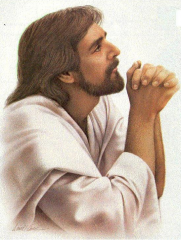 C’est aussi s’ouvrir à la vie au sens où l’on reconnaît qu’on n’est pas le père. Un père est toujours un fils. C’est même parfois pendant très longtemps, un gamin. Vous avez fait l’expérience… Bon, moi, je suis père de sept enfants, j’ai quarante-cinq ans, et au fond de moi je vois tout ce qui reste de l’adolescent que j’ai été. Je n’en suis pas complètement débarrassé. Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous sommes des pères, mais aucun d’entre nous n’est le Père. Et c’est ça ce qui se passe. C’est que dans notre incompétence, dans nos défaillances, à travers ces défaillances quelque chose va se jouer. On aura donné une torgnole trop forte à notre enfant, on aura crié abusivement, on aura commis des tas d’erreurs. Mais on ira vers notre enfant en lui disant : « Ce n’est pas moi le maître de la vie. Moi-même je suis un fils, moi-même je suis un pécheur, je te demande pardon. Et à travers mes défaillances je peux me tourner avec toi vers le Père des Miséricordes. » Et qu’est-ce que vous pouvez donner de plus grand à un enfant ?
C’est aussi s’ouvrir à la vie au sens où l’on reconnaît qu’on n’est pas le père. Un père est toujours un fils. C’est même parfois pendant très longtemps, un gamin. Vous avez fait l’expérience… Bon, moi, je suis père de sept enfants, j’ai quarante-cinq ans, et au fond de moi je vois tout ce qui reste de l’adolescent que j’ai été. Je n’en suis pas complètement débarrassé. Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous sommes des pères, mais aucun d’entre nous n’est le Père. Et c’est ça ce qui se passe. C’est que dans notre incompétence, dans nos défaillances, à travers ces défaillances quelque chose va se jouer. On aura donné une torgnole trop forte à notre enfant, on aura crié abusivement, on aura commis des tas d’erreurs. Mais on ira vers notre enfant en lui disant : « Ce n’est pas moi le maître de la vie. Moi-même je suis un fils, moi-même je suis un pécheur, je te demande pardon. Et à travers mes défaillances je peux me tourner avec toi vers le Père des Miséricordes. » Et qu’est-ce que vous pouvez donner de plus grand à un enfant ?  Vous connaissez ce passage du recouvrement au temple. Jésus dit : « Je dois être aux œuvres de mon Père. » Mais en, fait, tout père a pour tâche première de donner l’amour de la vie à son enfant, avant telle ou telle compétence. Parce que lui, il a accueilli la vie et donc il l’engage à le faire aussi. Mais aussi, il doit le tourner vers celui qui est le Père. De telle sorte que son fils, désormais, ce n’est pas sa chose. Ce n’est pas un être qui s’inscrit simplement dans un planning familial. Dans un désir ou dans un droit à avoir un enfant pour compenser les frustrations qu’on a eu nous-mêmes, par exemple, en projetant sur lui une réussite qu’on n’a pas eue. Ce n’est pas ça. C’est reconnaître qu’avec cet enfant s’ouvre un à venir. Le mot avenir c’est le mot qui constitue aventure : ce qui advient. Que tout d’un coup l’avenir se ré-ouvre à travers cet enfantement. Et on va être pris dans une aventure qu’on n’avait pas prévue, avec des enfants qui vont nous entraîner dans des tas d’histoires dramatiques qu’on n’avait pas envisagées. Mais c’est ça l’aventure de la vie. L’aventure première.
Vous connaissez ce passage du recouvrement au temple. Jésus dit : « Je dois être aux œuvres de mon Père. » Mais en, fait, tout père a pour tâche première de donner l’amour de la vie à son enfant, avant telle ou telle compétence. Parce que lui, il a accueilli la vie et donc il l’engage à le faire aussi. Mais aussi, il doit le tourner vers celui qui est le Père. De telle sorte que son fils, désormais, ce n’est pas sa chose. Ce n’est pas un être qui s’inscrit simplement dans un planning familial. Dans un désir ou dans un droit à avoir un enfant pour compenser les frustrations qu’on a eu nous-mêmes, par exemple, en projetant sur lui une réussite qu’on n’a pas eue. Ce n’est pas ça. C’est reconnaître qu’avec cet enfant s’ouvre un à venir. Le mot avenir c’est le mot qui constitue aventure : ce qui advient. Que tout d’un coup l’avenir se ré-ouvre à travers cet enfantement. Et on va être pris dans une aventure qu’on n’avait pas prévue, avec des enfants qui vont nous entraîner dans des tas d’histoires dramatiques qu’on n’avait pas envisagées. Mais c’est ça l’aventure de la vie. L’aventure première.  C’est la vie que garantit le Christ. C’est la vie qu’il garantit sur cette terre, déjà, au centuple. N’oubliez pas qu’il y a des promesses pour le temps, pas simplement pour l’éternité. Mais aussi pour l’éternité. Parce que le Christ ressuscité, que fait-il ? Est-ce qu’il fait des trucs de superman, des trucs de super technologie ? Est-ce qu’il fait de grands sons et lumière ? Il se retrouve au milieu de ses disciples. Et il mange avec eux. Et il leur lit les Écritures comme il l’avait fait autrefois. Il parle avec eux. Il mène cette vie simple que le scoutisme essaie de réintroduire dans une vie de plus en plus technologisée et virtualisée.
C’est la vie que garantit le Christ. C’est la vie qu’il garantit sur cette terre, déjà, au centuple. N’oubliez pas qu’il y a des promesses pour le temps, pas simplement pour l’éternité. Mais aussi pour l’éternité. Parce que le Christ ressuscité, que fait-il ? Est-ce qu’il fait des trucs de superman, des trucs de super technologie ? Est-ce qu’il fait de grands sons et lumière ? Il se retrouve au milieu de ses disciples. Et il mange avec eux. Et il leur lit les Écritures comme il l’avait fait autrefois. Il parle avec eux. Il mène cette vie simple que le scoutisme essaie de réintroduire dans une vie de plus en plus technologisée et virtualisée.  Fabrice Hadjadj
Fabrice Hadjadj
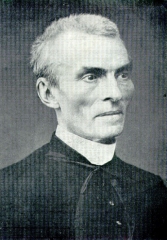 Pierre-Julien Eymard passe par différentes étapes. Dès ses premières années, où sa mère très pieuse l’emmène tous les jours à l’église, il est attiré par l’Eucharistie. À sept ans, il est surpris par sa grande sœur derrière l’autel, sur un escabeau, la tête penchée ; il s’explique ainsi : « C’est que j’écoute et je l’entends mieux d’ici. » Sa première communion, à 12 ans, est un jour de grandes grâces qui fait naître en lui le désir d’être prêtre. Après un essai chez les Oblats de Marie Immaculée à Marseille (1829), il entre au Grand Séminaire de Grenoble (1831). Devenu prêtre le 20 juillet 1834, il s’occupe successivement de deux paroisses de l’Isère : il est d’abord vicaire à Chatte (1834-1837), puis curé à Monteynard (1837-1839). Suivant l’appel à la vie religieuse, il entre chez les Maristes (1839) où il reste jusqu’à la fondation de la congrégation du Saint-Sacrement à Paris (13 mai 1856). Tous ces passages laissent percevoir le cheminement qu’il a parcouru intérieurement, un chemin qu’il est important pour nous de rappeler.
Pierre-Julien Eymard passe par différentes étapes. Dès ses premières années, où sa mère très pieuse l’emmène tous les jours à l’église, il est attiré par l’Eucharistie. À sept ans, il est surpris par sa grande sœur derrière l’autel, sur un escabeau, la tête penchée ; il s’explique ainsi : « C’est que j’écoute et je l’entends mieux d’ici. » Sa première communion, à 12 ans, est un jour de grandes grâces qui fait naître en lui le désir d’être prêtre. Après un essai chez les Oblats de Marie Immaculée à Marseille (1829), il entre au Grand Séminaire de Grenoble (1831). Devenu prêtre le 20 juillet 1834, il s’occupe successivement de deux paroisses de l’Isère : il est d’abord vicaire à Chatte (1834-1837), puis curé à Monteynard (1837-1839). Suivant l’appel à la vie religieuse, il entre chez les Maristes (1839) où il reste jusqu’à la fondation de la congrégation du Saint-Sacrement à Paris (13 mai 1856). Tous ces passages laissent percevoir le cheminement qu’il a parcouru intérieurement, un chemin qu’il est important pour nous de rappeler. Conduit par des grâces à la fois simples et profondes, Pierre-Julien comprend sa vocation. En 1845 à l’église Saint-Paul de Lyon, pendant la procession avec le Saint-Sacrement un jour de Fête-Dieu, il est saisi d’une foi forte en Jésus-Christ présent dans l’Eucharistie et demande à Dieu la grâce d’avoir le zèle apostolique de saint Paul. En 1849, alors qu’il est Provincial, il visite la maison mariste de Paris. Il découvre en cette ville l’œuvre de l’Adoration nocturne, et par la même occasion, il entre en relation avec le comte Raymond de Cuers qui sera son premier compagnon dans la fondation de l’œuvre eucharistique. Il fait aussi connaissance de la fondatrice de l’Adoration réparatrice, la Mère Marie-Thérèse Dubouché. Le 21 janvier 1851, au sanctuaire de Notre-Dame de Fourvière (Lyon), il discerne l’urgence de travailler au renouvellement de la vie chrétienne par l’Eucharistie et voit l’importance d’une formation approfondie pour les prêtres et les laïcs.
Conduit par des grâces à la fois simples et profondes, Pierre-Julien comprend sa vocation. En 1845 à l’église Saint-Paul de Lyon, pendant la procession avec le Saint-Sacrement un jour de Fête-Dieu, il est saisi d’une foi forte en Jésus-Christ présent dans l’Eucharistie et demande à Dieu la grâce d’avoir le zèle apostolique de saint Paul. En 1849, alors qu’il est Provincial, il visite la maison mariste de Paris. Il découvre en cette ville l’œuvre de l’Adoration nocturne, et par la même occasion, il entre en relation avec le comte Raymond de Cuers qui sera son premier compagnon dans la fondation de l’œuvre eucharistique. Il fait aussi connaissance de la fondatrice de l’Adoration réparatrice, la Mère Marie-Thérèse Dubouché. Le 21 janvier 1851, au sanctuaire de Notre-Dame de Fourvière (Lyon), il discerne l’urgence de travailler au renouvellement de la vie chrétienne par l’Eucharistie et voit l’importance d’une formation approfondie pour les prêtres et les laïcs.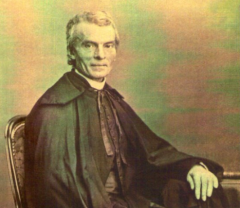 Dès le début et tout au long de son ministère, l’apostolat du Père Eymard est multiforme. Il associe des laïcs à son œuvre par l’Agrégation du Saint-Sacrement, il met sur pied l’œuvre de la première communion des adultes, des jeunes ouvriers, des chiffonniers et des marginaux des banlieues ; il s’adonne à la prédication et à la direction spirituelle. Il promeut la liturgie romaine plutôt que les liturgies gallicanes, et tente d’alimenter la vie spirituelle des prêtres par l’Eucharistie. Tout ce qu’il fait part de l’Eucharistie, est motivé par l’Eucharistie et a comme but faire connaître mieux l’Eucharistie. Fasciné par ce mystère, le Père Eymard affirme : « La sainte Eucharistie, c’est Jésus passé, présent et futur » (PG 356, 1). Il est assoiffé de pénétrer ses secrets, d’ouvrir son cœur aux richesses d’intériorité de l’Évangile de saint Jean qu’il médite si souvent : « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui » (Jean 6, 56). Le temps qu’il passe en adoration est très fécond pour son ministère ; un dynamisme et une force nouvelle l’imprègnent. Sa vision de l’Eucharistie évolue sans cesse et devient vie en lui.
Dès le début et tout au long de son ministère, l’apostolat du Père Eymard est multiforme. Il associe des laïcs à son œuvre par l’Agrégation du Saint-Sacrement, il met sur pied l’œuvre de la première communion des adultes, des jeunes ouvriers, des chiffonniers et des marginaux des banlieues ; il s’adonne à la prédication et à la direction spirituelle. Il promeut la liturgie romaine plutôt que les liturgies gallicanes, et tente d’alimenter la vie spirituelle des prêtres par l’Eucharistie. Tout ce qu’il fait part de l’Eucharistie, est motivé par l’Eucharistie et a comme but faire connaître mieux l’Eucharistie. Fasciné par ce mystère, le Père Eymard affirme : « La sainte Eucharistie, c’est Jésus passé, présent et futur » (PG 356, 1). Il est assoiffé de pénétrer ses secrets, d’ouvrir son cœur aux richesses d’intériorité de l’Évangile de saint Jean qu’il médite si souvent : « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui » (Jean 6, 56). Le temps qu’il passe en adoration est très fécond pour son ministère ; un dynamisme et une force nouvelle l’imprègnent. Sa vision de l’Eucharistie évolue sans cesse et devient vie en lui.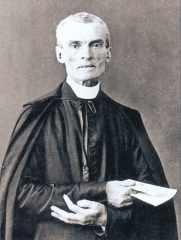 Les dernières années du Père Eymard ont été marquées par la maladie et des souffrances de tout genre : problèmes financiers, oppositions, incompréhensions, humiliations, perte de l’estime des évêques, nuit spirituelle. Malgré cela, ses paroles sont restées ardentes comme le feu et ses lettres de direction spirituelle riches d’invitations à la joie et à l’action de grâce pour les bienfaits de Dieu. Après avoir travaillé sans cesse, jusqu’à l’épuisement, il meurt à La Mure d’Isère le 1er août 1868. L’épitaphe sur sa tombe nous livre son message : « Aimons Jésus, qui nous aime tant dans son divin Sacrement. »
Les dernières années du Père Eymard ont été marquées par la maladie et des souffrances de tout genre : problèmes financiers, oppositions, incompréhensions, humiliations, perte de l’estime des évêques, nuit spirituelle. Malgré cela, ses paroles sont restées ardentes comme le feu et ses lettres de direction spirituelle riches d’invitations à la joie et à l’action de grâce pour les bienfaits de Dieu. Après avoir travaillé sans cesse, jusqu’à l’épuisement, il meurt à La Mure d’Isère le 1er août 1868. L’épitaphe sur sa tombe nous livre son message : « Aimons Jésus, qui nous aime tant dans son divin Sacrement. » Au terme des procès ordinaires de Grenoble et de Paris, ouverts en 1898, il est béatifié par Pie XI le 12 juillet 1925. Le 9 décembre 1962, à la fin de la première session du Concile Vatican II, le pape Saint Jean XXIII proclamait « Saint » Pierre-Julien Eymard. Ce jour-là, le Pape dans son homélie disait : « Sa note caractéristique, l’idée directrice de toutes ses activités sacerdotales, on peut le dire, ce fut l’Eucharistie : le culte et l’apostolat eucharistiques. » Le pape saint Jean-Paul II l’a désigné à tous les fidèles comme un apôtre éminent de l’Eucharistie (9 décembre 1995), et a fixé sa fête liturgique à la date du 2 août.
Au terme des procès ordinaires de Grenoble et de Paris, ouverts en 1898, il est béatifié par Pie XI le 12 juillet 1925. Le 9 décembre 1962, à la fin de la première session du Concile Vatican II, le pape Saint Jean XXIII proclamait « Saint » Pierre-Julien Eymard. Ce jour-là, le Pape dans son homélie disait : « Sa note caractéristique, l’idée directrice de toutes ses activités sacerdotales, on peut le dire, ce fut l’Eucharistie : le culte et l’apostolat eucharistiques. » Le pape saint Jean-Paul II l’a désigné à tous les fidèles comme un apôtre éminent de l’Eucharistie (9 décembre 1995), et a fixé sa fête liturgique à la date du 2 août.


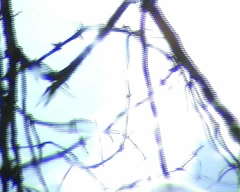
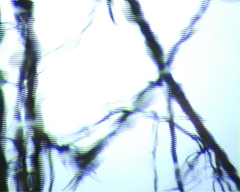 La psychologie fut un des premiers intérêts d'Edith. Mais, après quatre semestres à l'université de Breslau, elle déchanta : « C'était dès le début une erreur de songer à faire un travail en psychologie. Toutes mes études en psychologie m'avaient seulement convaincue que cette science en était encore à ses premiers balbutiements […] Et si ce que j'avais appris jusque là sur la phénoménologie me fascinait tellement, c'était parce qu'elle consistait spécifiquement en ce travail de clarification et qu'on y forgeait soi-même dès le début les outils intellectuels dont on avait besoin. »
La psychologie fut un des premiers intérêts d'Edith. Mais, après quatre semestres à l'université de Breslau, elle déchanta : « C'était dès le début une erreur de songer à faire un travail en psychologie. Toutes mes études en psychologie m'avaient seulement convaincue que cette science en était encore à ses premiers balbutiements […] Et si ce que j'avais appris jusque là sur la phénoménologie me fascinait tellement, c'était parce qu'elle consistait spécifiquement en ce travail de clarification et qu'on y forgeait soi-même dès le début les outils intellectuels dont on avait besoin. » Quand Etty Hillesum, en mars 41, s'adresse au psychologue Julius Spier, elle est tout simplement en quête d'elle-même. Le journal qu'elle tient à partir de cette rencontre témoigne d'une personnalité vibrante, sensuelle, généreuse et possessive à la fois, surtout étonnamment lucide sur elle-même et sur les autres. Elle est partagée entre un puissant appétit de vivre et de grands passages à vide : « J'ai reçu assez de dons intellectuels pour pouvoir tout sonder, tout aborder, tout saisir en formules claires ; on me croit supérieurement informée de bien des problèmes de la vie ; pourtant là, tout au fond de moi, il y a une pelote agglutinée, quelque chose me retient dans une poigne de fer, et toute ma clarté de pensée ne m'empêche pas d'être bien souvent une pauvre godiche peureuse », écrit-elle à la première page de son journal
Quand Etty Hillesum, en mars 41, s'adresse au psychologue Julius Spier, elle est tout simplement en quête d'elle-même. Le journal qu'elle tient à partir de cette rencontre témoigne d'une personnalité vibrante, sensuelle, généreuse et possessive à la fois, surtout étonnamment lucide sur elle-même et sur les autres. Elle est partagée entre un puissant appétit de vivre et de grands passages à vide : « J'ai reçu assez de dons intellectuels pour pouvoir tout sonder, tout aborder, tout saisir en formules claires ; on me croit supérieurement informée de bien des problèmes de la vie ; pourtant là, tout au fond de moi, il y a une pelote agglutinée, quelque chose me retient dans une poigne de fer, et toute ma clarté de pensée ne m'empêche pas d'être bien souvent une pauvre godiche peureuse », écrit-elle à la première page de son journal Mais il y a un second niveau de lecture. Edith et Etty étaient juives l'une et l'autre. Elles ont eu une jeunesse peu ou pas pratiquante. Edith, malgré la grande piété de sa mère, ne fréquente plus la synagogue après ses quatorze ans. Etty n'a quant à elle reçu aucune formation religieuse, et ne découvre réellement la Bible que sur le conseil de Julius Spier. Aucune des deux n'est donc à proprement parler une convertie du judaïsme. Mais l'une et l'autre font, à partir de ce fonds areligieux, un chemin spirituel qui conduit Edith au baptême et au carmel, et Etty à une intense vie de relation à Dieu, sans référence dogmatique ni appartenance synagogale ou ecclésiale. Dans l'enfer de Westerbork, c'est le Bréviaire pour Edith, la Bible pour Etty, qui sont leur source de paix et de force. Faut-il en conclure que l'une et l'autre, la première par sa conversion, la seconde par son absence de toute pratique, n'ont rien à voir avec le mystère d'Israël ? Leur rencontre nous conduit peut-être au contraire au cœur de ce mystère auquel elles ont été l'une et l'autre, de manière paradoxale au premier regard, profondément fidèles. Mais cette fidélité a pris deux chemins et deux visages en elles comme dans notre histoire, l'une ayant rencontré et confessant explicitement le Christ, l'autre non. Saint Paul nous donne à penser, dans sa Lettre aux Romains, que c'est seulement à la fin des temps, à l'heure de la miséricorde de Dieu, que ces deux fidélités se fondront en une seule et que ces deux chemins convergeront. C'est pourquoi la rencontre d'Edith et d'Etty, jusque dans son caractère à peine ébauché, est non seulement symbolique, mais prophétique : elle anticipe sur cette heure-là, à distance, sans qu'elles aient pu prononcer ensemble le nom du Christ, un nom qu'Etty ne cite pratiquement jamais, même si elle se nourrit de l'Évangile
Mais il y a un second niveau de lecture. Edith et Etty étaient juives l'une et l'autre. Elles ont eu une jeunesse peu ou pas pratiquante. Edith, malgré la grande piété de sa mère, ne fréquente plus la synagogue après ses quatorze ans. Etty n'a quant à elle reçu aucune formation religieuse, et ne découvre réellement la Bible que sur le conseil de Julius Spier. Aucune des deux n'est donc à proprement parler une convertie du judaïsme. Mais l'une et l'autre font, à partir de ce fonds areligieux, un chemin spirituel qui conduit Edith au baptême et au carmel, et Etty à une intense vie de relation à Dieu, sans référence dogmatique ni appartenance synagogale ou ecclésiale. Dans l'enfer de Westerbork, c'est le Bréviaire pour Edith, la Bible pour Etty, qui sont leur source de paix et de force. Faut-il en conclure que l'une et l'autre, la première par sa conversion, la seconde par son absence de toute pratique, n'ont rien à voir avec le mystère d'Israël ? Leur rencontre nous conduit peut-être au contraire au cœur de ce mystère auquel elles ont été l'une et l'autre, de manière paradoxale au premier regard, profondément fidèles. Mais cette fidélité a pris deux chemins et deux visages en elles comme dans notre histoire, l'une ayant rencontré et confessant explicitement le Christ, l'autre non. Saint Paul nous donne à penser, dans sa Lettre aux Romains, que c'est seulement à la fin des temps, à l'heure de la miséricorde de Dieu, que ces deux fidélités se fondront en une seule et que ces deux chemins convergeront. C'est pourquoi la rencontre d'Edith et d'Etty, jusque dans son caractère à peine ébauché, est non seulement symbolique, mais prophétique : elle anticipe sur cette heure-là, à distance, sans qu'elles aient pu prononcer ensemble le nom du Christ, un nom qu'Etty ne cite pratiquement jamais, même si elle se nourrit de l'Évangile C'est le même choix qu'a fait Edith. Elle l'a fait à partir d'une autre situation spirituelle, celle d'une chrétienne qui a redécouvert, du dedans de son baptême, le sens de l'élection d'Israël et la grâce d'y être charnellement rattachée : « Vous ne pouvez imaginer, écrit-elle, ce que cela signifie pour moi d'être une fille du peuple élu. C'est appartenir au Christ non seulement par l'esprit mais par le sang. »
C'est le même choix qu'a fait Edith. Elle l'a fait à partir d'une autre situation spirituelle, celle d'une chrétienne qui a redécouvert, du dedans de son baptême, le sens de l'élection d'Israël et la grâce d'y être charnellement rattachée : « Vous ne pouvez imaginer, écrit-elle, ce que cela signifie pour moi d'être une fille du peuple élu. C'est appartenir au Christ non seulement par l'esprit mais par le sang. » Et c'est peut-être ici, au cœur de leur plus grande différence apparente, que nous pouvons voir se rejoindre les deux itinéraires d'Etty et d'Edith, comme une sorte d'attestation concrète de cette unité qu'opère secrètement, sans l'imposer ni la forcer, la Croix du Christ au foyer de l'Histoire. Comme l'a relevé Philibert Secrétan
Et c'est peut-être ici, au cœur de leur plus grande différence apparente, que nous pouvons voir se rejoindre les deux itinéraires d'Etty et d'Edith, comme une sorte d'attestation concrète de cette unité qu'opère secrètement, sans l'imposer ni la forcer, la Croix du Christ au foyer de l'Histoire. Comme l'a relevé Philibert Secrétan

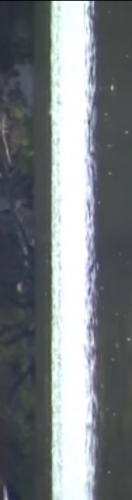



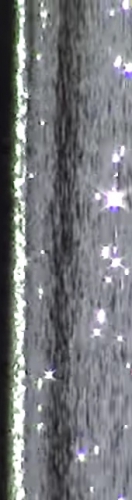







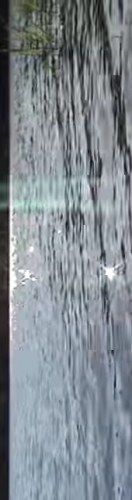

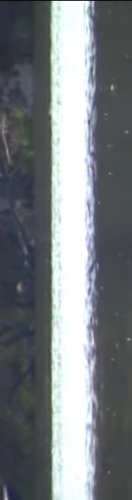



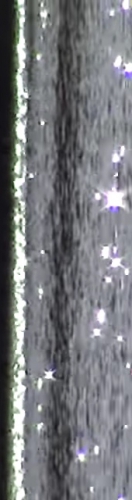





 Bruno de Saint Chamas
Bruno de Saint Chamas






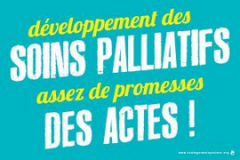

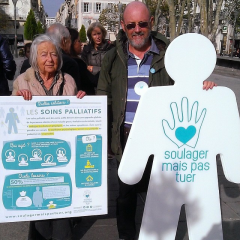




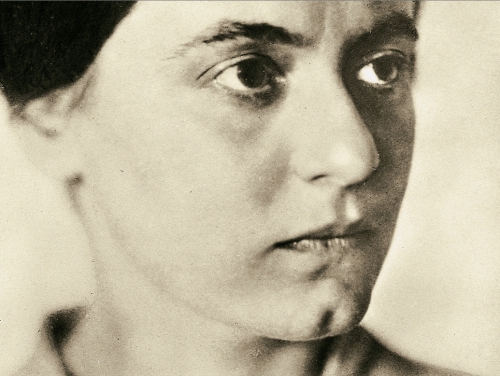
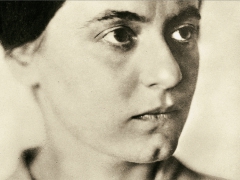



 « Tant que les urbains n’auront pas pris à bras le corps cette question de leurs campagnes, et qu’il n’y aura pas réconciliation de ces deux mondes, il n’y a pas d’espoir. Parce que c’est quanti-tativement les urbains qui peuvent faire pression. Les paysans sont cuits, ils sont dans une seringue de laquelle ils ne peuvent pas sortir. Mais si un jour l’ensemble des urbains questionne la société en disant : « Eh ! Attention ! Notre grenier on doit le préserver… notre grenier pour manger, mais aussi notre grenier de paysages à conserver… » ça fait du monde, hein ?! Et comment apprendre à ce que les urbains reposent la question de la campagne ? Il n’y a que l’éducation, il n’y a que l’école.
« Tant que les urbains n’auront pas pris à bras le corps cette question de leurs campagnes, et qu’il n’y aura pas réconciliation de ces deux mondes, il n’y a pas d’espoir. Parce que c’est quanti-tativement les urbains qui peuvent faire pression. Les paysans sont cuits, ils sont dans une seringue de laquelle ils ne peuvent pas sortir. Mais si un jour l’ensemble des urbains questionne la société en disant : « Eh ! Attention ! Notre grenier on doit le préserver… notre grenier pour manger, mais aussi notre grenier de paysages à conserver… » ça fait du monde, hein ?! Et comment apprendre à ce que les urbains reposent la question de la campagne ? Il n’y a que l’éducation, il n’y a que l’école. Le fait que ces petites villes rurales gardent ce qui fait encore leurs qualités, c’est qu’elles sont en perspective de leur rivière, elles sont en perspective de leur montagne, leur territoire agricole est encore en vue, la situation n’est pas bouchée comme elle l’est dans les grands centres urbains où vous ne savez plus où vous êtes. Où il y a la Seine qui fait qu’à Paris on a une géographie qui s’impose quand on est au bord de la Seine. Et puis comme beaucoup du système urbain, Paris est orienté par rapport à elle, sa géographie reste très présente, mais… Et puis, on a la butte Montmartre, on a des choses comme ça, on a quelques éléments de géographie, mais… De plus en plus les villes ont tendance à masquer tout ça. Et je pense qu’il y a une sorte de retour nécessaire à faire pour que l’on retrouve cette sorte de simplicité qui est celle de l’attention où l’on est. Qu’est-ce qui vaut la peine d’être conservé ? À L’Isle-d’Abeau, par exemple, à la sortie de l’école les enfants regardent la vue sur le Mont-Blanc. J’ai le sentiment que c’est mieux que quand ils sortent de l’école ils ne voient rien du tout… Parce qu’ils sont dans des haies, dans des systèmes de protection qui font que l’attention n’est portée sur rien. Quand vous êtes à L’Isle-d’Abeau, de savoir que vous participez d’un paysage, d’une vallée, qui est la grande vallée du Rhône, et que vous avez à l’horizon la chaîne de montagnes des Alpes, je ne sais pas si ça vous guérit de tous les malheurs… mais vous restez en intelligence avec le lieu. Et ça, c’est réactionnaire de penser comme ça ? Je ne crois pas, je pense que cette frénésie de vouloir… Aujourd’hui, il y a toute une série de gens qui voudrait faire penser à tout le monde que la modernité c’est le chaos. »
Le fait que ces petites villes rurales gardent ce qui fait encore leurs qualités, c’est qu’elles sont en perspective de leur rivière, elles sont en perspective de leur montagne, leur territoire agricole est encore en vue, la situation n’est pas bouchée comme elle l’est dans les grands centres urbains où vous ne savez plus où vous êtes. Où il y a la Seine qui fait qu’à Paris on a une géographie qui s’impose quand on est au bord de la Seine. Et puis comme beaucoup du système urbain, Paris est orienté par rapport à elle, sa géographie reste très présente, mais… Et puis, on a la butte Montmartre, on a des choses comme ça, on a quelques éléments de géographie, mais… De plus en plus les villes ont tendance à masquer tout ça. Et je pense qu’il y a une sorte de retour nécessaire à faire pour que l’on retrouve cette sorte de simplicité qui est celle de l’attention où l’on est. Qu’est-ce qui vaut la peine d’être conservé ? À L’Isle-d’Abeau, par exemple, à la sortie de l’école les enfants regardent la vue sur le Mont-Blanc. J’ai le sentiment que c’est mieux que quand ils sortent de l’école ils ne voient rien du tout… Parce qu’ils sont dans des haies, dans des systèmes de protection qui font que l’attention n’est portée sur rien. Quand vous êtes à L’Isle-d’Abeau, de savoir que vous participez d’un paysage, d’une vallée, qui est la grande vallée du Rhône, et que vous avez à l’horizon la chaîne de montagnes des Alpes, je ne sais pas si ça vous guérit de tous les malheurs… mais vous restez en intelligence avec le lieu. Et ça, c’est réactionnaire de penser comme ça ? Je ne crois pas, je pense que cette frénésie de vouloir… Aujourd’hui, il y a toute une série de gens qui voudrait faire penser à tout le monde que la modernité c’est le chaos. »












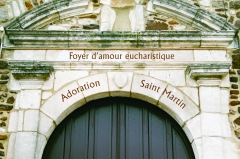





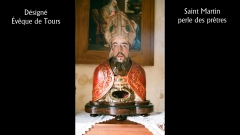
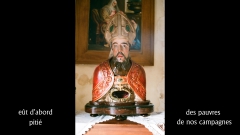
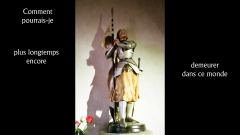
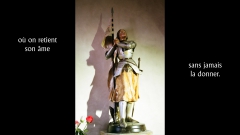
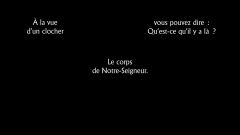
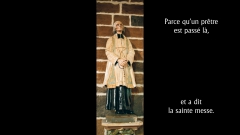


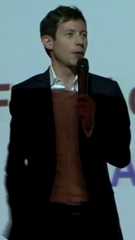






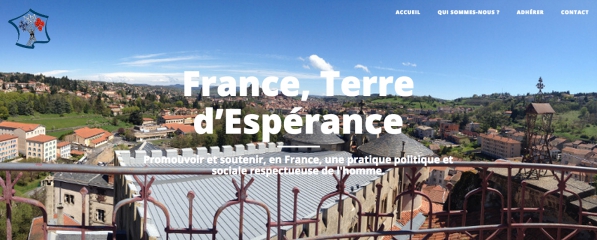
 Louis Daufresne : Quand la grande muette commence à l’ouvrir c’est que les choses ne vont pas si bien que cela. Les scènes de guerre en plein Paris habitent toujours les esprits d’autant que la nouvelle caricature de Mahomet publié par Charlie Hebdo, édition diffusée à des millions d’exemplaires, risque fort de mettre le feu à la planète. Déjà des églises brûlent, des hommes meurent. À qui la faute ? Le principe de précaution que s’imposent de plus en plus les peuples vieux et frileux aurait sans doute eu ici toute sa pertinence. Le général Didier Tauzin connaît bien les forces spéciales : il a commandé le premier RPIMA Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine, prestigieuse unité. Il a dirigé plusieurs opérations de libération d’otages. Aujourd’hui, il s’engage en fondant une association, France, terre d’Espérance et en publiant un essai dont nous allons parler au fil de cette émission : Rebâtir la France. Général Tauzin, bonjour.
Louis Daufresne : Quand la grande muette commence à l’ouvrir c’est que les choses ne vont pas si bien que cela. Les scènes de guerre en plein Paris habitent toujours les esprits d’autant que la nouvelle caricature de Mahomet publié par Charlie Hebdo, édition diffusée à des millions d’exemplaires, risque fort de mettre le feu à la planète. Déjà des églises brûlent, des hommes meurent. À qui la faute ? Le principe de précaution que s’imposent de plus en plus les peuples vieux et frileux aurait sans doute eu ici toute sa pertinence. Le général Didier Tauzin connaît bien les forces spéciales : il a commandé le premier RPIMA Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine, prestigieuse unité. Il a dirigé plusieurs opérations de libération d’otages. Aujourd’hui, il s’engage en fondant une association, France, terre d’Espérance et en publiant un essai dont nous allons parler au fil de cette émission : Rebâtir la France. Général Tauzin, bonjour. G. D.T. : Oui, absolument, c’est vrai. Ce n’est qu’un début. Nous sommes maintenant… D’ailleurs monsieur Valls l’a dit lui-même : nous sommes maintenant dans une guerre qui a tous les aspects d’une guerre mondiale. Non pas du tout de celles que nous avons connues au XXème siècle, mais une guerre d’abord complètement asymétrique : du point de vue technologique, au moins, c’est-à-dire des gens extrêmement rustiques qui se contentent de vraiment très peu de choses, qui passent complètement inaperçus, qui ne coûtent rien à leurs commanditaires… face à des armées ou les polices installées et lourdement équipées… face à des populations qui ne s’attendent pas du tout à cela, ne comprennent pas encore qu’elles sont dans une guerre. Asymétrique, aussi, dans le sens où nous ne sommes pas dans une guerre d’armées. Il n’y a pas de champ de batailles. Le champ de bataille c’est le monde entier et c’est en même temps chacun d’entre nous, c’est notre conscience… Il s’agit de nous terroriser, de nous faire progressivement baisser la garde intellectuelle — si je peux dire — pour aller dans le sens idéologique que veulent ces gens-là. C’est aussi une guerre idéologique.
G. D.T. : Oui, absolument, c’est vrai. Ce n’est qu’un début. Nous sommes maintenant… D’ailleurs monsieur Valls l’a dit lui-même : nous sommes maintenant dans une guerre qui a tous les aspects d’une guerre mondiale. Non pas du tout de celles que nous avons connues au XXème siècle, mais une guerre d’abord complètement asymétrique : du point de vue technologique, au moins, c’est-à-dire des gens extrêmement rustiques qui se contentent de vraiment très peu de choses, qui passent complètement inaperçus, qui ne coûtent rien à leurs commanditaires… face à des armées ou les polices installées et lourdement équipées… face à des populations qui ne s’attendent pas du tout à cela, ne comprennent pas encore qu’elles sont dans une guerre. Asymétrique, aussi, dans le sens où nous ne sommes pas dans une guerre d’armées. Il n’y a pas de champ de batailles. Le champ de bataille c’est le monde entier et c’est en même temps chacun d’entre nous, c’est notre conscience… Il s’agit de nous terroriser, de nous faire progressivement baisser la garde intellectuelle — si je peux dire — pour aller dans le sens idéologique que veulent ces gens-là. C’est aussi une guerre idéologique. Marion Duchêne : Portrait
Marion Duchêne : Portrait L.D. : Je reviens à ce que vous disiez tout à l’heure, général Didier Tauzin, à propos de cette infime minorité qui a une lecture littérale du Coran. Comment peut-on évaluer le soutien dont elle dispose dans les banlieues, cette infime minorité ? Je crois que vous avez des statistiques à nous faire partager…
L.D. : Je reviens à ce que vous disiez tout à l’heure, général Didier Tauzin, à propos de cette infime minorité qui a une lecture littérale du Coran. Comment peut-on évaluer le soutien dont elle dispose dans les banlieues, cette infime minorité ? Je crois que vous avez des statistiques à nous faire partager…

 Chronique de Gérard Leclerc : Michel Onfray et René Girard
Chronique de Gérard Leclerc : Michel Onfray et René Girard L.D. : C’est le général Didier Tauzin, général des Forces Spéciales qui est avec nous ce matin, notre grand témoin. Rebâtir la France aux éditions Mareuil. Telle est son ambition, sans cynisme, résolu à quitter la logique des partis et des sondages. François Hollande et Manuel Valls sortent des abysses d’impopularité grâce, paraît-il, à l’unité retrouvée. Le général Tauzin en appelle à la conscience citoyenne estimant, ce sont vos mots mon général, « que l’État ne sert plus la nation que la politique, que la France n’est plus qu’une étape dans un parcours professionnel au service de l’oligarchie mondiale. » Mon général, ce n’est pas si fréquent que des officiers supérieurs se retournent contre le système qu’ils ont servi, qu’ils se lancent dans une autre bataille. Une bataille autrement difficile qui est celle des idées.
L.D. : C’est le général Didier Tauzin, général des Forces Spéciales qui est avec nous ce matin, notre grand témoin. Rebâtir la France aux éditions Mareuil. Telle est son ambition, sans cynisme, résolu à quitter la logique des partis et des sondages. François Hollande et Manuel Valls sortent des abysses d’impopularité grâce, paraît-il, à l’unité retrouvée. Le général Tauzin en appelle à la conscience citoyenne estimant, ce sont vos mots mon général, « que l’État ne sert plus la nation que la politique, que la France n’est plus qu’une étape dans un parcours professionnel au service de l’oligarchie mondiale. » Mon général, ce n’est pas si fréquent que des officiers supérieurs se retournent contre le système qu’ils ont servi, qu’ils se lancent dans une autre bataille. Une bataille autrement difficile qui est celle des idées.  G. D.T. : C’est assez rare, en effet. Dans notre pays c’est mêmes très rare et cela suscite toujours des questions. Je peux tout de suite rassurer Manuel Valls — ou alors lui occasionner un regret, peut importe… Il ne s’agit pas pour nous, bien entendu — je dis pour nous parce que je ne suis pas seul — il ne s’agit pas de coup d’État, de putsch, etc. C’est évident. Nous restons dans la plus parfaite légalité, c’est clair. Surtout en ce moment où la situation est très tendue en France : il ne s’agit pas d’en rajouter, c’est évident.
G. D.T. : C’est assez rare, en effet. Dans notre pays c’est mêmes très rare et cela suscite toujours des questions. Je peux tout de suite rassurer Manuel Valls — ou alors lui occasionner un regret, peut importe… Il ne s’agit pas pour nous, bien entendu — je dis pour nous parce que je ne suis pas seul — il ne s’agit pas de coup d’État, de putsch, etc. C’est évident. Nous restons dans la plus parfaite légalité, c’est clair. Surtout en ce moment où la situation est très tendue en France : il ne s’agit pas d’en rajouter, c’est évident.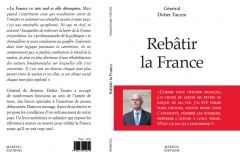
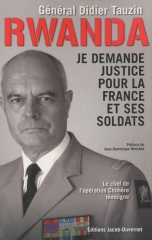 G. D.T. : (rire) Voilà… Nous avons connu le Liban. La Somalie. Le Rwanda. La Yougoslavie. Et l’un de nous a connu le Cambodge. On a vu — d’un peu plus loin parce que nous étions hors-circuit à ce moment là — la Côte d’Ivoire, etc. Sur le terrain, moi j’ai connu le Liban, la Somalie, le Rwanda, la Yougoslavie. Et au printemps 2013 certains signes nous laissaient croire que potentiellement notre pays allait dans cette direction. Pour nous, c’est insupportable. Insupportable ! Des voitures piégées avec de la viande humaine sur les murs… Je me souviens, en Somalie, j’étais sous un épineux en train de rédiger mes ordres pour le lendemain : eh bien sur 360°, à perte de vue, une tombe tous les deux mètres. Et entre les tombes, des gosses affamés. Je ne veux pas voir ça chez moi. Donc, notre idée est de préparer un recours — c’est très clair — à une situation dramatique. C’est ça notre point de départ. Cette situation dramatique peut survenir très rapidement. Alors on fera ce qu’on pourra. Mais on ne laissera pas la France tomber.
G. D.T. : (rire) Voilà… Nous avons connu le Liban. La Somalie. Le Rwanda. La Yougoslavie. Et l’un de nous a connu le Cambodge. On a vu — d’un peu plus loin parce que nous étions hors-circuit à ce moment là — la Côte d’Ivoire, etc. Sur le terrain, moi j’ai connu le Liban, la Somalie, le Rwanda, la Yougoslavie. Et au printemps 2013 certains signes nous laissaient croire que potentiellement notre pays allait dans cette direction. Pour nous, c’est insupportable. Insupportable ! Des voitures piégées avec de la viande humaine sur les murs… Je me souviens, en Somalie, j’étais sous un épineux en train de rédiger mes ordres pour le lendemain : eh bien sur 360°, à perte de vue, une tombe tous les deux mètres. Et entre les tombes, des gosses affamés. Je ne veux pas voir ça chez moi. Donc, notre idée est de préparer un recours — c’est très clair — à une situation dramatique. C’est ça notre point de départ. Cette situation dramatique peut survenir très rapidement. Alors on fera ce qu’on pourra. Mais on ne laissera pas la France tomber.  Nous sommes plus de 500 étudiants en médecine de toute la France, regroupés au sein de l'association
Nous sommes plus de 500 étudiants en médecine de toute la France, regroupés au sein de l'association  Les lois sur la fin de vie ne sont pas assez connues et appliquées. Ce constat unanime motive certains pour demander un nouveau texte. Nous refusons cette démarche. Le cadre actuel de 2005, reconnu et estimé à l'étranger, ouvre une troisième voie raisonnable entre acharnement thérapeutique et euthanasie. La priorité est de faire connaitre cette loi, et non d'en écrire une nouvelle.
Les lois sur la fin de vie ne sont pas assez connues et appliquées. Ce constat unanime motive certains pour demander un nouveau texte. Nous refusons cette démarche. Le cadre actuel de 2005, reconnu et estimé à l'étranger, ouvre une troisième voie raisonnable entre acharnement thérapeutique et euthanasie. La priorité est de faire connaitre cette loi, et non d'en écrire une nouvelle. Ce procédé consiste à faire baisser la vigilance du malade de manière réversible dans les situations extrêmes de souffrances liées à une angoisse forte, de détresse respiratoire ou de très rares douleurs réfractaires au traitement antalgique. Ce protocole n'intervient qu'en dernier recours, il concerne une très faible proportion des personnes accompagnées en soins palliatifs. En effet, les médicaments utilisés sont néfastes pour l'organisme, et peuvent abréger la vie du patient par ailleurs.
Ce procédé consiste à faire baisser la vigilance du malade de manière réversible dans les situations extrêmes de souffrances liées à une angoisse forte, de détresse respiratoire ou de très rares douleurs réfractaires au traitement antalgique. Ce protocole n'intervient qu'en dernier recours, il concerne une très faible proportion des personnes accompagnées en soins palliatifs. En effet, les médicaments utilisés sont néfastes pour l'organisme, et peuvent abréger la vie du patient par ailleurs. Cette mesure n'est pas un ajustement. Elle franchit une limite dangereuse : nous entrons dans la logique euthanasique.
Cette mesure n'est pas un ajustement. Elle franchit une limite dangereuse : nous entrons dans la logique euthanasique. Jean Fontant
Jean Fontant
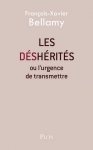

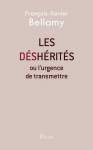


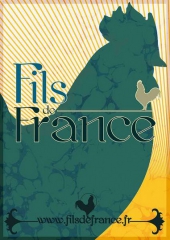 Bonsoir, merci pour votre présence, merci à l'ensemble de l’équipe de
Bonsoir, merci pour votre présence, merci à l'ensemble de l’équipe de  La société contemporaine ne se reconnaît pas comme une société nihiliste. Nous ne cessons de rapporter nos comportements politiques, sociaux, et même économiques, à des postulats éthiques : comme individus, comme citoyens, comme consommateurs, nous voudrions agir en fonction de nos valeurs, au point que le vocabulaire des valeurs a littéralement envahi le débat public. Rien ne semble plus indiscutable que l’importance des valeurs ; certaines sont contingentes – les instituts de sondage distingueront les « valeurs de droite » des « valeurs de gauche » ; de quelques autres, au contraire, on voudrait qu’elles soient unanimement partagées : ainsi des « valeurs de la République », par exemple. Le discours de la défense des valeurs, qu’il soit partisan ou universaliste, donne aux discussions politiques, médiatiques et intellectuelles, une tonalité dogmatique bien paradoxale pour notre société.
La société contemporaine ne se reconnaît pas comme une société nihiliste. Nous ne cessons de rapporter nos comportements politiques, sociaux, et même économiques, à des postulats éthiques : comme individus, comme citoyens, comme consommateurs, nous voudrions agir en fonction de nos valeurs, au point que le vocabulaire des valeurs a littéralement envahi le débat public. Rien ne semble plus indiscutable que l’importance des valeurs ; certaines sont contingentes – les instituts de sondage distingueront les « valeurs de droite » des « valeurs de gauche » ; de quelques autres, au contraire, on voudrait qu’elles soient unanimement partagées : ainsi des « valeurs de la République », par exemple. Le discours de la défense des valeurs, qu’il soit partisan ou universaliste, donne aux discussions politiques, médiatiques et intellectuelles, une tonalité dogmatique bien paradoxale pour notre société.
 « Cher(e)s ami(e)s, depuis le début de mon engagement, je n’ai eu de cesse de répéter que je suis homosexuel et pas gay. Si je précise de nouveau cela, à l’occasion du bilan de notre grenelle de la Famille, c’est que cette distinction n’est en rien une subtilité linguistique de ma part. Elle revêt une réalité qui est la cause de ce qui s’est passé hier aux États-Unis, ce qui se passe aujourd’hui en France, et ce qui se passera demain dans toute l’Europe, contre la Famille. Le lobby gay est déterminé à détruire, et peut importe les moyens, les institutions du mariage et de la famille ; aidée en cela par certains lobby féministes, comme les femen, mais pas seulement.
« Cher(e)s ami(e)s, depuis le début de mon engagement, je n’ai eu de cesse de répéter que je suis homosexuel et pas gay. Si je précise de nouveau cela, à l’occasion du bilan de notre grenelle de la Famille, c’est que cette distinction n’est en rien une subtilité linguistique de ma part. Elle revêt une réalité qui est la cause de ce qui s’est passé hier aux États-Unis, ce qui se passe aujourd’hui en France, et ce qui se passera demain dans toute l’Europe, contre la Famille. Le lobby gay est déterminé à détruire, et peut importe les moyens, les institutions du mariage et de la famille ; aidée en cela par certains lobby féministes, comme les femen, mais pas seulement. « La détresse de l’un ne se soigne pas par l’exploitation de la détresse de l’autre. Elle n’est jamais une justification… Depuis quand notre pays admettrait-il que la liberté aille au-delà de ce qui ne nuit pas à autrui ? Depuis quand privilégierions une souffrance par rapport à une autre ? Depuis quand le corps humain devrait-il être assimilé à un médicament ? Depuis quand se soignerait-on aux dépens d’une autre personne. »
« La détresse de l’un ne se soigne pas par l’exploitation de la détresse de l’autre. Elle n’est jamais une justification… Depuis quand notre pays admettrait-il que la liberté aille au-delà de ce qui ne nuit pas à autrui ? Depuis quand privilégierions une souffrance par rapport à une autre ? Depuis quand le corps humain devrait-il être assimilé à un médicament ? Depuis quand se soignerait-on aux dépens d’une autre personne. »