Chère amie,
J’ai vraiment eu du mal à trouver du temps pour répondre sur le fond au mail que tu m’as envoyé en avril. J’essaie de le faire maintenant.
Je reviens sur le mail d’avril et sur le débat autour du mariage homo, ses présupposés, ses conséquences. Même si la loi a été votée, promulguée, son contexte et l’action gouvernementale qui s’ensuit restent pour moi problématiques et toujours d’actualité.
Le premier point sur lequel je suis amené à réagir, c’est celui de la question de la dignité des couples homosexuels qui amène les promoteurs de la loi, comme par incantation et de façon quasi obsessionnelle, à soupçonner l’homophobie chez quiconque viendrait discuter les intentions et/ou l’action du gouvernement sur ce sujet et sur ce qui gravite autour. La chasse à l’homophobie est une priorité gouvernementale, on le sait ; et ton mail d’avril n’échappe pas, à mon avis, au procès d’intention. Bien sûr, les choses furent écrites sous le coup de l’émotion et aussi sûrement d’une certaine colère ; mais le mot « homophobie » y revient plusieurs fois comme un anathème pour fustiger une position indéfendable voire immonde sur le sujet.
Je soutiens pour ma part que l’on peut envisager de discuter de l’homosexualité comme n’étant pas foncièrement égale à l’hétérosexualité sans pour cela n’avoir aucune intention de nuire aux personnes homosexuelles et en les respectant complètement dans ce qu’elles sont et dans ce qu’elles vivent. Par conséquent, je conteste (et je vais expliquer pourquoi) l’expression (posée aujourd’hui comme un dogme qu’il est interdit d’effleurer) d’égale dignité des couples (on trouve cette expression, par exemple, dans le numéro de Témoignage chrétien du 14 décembre 2012, dans l’article que tu m’as transmis- « Mariage pour tous, un progrès »- et que tu as distribué à la sortie de l’église). L’article, après avoir rappelé que « l’homosexualité a été persécutée ou opprimée depuis de longs siècles », dit que celle-ci est « une orientation sexuelle aussi légitime et digne que l’hétérosexualité ».
Je vais paraître chicaner, mais la notion de dignité ici utilisée me paraît impropre dans son usage. Il est vrai que ce terme est polysémique et qu’on l’emploie aujourd’hui à toutes les sauces. On parle de vie « digne d’être vécue », on veut pouvoir mourir « dignement », on va parler de la dignité d’un revenu. Le sens n’est pas le même quand on parle de la dignité de la personne. Dans les premiers exemples cités, la dignité désigne les conditions matérielles d’existence ; dans le sens second (qui est volontiers celui que philosophiquement j’embrasse), il ne s’agit plus de conditions relatives, mais de la valeur inconditionnelle, absolue et incomparable de la personne. Ce sens est celui défini par Kant dans les Fondements de la métaphysique des mœurs ; et il est sensiblement différent de celui, emprunté à la philosophie utilitariste anglo-saxonne qui définit l’idée de dignité à partir de l’utilité ou de l’utilisation que l’on peut faire d’une chose ou avoir avec quelqu’un[1].
Parler de la dignité des personnes homosexuelles, cela, comme pour quiconque, ne se discute pas. Parler d’égale dignité des couples, c’est jouer sur une ambivalence. Un couple est par essence relatif, puisqu’il est relationnel (Kant parle du caractère relatif de nos inclinations ou de nos sentiments). Ce n’est jamais une réalité absolue. Le terme de dignité ici employé n’est pourtant pas anodin, car il n’est pas complètement indépendant de la conception kantienne ci-dessus rappelée. Autrement dit, insidieusement, tout en parlant d’une situation particulière et relative (le couple homo comme le couple hétéro), on infère l’idée qu’il y aurait là quelque chose d’absolu, d’intouchable, comme relevant du sacré. Ainsi, discuter cela serait porter atteinte au dogme de l’intouchabilité de la réalité des sentiments personnels, porter atteinte à la dignité de la personne et blasphémer contre l’individu et sa liberté sacro-sainte.
C’est mal comprendre la réalité du couple qui n’est jamais un absolu mais plutôt une réalité relative par essence. Pour autant, la réalité de la relation homme-femme n’ouvre pas aux mêmes possibilités que celle de l’union homosexuelle qui, comme tu le dis (et c’est aussi la thèse de Besson dans son livre Catholiques et homosexuels, sortir de l’impasse), peut avoir sa fécondité. Ces réalités ne sont pas les mêmes et ne sont pas forcément comparables. Je conteste aussi l’idée d’égale légitimité. Qu’est-ce à dire ?
Si être en couple, c’est éprouver des sentiments, des pulsions, des désirs, et de là, entrer en relation de réciprocité, j’en conclurai que tout sentiment est légitime, et que toute relation a sa valeur intrinsèque et incontestable. Cependant, toutes les relations n’ont pas forcément la même portée. Sans considérer que le couple homme/femme serait spontanément bon, saint, la particularité de cette relation se distingue de toute autre forme de relation à mon avis. De l’homme et de la femme peut jaillir l’excès (au sens étymologique d’ex-cedere) : il y a quelque chose qui « marche avant » eux et qui « marche après » eux, qui les pré-cède et qui peut leur suc-cèder. C’est de la fécondité biologique que je parle ici. Sans l’absolutiser, celle-ci n’est pourtant pas un fait anecdotique. Je sais que la fécondité peut être symbolique et plurielle ; la génération n’est cependant pas un fait accidentel de la relation. Ce quelque chose qui nous excède, c’est la vie dont nous ne sommes pas maître (et je ne mets pas encore Dieu là-dedans ; je le laisse tranquille !). Si « nature » qui vient du latin natus, signifie « naître », la naissance humaine ne se fait pas en dehors de ce fait profondément naturel et culturel à la fois qui est d’être le résultat du jaillissement de cette altérité première, sexuée (séparée, étymologiquement) qui permet une naissance naturelle première ainsi qu’une naissance seconde puisque l’on perçoit intuitivement qu’idéalement, cette altérité (qui n’est pas une radicale étrangèreté de l’homme et de la femme) nous a tous individuellement structuré (ou manqué) dans la présence (ou l’absence) de nos parents.
De ce fait, il n’y a pas égalité de situations. D’un point de vue individuel, émotionnel, sentimental (dans l’attachement et la réciprocité à l’autre), on peut concéder cette égalité ; mais d’un point de vue objectif, c’est-à-dire si l’on considère la réalité (la chose) qu’est le couple homme/femme, j’y vois une spécificité inassimilable à quelque autre forme de relation.
On me dira que je fonde mon argumentation sur un fait brut de la nature, à savoir que la femme peut enfanter, ce qui serait un argument passablement « animal ». Mais je ne suis pas sans savoir qu’une femme n’est que rarement féconde (24 h par mois, pendant le processus d’ovulation). Autrement dit, elle est très souvent « stérile » au sens physique du terme. Ce n’est pas la fécondité naturelle nécessaire qui fonderait la légitimité du couple homme/femme ; c’est sa possible ouverture à plus que les deux (à savoir la vie) qui en fait une réalité inassimilable. Cela dit, encore une fois, non pas pour idéaliser, mais pour insister sur la spécificité, la différence de cette situation qu’est l’union de l’homme et de la femme. Rendre justice au réel, appeler un chat « un chat », voilà le sens profond de ce qui est juste et vrai. Dire que tout est équivalent et que tout est pareil, voilà ce qui est injuste. C’est en ce sens que je dis que le couple homo et l’union homme/femme n’ont pas la même « légitimité » (lex-legis, en latin, désigne la loi et l’idée de justice ; par mon propos, j’essaie de m’ajuster au réel).
Pour ce qui est du « mariage », le Code Civil de 1804 ne s’appuyait pas sur une réalité religieuse d’abord mais sur un fait « naturel », à savoir que l’union d’un homme et d’une femme (deux être bien imparfaits comme le dit Musset à la fin de On ne badine pas avec l’amour) peuvent donner naissance, engendrer (c’est le sens originel du mot « parent », qui vient du latin pario, « générer »). Le Code Civil ancien ne faisait qu’instituer la responsabilité des époux l’un envers l’autre et envers la potentielle progéniture vis-à-vis de laquelle ils étaient déjà juridiquement responsables. Autrement dit, ce qui était institué, c’était un lien d’ob-ligation (expression pléonastique), notamment envers les plus fragiles, à savoir, dans l’ordre, la femme et l’enfant ; pas essentiellement des sentiments privés.
Aujourd’hui, le terme de « parent » a profondément changé de sens : on parle à toutes les sauces de « parentalité », faisant sens cette fois vers la fonction qu’ont les époux et non plus vers l’altérité sexuée fondatrice qui permet la génération. Or, une fonction est parfaitement interchangeable. Comme tu le disais, un homme peut être maïeuticien, une femme chauffeur de camion. Ton fils peut avoir appris à l’école, comme tu me le disais dans un mail, que le rose était une couleur de fille (par parenthèse, les choses seraient peut-être différentes si son frère avait été une sœur : pour ma part, je n’ai rien forcé mais suis obligé de constater que le comportement de ma fille diffère sensiblement de celui de ses frères, même si, parmi ceux-ci, certains sont hyper sensibles ou ont même fait de la danse…) ; beaucoup de choses sont construites, mais on ne construit ni ne se construit jamais à partir de rien. En ce qui concerne le fait d’être parent, ce n’est pas seulement la fonction, ce que je « fais » qui me définit comme tel. Si c’était le cas, pourquoi être deux en effet, pourquoi un homme et une femme ; pourquoi pas une équipe éducative, etc.
J’ai bien entendu l’argument que tu as développé et qui est de dire que le droit français protège de façon exagérée le lien biologique. Sans vouloir le défendre comme un lien absolu (Dark Vador le méchant était bien le père indigne du sauveur Luc Skywalker que ce dernier aura dû finir par terrasser !), le lien naturel à l’enfant ne peut être ignoré. Affirmer, comme le fait la ministre de la Justice que la « parentalité »[2] devient un fait social, culturel et choisi, c’est tomber à mon avis dans un excès.
Avant, dans le mariage, ce qui était juridiquement fondateur, ce n’était pas l’état ou l’intensité du sentiment amoureux ; c’était la possibilité d’être parent. Cela concerne la société qui a son mot à dire en ce qui concerne la perpétuation de ce qu’elle est (sans ingérence non plus, mais en terme de protection de la famille). Avec la loi nouvelle, ce qui est fondateur, c’est l’ordre du sentiment et la reconnaissance de toute forme d’inclination amoureuse. Pour le coup, l’État devient très intrusif et outrepasse son rôle qui est d’envisager le citoyen dans sa généralité et l’homme et la femme dans leur union particulière. S’intéresser à la singularité de la situation sentimentale, c’est donner à la loi un grand pouvoir. Vouloir changer les mentalités sur ce point peut légitimement laisser craindre une volonté d’emprise totale quoique douce et humaine en apparence et dans ses intentions. Du point de vue des citoyens enfin, c’est penser que le droit doit nous rejoindre jusque dans la singularité de nos désirs. Cela peut ouvrir la porte à une pluralité de revendications délirantes pour satisfaire la démesure de nos désirs qui, par définition, sont sans limite. [3]
Je ne veux pas faire injure aux personnes homosexuelles ; je tiens seulement à redire la spécificité de la famille et de son fondement (l’altérité sexuée, un père, une mère). Les modèles familiaux sont multiples, d’un point de vue ethnique, culturel, existentiel, je ne suis pas sans le savoir. Toute famille humaine est bien imparfaite. Il n’empêche que, même si on a été élevé par ses grands-mères ou toute autre situation, nous n’avons qu’un père et qu’une mère ; et c’est bien sur ce fait naturel que l’on peut souhaiter que se construise une existence, y compris dans la recherche d’un père et/ou d’une mère symboliques.
Les homosexuels ne pourraient-ils pas jouer pleinement ou symboliquement ce rôle de parents ?
Je crois que l’on peut avoir été élevé par deux pères et être équilibré ; mais je crois aussi que dans cette situation quelque chose (ou plutôt quelqu’un) aura manqué ; de même que, sans faire offense aux enfants de divorcés, on peut dire que cette situation, en général, laissé des blessures plus ou moins profondes. Il n’y a pas de papa et de maman idéale ; on peut reconnaître et même donner une reconnaissance juridique à des situations familiales plurielles ; mais uniformiser le réel sur la base de la conception des adultes qui veulent que tout revienne au même, je dis que c’est un déni de réalité. Idéalement, sans être idéalisant, un enfant a besoin de son père et de sa mère vivant leur relation si possible dans la paix et dans la stabilité.
Être parent ne se réduit pas au seul fait de remplir une fonction, de changer les couches ou de sortir les poubelles (pas plus qu’il ne se réduit au seul fait d’être géniteur). Il y a une altérité fondatrice qui échappe aux époux eux-mêmes parce qu’elle relève du mystère. Le mystérieux n’est pas l’occulte ; il est ce qui ne cesse de m’étonner et ce que je n’en finirai jamais de comprendre. Tout être est pour quiconque un mystère, je l’accorde ; et je suis moi-même pour moi-même un mystère. Mais l’altérité homme/femme dans la relation ne relève pas que de la différence génitale ; elle relève aussi de l’altérité ontologique. Je ne veux pas essentialiser, absolutiser ou réduire la femme dans un rôle (comme Beauvoir le signifiait dans leDeuxième sexe) ; pas plus, pas moins pour l’homme. Mais cette distinction sexuée, naturelle a des incidences psychologiques, émotionnelles, intellectuelles, spirituelles évidentes si bien que dans mon être au monde, être homme ou être femme n’est jamais indifférent. Je ne dis pas que l’homosexuel nie la différence (l’homosexualité masculine n’est pas le lesbianisme) ; mais j’affirme la polarisation essentielle (et non accidentelle) du féminin et du masculin dans la définition de notre identité, ce qui forcément a une incidence dans la nature de nos relations.
Dans Éthique et Infini, Lévinas pensait la relation homme/femme de la façon suivante : ce qui en l’autre sexe se cherche (entre le masculin et le féminin), ce n’est pas « un autre attribut en l’autre », mais un « attribut d’altérité ». Soyons précis : l’être humain est un être de désir. En ce sens, nos relations humaines sont par essence des relations d’êtres de désir à d’autres êtres de désir. On peut dire que, selon Lévinas, toute relation inter-humaine est une érotique (qui me convoque dans ma responsabilité et m’amène à discerner envers quiconque ce que je peux donner ou recevoir). Cela dit, dans la pluralité de nos relations, il y a une spécificité de l’opposition du féminin et du masculin ; une polarisation. La polarité n’est pas un positionnement absolu (il y a toujours plus au nord ou plus au sud que moi). Mais il n’y a de nord que par rapport à un sud. Cette opposition polarisée, que je le veuille ou non, me fonde physiquement mais aussi métaphysiquement. John Gray l’Américain a très bien signifié cela, sur la base de sa très riche expérience de thérapeute de couples. Cette différence entre les hommes et les femmes est relatée dans son livre Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Venus. Mme Codalen, psychanalyste, répond dans son ouvrage Toi mars, moi Venus, ou le contraire que le propos de Gray est inepte et que nous sommes universellement des êtres de désir ; voilà ce qui indistinctement nous constitue. Pourtant, même si le propos de Gray peut friser la caricature ou paraître schématique ; même si aucune relation ne se fait sur la base d’une technique de communication, l’intuition et l’exposé de l’auteur américain n’est pas hors de sens. La féminité et la masculinité ne se réduisent pas à la génitalité et ont une incidence décisive dans mon rapport au réel, dans mon être-au-monde.
Qu’en est-il de cette universalité de l’être humain ? L’égalité de condition est une chose indiscutable. Elle est un acquis de la pensée moderne et contemporaine. Cependant, elle n’est pas sans risque si on la comprend comme égalité des conditions (au pluriel). C’est Hannah Arendt qui, dans son texte Les Origines du totalitarisme au tome I (Sur l’antisémitisme), explique que « l’égalité des conditions,[est] à coup sûr un impératif fondamental de justice, [et] aussi l’une des plus grandes et des plus hasardeuses entreprises de l’humanité moderne » (ch.3 p.103-104 édition Points). Elle explique en effet que « l’égalité exige que je reconnaisse tout individu, quel qu’il soit comme mon égal », si bien que des « conflits entre des groupes différents qui (…) refusent de se reconnaître réciproquement cette égalité de base » ont revêtu « des formes si effroyables ». Ce qu’elle veut dire, c’est que le XXéme siècle a connu de grandes entreprises de nivellement. Cela est un effet pervers d’une notion — noble initialement — qui est celle d’égalité. L’égalité universelle ne peut ni ne doit être une négation des particularismes (Hegel avait déjà signifié cela à la remarque du §209 des Principes de la Philosophie du Droit). L’égalité de droit n’est pas l’égalité de fait ; cette dernière étant impossible à obtenir vu que, d’un point de vue concret, les différences sont inassimilables. L’uniformisation est un danger. Quoique politiquement la revendication de l’égalité des conditions puisse se justifier, elle est, dans les faits, inaccessible. L’égale dignité des personnes n’est pas l’égalité des situations. Cette fiévreuse revendication d’égalité, Tocqueville l’a parfaitement décrite (Arendt s’inspire beaucoup de Tocqueville) dans son ouvrage La démocratie en Amérique[4] ; le XXéme siècle a réalisé dans son caractère le plus abject ce que pouvait être une société uniforme.
Si je m’en vais sur ce terrain, c’est que l’idée d’un « mariage pour tous », ponctuellement s’appuie sur un tel présupposé d’égalité uniformisante. Le paradigme sur lequel s’appuie l’idée d’un « mariage pour tous » est celui d’une parfaite interchangeabilité des conjoints, sans que la différenciation sexuée ne doive intervenir. Autrement dit, ce qui fonde la nouvelle définition du mariage, ce n’est plus le fait objectif et réel de la possible parenté (entendu au sens de la possibilité de générer puis d’éduquer l’enfant) ; c’est la reconnaissance et la consécration du fait subjectif (même s’il est relationnel, puisque l’on parle bien aussi de couple et de relation) qu’est le sentiment des individus. Même s’il y a réciprocité sentimentale, c’est l’ordre subjectif qui ici fait autorité ; non plus la possibilité objective et excessive de recevoir la vie dans la présence de l’enfant. C’est la famille et l’enfant que l’État et la société précédemment protégeait dans l’institution du mariage (c’est aussi cette conception que l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 défend) ; aujourd’hui, c’est l’inclination d’individus adultes, certes liés dans la réciprocité, que l’État consacre. En effet, comme le disait la Garde des Sceaux, nous changeons de civilisation, nous changeons de référent, de paradigme. À dire vrai, le changement n’est pas d’aujourd’hui, il est profondément ancré dans la mentalité moderne (j’entends depuis la pensée du XVIIéme siècle) ; la loi actuelle ne fait que rendre effectif, sur ce point, une revendication (qui n’est pas prêt de s’arrêter) qui est de consacrer (jusqu’à la calcination : Giacometti exprime cela très bien dans ses sculptures) les désirs de l’individu.
Je ne fustige pas le désir homosexuel. J’insiste en disant que la réalité de sa situation n’est pas la même que celle de l’union d’un homme et d’une femme. C’est cela que le droit continuait de distinguer en reconnaissant la spécificité du mariage à l’union de l’homme et de la femme qui seuls peuvent être parents au sens plénier (naturel et culturel) du terme. Qu’un couple homosexuel se retrouve secondairement en situation d’autorité parentale (puisqu’il aura bien fallu un homme ou une femme pour générer l’enfant), cela ne me gêne pas ; que la loi en prenne acte ad hoc, pourquoi pas. Mais que de façon programmatique la loi dise que le couple homme/femme est comme un couple homosexuel, il y a là une posture idéaliste qui semble porter en elle la haine de la distinction pour imposer l’uniformisation.
Pour ce qui est de l’adoption, elle s’appuyait jusqu’ici sur la parenté naturelle et première (la présence de parents sexuellement différenciés, même si des dérogations étaient accordées à des célibataires). Cela veut dire que la parenté symbolique prend tout son sens à partir d’une parenté première et naturelle. Mais aujourd’hui, on ne voit plus pourquoi des individus devraient être privés de la possibilité et du bonheur d’avoir des enfants. Le fait naturel est complètement évacué au profit de l’affirmation de la liberté et de l’égalité des individus.
Le risque d’uniformisation est bien réel. Le « djènnedeure », comme tu dis, y est aussi pour quelque chose. Tu dis que l’appellation d’ « idéologie » est une stigmatisation vaticane, presqu’ignorante du phénomène dans sa complexité[5]. Je prends acte du fait que les « études de genre » sont une nébuleuse complexe qui ouvre à une pluridisciplinarité difficile à étiqueter derrière une conception uniforme. Il n’empêche qu’il y a là ce qu’on peut appeler un paradigme (comme le dirait Kuhn dans la Structure des révolutions scientifiques), c’est-à-dire un cadre de recherche ; et qu’aucun cadre de recherche, à ma connaissance, ne jouit d’une incontestabilité absolue. Que l’on conteste a priori la possibilité d’exister d’un cadre de recherche sans plus approfondir les choses, je comprends que cela puisse irriter ; mais que ce cadre soit discuté voire contesté dans ses présupposés ou dans ses conséquences, quoi de plus légitime intellectuellement ?
Quand le Vatican met en garde, sur les questions d’identité sexuelle, sur le fait que l’on ait une compréhension exclusivement culturelle, sociale, constructiviste de la sexualité, qu’est-ce qui gêne ? Ce n’est pas parce que c’est le Vatican qu’il n’a pas le droit de réfléchir et de le faire sur des bases anthropologiques ou philosophiques qui ne sont pas forcément celles de la pensée contemporaine constructiviste et relativiste. Quand Favier présente Anatrella (prêtre psychanalyste hostile au gender et à ses conséquences radicales) comme une posture académiquement isolée, est-ce un argument définitif et disqualifiant ?
Les positions radicales sont toujours gênantes du fait de la fermeture au dialogue qu’elles impliquent ; mais l’ouverture à la discussion n’implique pas qu’il faille comme un mouton tout accepter pour se faire tondre. En ce qui concerne le « djèndeure », on n’en est plus au stade de la simple réflexion ou de l’investigation universitaire. L’actualité pullule d’exemples où la pensée uniformisante s’impose jusqu’au sein des écoles où des familles doivent parfois faire face à des amendes ou à des peines de prison (c’est le cas en Allemagne[6], en Espagne,etc.). En France, on en est seulement au stade de la répression de manifestations pacifistes (je pense au mouvement des Veilleurs et au délit de pensée malfamée).
Je n’ai pas besoin du Vatican pour élaborer une pensée personnelle, même si ses documents me paraissent fort intéressants et plus sage que ce que la presse ou la pensée ambiante veut bien en dire[7]. Que les « études de genre » soit un cadre de recherche, très bien ; mais que cela devienne un principe d’action politique systématique et indiscuté (c’est ce que nous voyons se réaliser depuis plusieurs mois), cela nous inquiète. Nous sommes bien dans la dérive idéologique. Karl Marx est un grand penseur qu’en tant que philosophe, économiste, sociologue, etc. je respecte. Il n’empêche que la base de sa pensée (le matérialisme dialectique) a historiquement donné lieu à des dérives idéologiques. Le Darwinisme a toute sa légitimité scientifique (même s’il n’est pas scientifiquement et rationnellement incontestable). Le darwinisme social et le scientisme ont pourtant légitimé scientifiquement l’horreur nazie. Que des sociologues, des historiens, des biologistes, des médecins des philosophes discutent de la construction de l’identité sexuelle, très intéressant. Par contre, que l’on veuille venir bourrer le crâne de mes gosses dès la grande section de maternelle sur le fait qu’il peut choisir sa masculinité ou sa féminité, dans l’indifférence, je n’ai pas tellement envie de laisser faire ; non par homophobie, mais refus de transformer une hypothèse scientifique — discutable — en dogme sacro-saint de l’individu condamné à être libre, comme dirait Sartre, pour se choisir dans l’Absolu et l’absence de toute détermination initiale. Toute philosophie, si noble soit-elle, n’a jamais valeur de dogme. C’est vrai pour un adulte et pour un élève de 18 ans ; ça l’est a fortiori pour un enfant de 6 ans[8] dont l’éducation incombe en priorité aux parents, ce que semble contester aujourd’hui le gouvernement, pas seulement français.
Pour finir sur ce volet et pour appuyer scientifiquement mon argument, j’appelle « idéologie » une théorie, logiquement satisfaisante, voire plus rassurante que le réel, (le réel étant toujours trop complexe, imprévisible comme dirait Bergson) et qui finit par nous couper de la réalité. Ce n’est pas sur l’autorité du Vatican que j’appuie mon propos mais sur la réflexion de Hannah Arendt[9]. Que l’identité sexuelle soit un fait essentiellement culturel dans la construction de soi, je ne l’ai, pour ma part, jamais nié ; à condition que l’on considère (c’est ce que j’avais écrit dans mon premier mail en citant Merleau-Ponty) que le culturel en l’homme n’a de sens que sur la base de la nature qu’il transforme[10]. Autrement dit, en l’homme, la nature sans la culture est une hérésie philosophique (je veux bien contester les partisans du « tout naturel » ou du « tout biologique ») ; la culture sans la nature en est une autre. L’exaltation du « je choisis tout » et d’une liberté absolue pensée comme construite exclusivement à partir de soi, c’est joli comme idée, mais d’un point de vue éducatif, cela peut s’avérer catastrophique. Là aussi, je contesterai la thèse.
Le plus étonnant dans cette affaire, c’est que le paradigme constructiviste (via la pensée de Foucault par exemple) qui semble déconstruire et délégitimer toute idée de nature pour renvoyer à la seule idée de choix absolument libre ouvre la porte insidieusement à une nouvelle compréhension de l’idée de nature[11]. Je m’explique : puisque rien ne prédétermine mes actions, mes orientations, mes choix, je suis absolument libre, si bien que, en matière de sexualité, je dois être à l’écoute de moi-même dans le sens d’une totale liberté. Aucune tendance, aucune tension n’est alors anodine ; elle exprime une pulsion qui en soi a toute sa légitimité. Par conséquent, la répression des pulsions devient un fait culturel illégitime. Culturellement n’aura de sens que le fait de cultiver ce que je ressens et d’exalter toute forme de plaisir. L’idée de nature est là aussi bien présente. Ce qui maintenant la fonde, c’est la légitime satisfaction de mes désirs (si bien que mon genre peut au cours de ma vie évoluer). Ne pas écouter ses tendances, ce serait les refouler de façon non légitime. Ce qu’on constate, c’est que le concept de nature ne disparaît pas (chassez le concept de nature, pourrait-on dire, et il revient au galop !) ; il change de sens (ainsi que le concept de culture qui doit cultiver la liberté sans frein et bannir toute morale ou culture archaïsante). Avec le nouveau concept de nature (cautionnant la liberté absolue où je dois être à l’écoute de mes tendances), il est possible que je sois au final dans la plus grande dépendance (mes tendances naturelles qui impérieusement devraient être satisfaites). Autrement dit, l’idée d’un « je me choisis comme je veux » peut devenir véritablement tyrannique[12] . Si de plus cela prend une tournure politique et collective, on est en droit de discuter voire de ne pas se laisser imposer des lois d’un genre nouveau qui voudraient régenter jusqu’à l’intime…
Je ne suis pas dans le délire, le point de Godwin ou la théorie du complot. Cela fait plusieurs mois, disais-je plus haut, que nous sommes dans l’effectif et la concrétisation des idées. Quand on voit que les écoles de formation des enseignants (il faudrait dire de formatage), des enseignants d’enseignants se foutent à poil pour apprendre la déconstruction des stéréotypes ou des interdits culturels, je m’inquiète sur ce que l’on cultive. À vrai dire, je ne sais s’il faut en rire ou en pleurer ; et je me demande de quel côté on dis-joncte, au sens propre du terme, c’est-à-dire de quel côté on se coupe du réel… [13]
Lorsque je parle de programme d’État, je ne puis ne pas évoquer l’attitude (qui n’a rien perdu de ce que Machiavel enseigne) de notre cher Ministre de l’Intérieur. L’action et l’actualité des Veilleurs est soigneusement tue (ajoute un accent aigu sur ce dernier mot, en l’accordant, et le terme est encore signifiant). Cela est vrai de l’attitude médiatico-politique depuis le début sur la considération des faits par le pouvoir qui, à mes yeux, est loin de s’honorer. Sortir des hordes de CRS face à des manifestants pacifiques que l’on fait passer pour des extrémistes, quel courage politique ! Tu parlais dans un précédent mail de la puissance de certaines familles, entité qu’il serait peut-être vain de défendre, au profit de causes autres ou plus nobles. Laisse-moi t’exprimer mon désaccord sur ce point, du fait de son anachronisme. L’ère contemporaine se situe du côté de l’exaltation de l’individu, pas du tout du côté de la défense de la famille depuis longtemps affaiblie. Ces dernières sont (comme toute situation familiale) à mon avis fragiles, bâties sur un équilibre non évident à préserver. Aujourd’hui, c’est plutôt du côté des individus qu’il faut rechercher les puissants[14]. Les familles influentes, cela valait peut-être du temps de l’aristocratie. S’il peut en exister encore aujourd’hui, ce n’est pas le cas de la famille moyenne (traditionnelle, ou plurielle, c’est-à-dire monoparentale, recomposée, etc.). J’en veux pour preuve le fait que, si les manifestations de la Manif pour Tous n’avaient pas été celle de familles classiques, de vieux, de célibataires pacifiques, d’homosexuels même,[15] etc. elle n’aurait pas eu le traitement qu’elle a eu. Quand on voit que quelques centaines de chauffeurs de taxi font plier le gouvernement dans ses décisions ou que quelques centaines de manifestants d’Électrolux (à raison) l’inquiètent, ça montre vraiment que les gens de LMPT dans l’immense majorité étaient plus proche de pacifistes que des activistes d’extrême droite. Sauf mon respect pour sa fonction, un Président fort avec les faibles et faible avec les forts, voilà ce que nous avons.
Pour ma part, c’est aujourd’hui du côté des Veilleurs que je me situe, sans haine, sans rejet de quiconque ni de personne, mais sans rougir non plus de ce que je pense et crois. Si cela me vaut de figurer sur un quelconque « mur des cons » ou « mur des homophobes », alors la liberté en moi saignera mais continuera de façon irrépressible de vouloir s’exprimer contre toute forme de pensée unique qui prend déjà des tournures tyranniques.
Je ne veux pas être moi-même despotique envers quiconque et accepte la pensée autre, même si je suis prêt à me battre par les arguments contre la diffamation. Je crois, pour finir, que Tocqueville a profondément été visionnaire lorsque, à la moitié du XIXème siècle, il décrivit la nature des mœurs contemporaines démocratiques. Sans aucune haine de la démocratie (il le dit dans son introduction et à plusieurs reprises dans son ouvrage), il est important d’en voir les possibles dérives. Celles-ci sont de l’ordre du nivellement, de l’uniformisation vers la médiocrité; et cela s’exerce dans l’impératif d’une pensée uniforme où la différence n’ose plus s’exprimer. La tyrannie des âmes est alors plus dangereuse (même si le propos peut paraître décalé) que n’importe quelle forme de torture physique. C’est ce qu’il appelle la « tyrannie douce ». Je crois que c’est ce qu’aujourd’hui nous vivons.[16]
Je m’excuse d’avoir été aussi long. Je t’assure sincèrement que je n’ai pas voulu m’épancher. J’ai seulement voulu suivre le fil logique d’une pensée, la mienne, sans pour autant m’enfermer (autant que j’ai pu, je suis allé lire des choses sur la question, y compris dans le « camp adverse » ; c’est pourquoi j’ai répondu aussi longtemps après ton mail d’avril).
Je n’ai aucune rancœur, aucune amertume dans mon propos. J’espère ne pas avoir laissé transparaître cela. J’ai réagi fortement car le fait de m’être senti (et de nous être sentis) comme rejetés par des amis du fait de ce que l’on pouvait penser ou croire m’a (et nous a) heurté. Je sais que cela est de part et d’autre involontaire. J’ai longtemps écrit et pesé mes mots, pas tant pour convaincre, mais pour de la façon la plus honnête qui soit, défendre une posture qui, selon moi et quoi qu’on en dise, a toute sa légitimité.
C’est ce que j’ai essayé de démontrer ; je ne sais si j’y suis parvenu. Pardon si j’ai pu être blessant. Même dans la polémique, là n’est pas mon intention.
En toute amitié
Un Veilleur des Ardennes
[1] Pour l’utilitarisme, je me réfère aux pensées de Bentham puis de John Stuart Mill. La définition kantienne de la dignité, qui me paraît plus juste puisqu’elle se réfère à la valeur absolue de la personne, est par exemple exprimée de la façon suivante dans les Fondements de la métaphysique des mœurs, 2° partie: « Dans le règne des fins [pour l’homme] tout a un prix ou une dignité. Ce qui a un prix peut être aussi bien remplacé par quelque chose d’autre, à titre d’équivalent ; au contraire, ce qui est supérieur à tout prix, ce qui par suite n’admet pas d’équivalent, c’est ce qui a une dignité. Ce qui rapporte aux inclinations et aux besoins généraux de l’homme, cela a un prix marchand ; ce qui, même sans supposer de besoin, correspond à un certain goût, c’est-à-dire à la satisfaction que nous procure un simple jeu sans but de nos facultés mentales, cela a un prix de sentiment ; mais ce qui constitue la condition, qui seule peut faire que quelque chose est une fin en soi, cela n’a pas seulement une valeur relative, c’est-à-dire un prix, mais une valeur intrinsèque, c’est-à-dire une dignité. »
[2] Pour la distinction entre « parenté » et le terme récent de « parentalité », je m’appuie sur les analyses de Thibaut Colin, dans son livre Les lendemains du mariage gay, édition Salvator, collection Carte blanche, juillet 2012.
[3] Sans faire d’amalgame, on voit la revendication des droits fleurir. C’est ainsi qu’aux Etats-Unis (comme à d’autres endroits), des pédophiles ont situé leur inclination et leur pratique au même rang de légitimité que toute autre inclination sexuelle. Ils demandent la reconnaissance de leurs droits : direct.cd/2013/04/29/etats-unis-les-pedophiles-reclament-les-memes-droits-les-homosexuels.html. Cela a été repris aussi par mediapart.
[4] cf le début de l’introduction de La démocratie en Amérique ; cf aussi le tome I, 1°partie, chapitre 3 p.115-116 en GF.
[5] Je suis allé voir le blog http://penser-le-genre-catholique.over-blog.com/ ainsi que l’article d’Anthony Favier que tu m’avais indiqué sur la réception des « études de genre » par l’Eglise catholique, dans le contexte francophone :
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/76/57/86/PDF/RA_ception_catholique_du_genre.pdf
[6] Va voir l’article suivant ; (on croit rêver, ou plutôt, pour ma part, cauchemarder…)http://www.contrepoints.org/2013/09/03/137364-assaut-policier-chez-famille-scolarisant-ses-enfants-domicile-les-enfants-enleves-force
[7] J’ai bien aimé la référence qu’Anthony Favier fait aux propos du Magistère aux pages 13 et 14 de l’article cité en note plus haut. Voici les propos de Josef Ratzinger que Favreau cite. Ceux-ci sont extraits de laLettre aux Evêques de l’Eglise catholique sur la collaboration de l’homme et de la femme dans l’Eglise et dans le monde du 31 mai 2004 (Paris, Salvator, p.13) : « Pour éviter toute suprématie de l’un ou l’autre sexe, on tend à gommer leurs différences, considérées comme de simples effets d’un conditionnement historique et culturel. Dans ce nivelage, la différence corporelle, appelée sexe, est minimisée, tandis que la dimension purement culturelle, appelée genre, est soulignée au maximum et considérée comme primordiale. L’occultation de la différence ou de la dualité des sexes a des conséquences énormes à divers niveaux. Une telle anthropologie qui entendait favoriser des visées égalitaires pour la femme en la libérant de tout déterminisme biologique, a inspiré en réalité des idéologies qui promeuvent par exemple la mise en question de la famille, de par nature biparentale, c’est-à-dire composée d’un père et d’une mère, ainsi que la mise sur le même plan de l’homosexualité et de l’hétérosexualité, un modèle nouveau de sexualité polymorphe. »
[8] J’ai vu dans les grandes ligne le document du syndicat SNUIPP-FSU sur l’éducation à l’égalité et la lutte contre l’homophobie : en terme d’endoctrinement implicite, ça fait froid dans le dos. Les intentions sont excellentes ; les applicatiions pratiques sont effrayantes dans ce qu’elles peuvent imposer en terme de vision du réel excluant toute alternative éducative. En 1789, l’exigence de liberté avait déjà conduit à la Terreur. Peillon qui a écrit La Révolution française n’est pas terminé semble sur la même voie. Contrairement à ce que tu écrivais dans un mail, je pense que sa posture, au sein du gouvernement, est loin d’être isolée (cf www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/pag_lgbt_-_bilan_intermediaire.pdf).
[9] Aller voir pour cela les pages 294 à 299, au chapitre 4 du tome III - « Le Système totalitaire »- des Origines du totalitarisme (édition Points-Essai). une « idéologie » n’est pas n’importe quelle idée, théorie ou philosophie. Il s’agit d’une conception qui prend ses distances avec le réel et qui cherche à le supplanter. L’« idéologie » relève de la « logique d’une idée » qui propose une vision mensongère plus satisfaisante parce que plus simple, plus schématique et, au final, moins déroutante que le réel et son caractère foisonnant, déstabilisant.
[10] La référence à Merleau-Ponty était la suivante : Phénoménologie de la perception, livre I, chapitre 6, pp.220-221). En l’homme, rien n’est naturel et tout est culturel, à condition que l’on ne pense pas le culturel indépendamment de sa base naturelle et biologique : « Il n’est pas plus naturel ou pas moins conventionnel de crier dans la colère ou d’embrasser dans l’amour que d’appeler table une table. Les sentiments et les conduites passionnelles sont inventés comme les mots. Même ceux qui comme la paternité, paraissent inscrits dans le corps humain sont en réalité des institutions. Il est impossible de superposer en l’homme une première couche de comportements que l’on appellerait « naturels » et un monde culturel ou spirituel fabriqué. Tout est fabriqué et tout est naturel chez l’homme, comme on voudra dire, en ce sens qu’il n’est pas un mot, pas une conduite qui ne doive quelque chose à l’être simplement biologique – et en même temps ne se dérobe à la simplicité de la vie animale… »:
[11] Pour ma part, je préfère philosophiquement me référer à l’idée aristotélitienne de « nature ». D’aucun diront que le paradigme aristotélitien est désuet et archaïsant pour penser l’homme. Pourtant, Penser que la philosophie constructiviste et relativiste contemporaine soit la seule qui vaille (avec cette croyance présupposée dans le progrès des sciences), c’est mal comprendre le sens de ce que philosopher veut dire. La philosophie aristotélitienne est une philosophie « finaliste », ce qui veut dire que son paradigme pour comprendre le réel intègre l’idée de « cause finale », concept contesté par la philosophie moderne (notamment par Spinoza dans l’appendice du livre I de l’Ethique). Cela dit, rien n’indique a priori que, pour comprendre la nature humaine, une philosophie soit obsolète. La façon qu’Aristote a de comprendre l’éthique et le politique est loin d’être insensée. Anthropologiquement, il n’est pas forcément inepte de voir une finalité inhérente et excédant l’homme et la femme dans leur relation. On peut penser un déterminisme sans que cela implique une prédétermination de nos vies : la liberté reste sauve !
[12] Jean Claude Guillebeaud développe cela dans son livre La Tyrannie du plaisir où il analyse très clairement l’injonction de jouissance dans laquelle culturellement aujourd’hui nous baignons tous.
[13] Va voir le lien (« Queer days Rachele Borghi) relatif au cours de Rachele Borghi de l’université Paris IV Sorbonne. Elle serait professeure de géographie, militante du genre et spécialiste du post-porn, formatrice des futurs professeurs d’Histoire Géographie. On croirait un canular étudiant. Elle se fout à poil en faisant son « cours ». Tout est possible !...
[14] L’influence et l’action par exemple, de quelqu’un comme Pierre Berger sur les médias et sur le politique le montrent.
[15] Il n’y a pas que Philippe Ariño qui se soit exprimé sur la question. On le taxe d’homophobie ; je veux bien que l’on puisse ne pas s’aimer soi-même, mais on peut peut-être écouter tous ceux qui sont concernés par rapport à une question et ne pas forcément s’arrêter à un propos monolithique. Le mal être de l’homosexuel peut être dû à la société qui a sa part de responsabilité et c’est bien dommage ; mais il y a aussi des questions existentielles ou personnelles à écouter et à entendre. Le site homovox.com a pu exprimer cela ; d’autres personnes, homosexuelles, se sont aussi exprimées dans le sens de la non-conformité à la bien pensance ambiante (cf par exemple le témoignage d’Yves Colin, maire et homosexuel, qui s’est publiquement opposé au projet de loi et à l’idée de l’appréhension uniforme des situations affectives : http://www.yvescolin.fr/article-un-maire-homosexuel-contre-le-mariage-gay.html).
[16] Voici comment Tocqueville perçoit la différence entre les tyrannie anciennes et la nouvelle forme de tyrannie émergente qui caractérise notre époque (in De la démocratie en Amérique, tome I, II°partie, chapitre 7). Je ne puis m’empêcher de le citer longuement : « La pensée est un pouvoir invisible et presque insaisissable qui se joue de toutes les tyrannies. De nos jours, les souverains les plus absolus de l’Europe ne sauraient empêcher certaines pensées hostiles à leur autorité de circuler sourdement dans leurs Etats et jusqu’au sein de leurs cours. Il n’en est pas de même en Amérique : tant que la majorité est douteuse, on parle ; mais dès qu’elle est irrévocablement prononcée, chacun se tait, et amis comme ennemis semblent alors s’attacher de concert à son char. La raison en est simple : il n’y a pas de monarque si absolu qui puisse réunir dans sa main toutes les forces de la société et vaincre les résistances comme peut le faire une majorité revêtue du droit de faire les lois et de les exécuter. Un roi d’ailleurs n’a qu’une puissance matérielle qui agit sur les actions et ne saurait atteindre les volontés ; mais la majorité est revêtue d’une force tout à la fois matérielle et morale, qui agit sur la volonté autant que sur les actions, et qui empêche en même temps le fait et le désir de faire.(…)Des chaînes et des bourreaux, ce sont là des instruments grossiers qu’employait jadis la tyrannie ; mais de nos jours la civilisation a perfectionné jusqu’au despotisme lui-même, qui semblait pourtant ne plus rien avoir à apprendre.(…) Sous le gouvernement absolu d’un seul, le despotisme, pour arriver à l’âme, frappait grossièrement le corps ; et l’âme, échappant à ses coups, s’élevait glorieuse au-dessus de lui ; mais dans les républiques démocratiques, ce n’est point ainsi que procède la tyrannie ; elle laisse le corps et va droit à l’âme. Le maître n’y dit plus : vous penserez comme moi ou vous mourrez ; il dit : vous êtes libre de ne point penser ainsi que moi ; votre vie, vos biens, tout vous reste ; mais de ce jour, vous êtes un étranger parmi nous. Vous garderez vos privilèges à la cité, mais ils vous deviendront inutiles ; car si vous briguez le choix de vos concitoyens, ils ne vous l’accorderont point, et si vous ne demandez que leur estime, ils feindront encore de vous la refuser. Vous resterez parmi les hommes mais vous perdrez vos droits à l’humanité. Quand vous approcherez de vos semblables, ils vous fuiront comme un être impur et ceux qui croient en votre innocence, ceux là même vous abandonneront, car on les fuirait à leur tour. Allez en paix, je vous laisse la vie, mais je vous la laisse pire que la mort. »


 Les partisans de la « bonne mort » à élargir aux mineurs ont-ils réfléchi aux conséquences d'un tel choix qui deviendrait accessible aux 12-17 ? Le poids de responsabilité psychique, éthique – et spirituel, pour peu que l'on admette l'intervention de cette dimension dans ce débat – chargerait lourdement ces jeunes épaules en leur induisant l'idée d'un « droit » à mourir. Prétendre que ces jeunes mineurs à peine sortis de l'enfance ont soit la capacité de décider s'ils veulent continuer à vivre jusqu'au bout de leur maladie invalidante, soit d'en finir et ce, en en mesurant lucidement les conséquences, m'apparaît non seulement grave mais est également un leurre. J'y vois un risque d'amplification de la souffrance et de majoration de la tension déjà naturellement liée à l'épreuve de la maladie ou du handicap.
Les partisans de la « bonne mort » à élargir aux mineurs ont-ils réfléchi aux conséquences d'un tel choix qui deviendrait accessible aux 12-17 ? Le poids de responsabilité psychique, éthique – et spirituel, pour peu que l'on admette l'intervention de cette dimension dans ce débat – chargerait lourdement ces jeunes épaules en leur induisant l'idée d'un « droit » à mourir. Prétendre que ces jeunes mineurs à peine sortis de l'enfance ont soit la capacité de décider s'ils veulent continuer à vivre jusqu'au bout de leur maladie invalidante, soit d'en finir et ce, en en mesurant lucidement les conséquences, m'apparaît non seulement grave mais est également un leurre. J'y vois un risque d'amplification de la souffrance et de majoration de la tension déjà naturellement liée à l'épreuve de la maladie ou du handicap. Plus profondément, quelle déresponsabilisation, voir décharge, de la part des adultes ! J'y perçois un phénomène de grave démission, révélateur d'une société en perte de repères, de courage et de force face à l'épreuve ultime : celle qui confronte à la peur de la souffrance et au final à la peur de la mort. Octroyer le droit d'euthanasie aux mineurs d'âge signe une forme d'abandon psychique de l'adulte face au jeune. Il assombrit d'une mort symbolique le lien filial et social.
Plus profondément, quelle déresponsabilisation, voir décharge, de la part des adultes ! J'y perçois un phénomène de grave démission, révélateur d'une société en perte de repères, de courage et de force face à l'épreuve ultime : celle qui confronte à la peur de la souffrance et au final à la peur de la mort. Octroyer le droit d'euthanasie aux mineurs d'âge signe une forme d'abandon psychique de l'adulte face au jeune. Il assombrit d'une mort symbolique le lien filial et social.
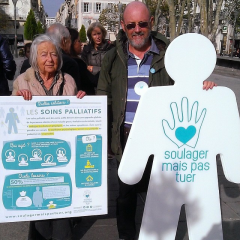 Par ailleurs, un adolescent qui se sent abandonné par les adultes à l'idée de la mort, ceci dans la force de vie qui lui reste tant qu'il est vivant, peut aussi en être profondément atteint dans son estime de soi, dans sa dignité, dans son droit et son désir de vivre. Il pourrait se sentir intimement et essentiellement blessé dans le lien qu'il espère vivre dans un attachement solide et fidèle d'amour donné et reçu, jusqu'au bout de l'épreuve.
Par ailleurs, un adolescent qui se sent abandonné par les adultes à l'idée de la mort, ceci dans la force de vie qui lui reste tant qu'il est vivant, peut aussi en être profondément atteint dans son estime de soi, dans sa dignité, dans son droit et son désir de vivre. Il pourrait se sentir intimement et essentiellement blessé dans le lien qu'il espère vivre dans un attachement solide et fidèle d'amour donné et reçu, jusqu'au bout de l'épreuve. Un jeune adolescent n'a pas encore une claire idée de ce que c'est que d'être adulte. Ses projets sont à une autre échelle que ceux que ses parents projettent éventuellement sur lui. Ceux-ci évaluent avec une conscience différente la perspective interrompue d'un potentiel de croissance qu'ils espéraient, selon leurs critères, voire évoluer vers de l'expansion plutôt que vers une extinction.
Un jeune adolescent n'a pas encore une claire idée de ce que c'est que d'être adulte. Ses projets sont à une autre échelle que ceux que ses parents projettent éventuellement sur lui. Ceux-ci évaluent avec une conscience différente la perspective interrompue d'un potentiel de croissance qu'ils espéraient, selon leurs critères, voire évoluer vers de l'expansion plutôt que vers une extinction. Dès lors il y a lieu de se poser la question dans le cas où un jeune mineur demanderait à mourir, s'il le demande pour lui ou pour ne plus peser sur l'entourage. « Cela fait trop mal à papa, à maman... j'aime mieux m'en aller ». Il y a ceux qui le diront, et ceux qui le penseront secrètement sans pouvoir le dire. Dire « vouloir mourir » veut également souvent dire « je ne veux plus ressentir cette souffrance » – morale ou physique. Les témoignages des soins palliatifs attestent de réponses autres que la mort à offrir aux personnes sombrant dans de tels épanchements, ô combien compréhensibles. Il est urgent de promouvoir une façon de vivre en société qui humanise et (re)donne une place à la souffrance et à la mort. Ceci, autrement qu'en accélérant voir qu'en forçant la fin de vie. Il n'y a par ailleurs pas à blâmer les parents qui perdent pied devant la souffrance ou l'état critique de leur enfant. La détresse, la révolte et le sentiment d'impuissance sont à entendre, à reconnaître et à panser d'un soin compétent et attentionné. Il y a lieu de chercher à intégrer la réalité de toute souffrance au cœur même d'un lien d'amitié, d'amour et de soutien. Dans sa particularité, ce lien est à tisser et à toujours recréer autour de la personne malade qui cherche avant tout à être rejointe. L'amour échangé ne meurt pas : il circule et grandit. Il n'est tenté ni de faire mourir ni de mourir.
Dès lors il y a lieu de se poser la question dans le cas où un jeune mineur demanderait à mourir, s'il le demande pour lui ou pour ne plus peser sur l'entourage. « Cela fait trop mal à papa, à maman... j'aime mieux m'en aller ». Il y a ceux qui le diront, et ceux qui le penseront secrètement sans pouvoir le dire. Dire « vouloir mourir » veut également souvent dire « je ne veux plus ressentir cette souffrance » – morale ou physique. Les témoignages des soins palliatifs attestent de réponses autres que la mort à offrir aux personnes sombrant dans de tels épanchements, ô combien compréhensibles. Il est urgent de promouvoir une façon de vivre en société qui humanise et (re)donne une place à la souffrance et à la mort. Ceci, autrement qu'en accélérant voir qu'en forçant la fin de vie. Il n'y a par ailleurs pas à blâmer les parents qui perdent pied devant la souffrance ou l'état critique de leur enfant. La détresse, la révolte et le sentiment d'impuissance sont à entendre, à reconnaître et à panser d'un soin compétent et attentionné. Il y a lieu de chercher à intégrer la réalité de toute souffrance au cœur même d'un lien d'amitié, d'amour et de soutien. Dans sa particularité, ce lien est à tisser et à toujours recréer autour de la personne malade qui cherche avant tout à être rejointe. L'amour échangé ne meurt pas : il circule et grandit. Il n'est tenté ni de faire mourir ni de mourir. Il s'agirait donc moins de chercher à tuer la souffrance en tuant la personne et avec elle le potentiel d'amour qu'il resterait à s'échanger, qu'à apprivoiser et à assumer l'inconfort de ce qui fait mal. Ceci, au cœur d'une relation nourrissante et privilégiée investie avec la personne malade. Ce qui participe à donner force de vie, c'est de se sentir rejoint, compris, tendrement aimé. C'est la qualité du lien mis en chantier dans la relation qui fait fleurir le goût de la vie plus que celui de la mort. Parce que créer du lien et être dans un lien authentiquement édifiant avec l'autre régénère et offre sa part de sens à la vie. Toute personne – enfant, jeune, adulte, vieillard – est un puits de découverte de la naissance à la mort, si l'on cherche à la rencontrer dans son être essentiel qui « parle » jusqu'au cœur du silence et de la tourmente. C'est interpellant d'entendre de jeunes enfants révéler des trésors de réflexion, de simplicité et de profondeur dans des situations d'extrêmes épreuves. « Mais je danse moi, mais je vis ! », disait une petite fille atteinte d'un mal incurable.
Il s'agirait donc moins de chercher à tuer la souffrance en tuant la personne et avec elle le potentiel d'amour qu'il resterait à s'échanger, qu'à apprivoiser et à assumer l'inconfort de ce qui fait mal. Ceci, au cœur d'une relation nourrissante et privilégiée investie avec la personne malade. Ce qui participe à donner force de vie, c'est de se sentir rejoint, compris, tendrement aimé. C'est la qualité du lien mis en chantier dans la relation qui fait fleurir le goût de la vie plus que celui de la mort. Parce que créer du lien et être dans un lien authentiquement édifiant avec l'autre régénère et offre sa part de sens à la vie. Toute personne – enfant, jeune, adulte, vieillard – est un puits de découverte de la naissance à la mort, si l'on cherche à la rencontrer dans son être essentiel qui « parle » jusqu'au cœur du silence et de la tourmente. C'est interpellant d'entendre de jeunes enfants révéler des trésors de réflexion, de simplicité et de profondeur dans des situations d'extrêmes épreuves. « Mais je danse moi, mais je vis ! », disait une petite fille atteinte d'un mal incurable. Retrouvez cet article sur la page enrichie Euthanasie & Dignité humaine
Retrouvez cet article sur la page enrichie Euthanasie & Dignité humaine